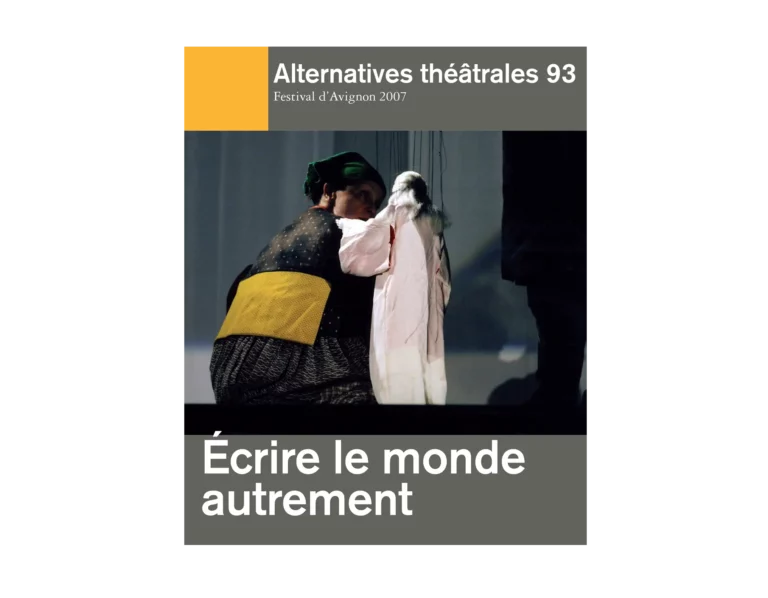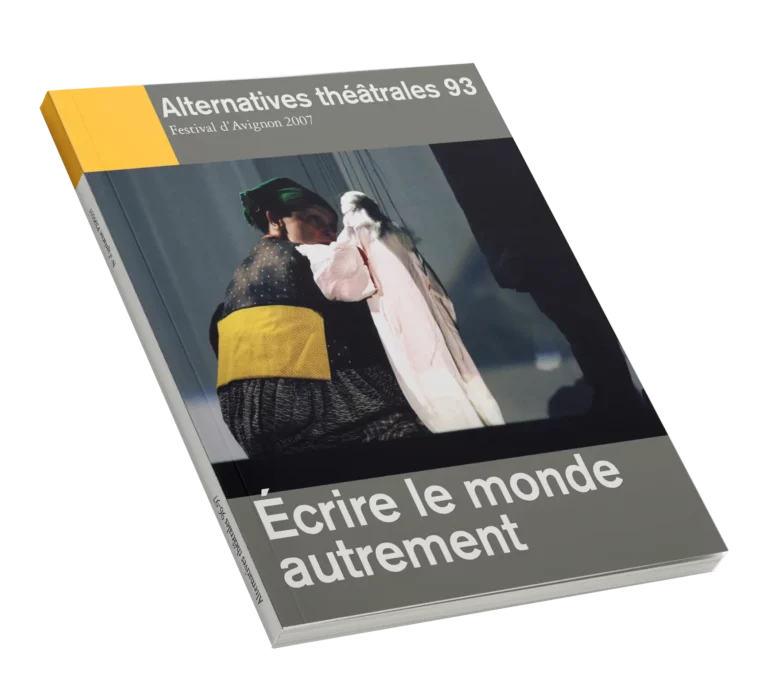DAVID LESCOT : Le projet que tu mets en scène à Avignon s’intitule MACHINE SANS CIBLE. Peux-tu en décrire le contenu, le principe ?
Gildas Milin : L’«anecdote », c’est une soirée où sont réunis des gens pour parler de l’amour et de l’intelligence. Ils sont conviés par un ami commun qui leur propose de les enregistrer. Finalement, ce n’est pas sans rapport avec l’idée d’«écrire le monde autrement ». Je crois qu’un même mouvement nous amène vers l’amour ou vers l’intelligence, et que ça dépend d’une capacité de « déconditionnement ». Ce conditionnement est une machine analytique utile pour la survie sociale. Mais au moment où l’on aime, on cesse de projeter nos peurs ou nos traumatismes sur le visage de l’autre, on le regarde tout à coup tel qu’en lui-même. C’est un changement radical de notre façon d’observer, et aussi du rapport entre l’observateur et la chose observée.
Les gens réunis dans MACHINE SANS CIBLE en arrivent à décrire l’intelligence d’une façon assez proche : comme une faculté de répondre à une situation hors de tout conditionnement. C’est là qu’on s’offre la possibilité de devenir « intelligent », c’est-à-dire de trouver d’autres voies à partir de nos peurs et de nos angoisses. Et je dirais que de mon côté, il ne s’agit pas tant d’écrire le monde autrement que de permettre au spectateur de regarder un spectacle autrement.
D. L. : Dans tes spectacles précédents, tu utilisais déjà le théâtre pour observer et analyser de manière quasiment scientifique les sentiments, les manifestations intimes de la psyché, du cœur humain. Ton théâtre est un laboratoire des sentiments ?
G. M. : Oui, je crois que c’est la tâche du théâtre en général. Après, il se trouve que je me suis tourné vers les sciences, la neurobiologie et la mécanique quantique. Et finalement, à chaque fois, tous les outils de mesure mis en place à l’intérieur du dispositif nous conduisent jusqu’à une borne, qui est le « non- mesurable », qui nous échappe, et qui a à voir avec l’intuition, l’intelligence et l’amour, la surprise, les commencements…
Les sciences se situent au-delà des outils de mesure, de jugement et d’analyse : les humains sont des « machines » à créer de l’intuitif. On parle alors d’intuitions fondamentales, « eurêka !» ou tout ce qu’on veut. Dans les dispositifs artistiques, on partage les mêmes choses. On cherche à être dans des dispositions intuitives. Ce qu’il y a de commun entre les sciences et les arts (ou les sports par exemple), c’est que ce sont des dispositifs dans lesquels des forces se rencontrent ; il y a toujours un public, des observateurs. L’humanité se constitue comme ça : des gens suspendent leur activité pour regarder les autres produire des intuitions, et puis ça s’inverse ; on entre donc dans des rôles d’acteurs et de spectateurs.
Dans cette pièce, MACHINE SANS CIBLE, on voit une communauté. Je m’intéresse à ce qui se passe entre les personnes pendant le temps de la répétition, puis, dans le temps dans la représentation, deux communautés, acteurs et spectateurs, se rencontrent. Ici, la fiction parle d’une communauté qui se constitue autour d’un thème, l’amour et l’intelligence. Et ces gens qui ne se connaissent pas commencent à travailler ensemble et créent une communauté sensible de pensée.
D. L. : Est-ce qu’il faut refonder le lien entre le spectateur et l’acteur, entre celui qui regarde et celui qui est regardé ?
G. M. : Le mettre en crise : d’un seul coup, les acteurs se retournent vers les spectateurs et, par le fait de les observer, ils en font les acteurs de la représentation.
Je crois que l’humanité se fonde sur cette relation : des gens qui suspendent leur activité pour permettre le déploiement d’une activité chez l’autre. On le voit dans une famille : quand un enfant regarde son père se raser (il ne peut pas faire cette chose-là), il devient spectateur et, suspendant son activité, il permet le déploiement chez son père de cette activité-là. Et inversement, quand son père va le regarder boire un verre de vin rouge pour la première fois de sa vie, il devient spectateur, il suspend son activité et l’enfant devient acteur. J’ai le sentiment que cette balance entre acteur et spectateur est fondamentale pour l’humanité et peut devenir un champ d’expérimentation réel au sein de la représentation.
D. L. : Ce que tu attends de ce dispositif, c’est la fondation d’une nouvelle communauté qui réunirait l’acteur et le spectateur ? Ou bien est-ce qu’il s’agit juste de s’observer mutuellement ?
G. M. : L’idée est de déconditionner le regard du spectateur, de renouveler sa bibliothèque sémantique, d’appréciation des signes, des codes, avec suffisamment de douceur pour qu’il se retrouve en terrain inconnu. Qu’on puisse entrer alors dans le champ de la stricte observation, en dehors de toute mesure ou de tout jugement. C’est une relation d’amour et d’intelligence que je souhaite avec le public, et elle ne peut se faire que si on permet à celui qui est spectateur, comme dans une relation amoureuse qui commence, d’être dans la surprise totale de ressentir quelque chose
pour quelqu’un.
D. L. : En ce qui concerne le théâtre, on aurait tendance à mettre en avant aujourd’hui les sentiments,