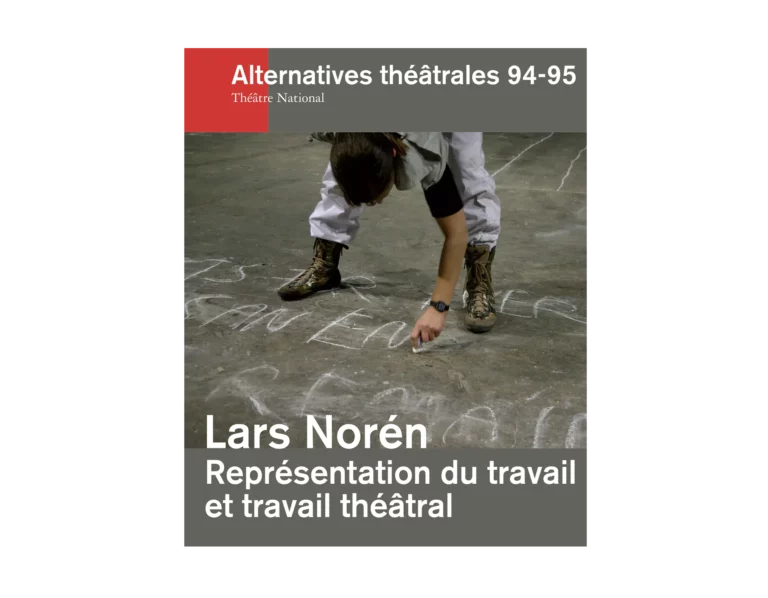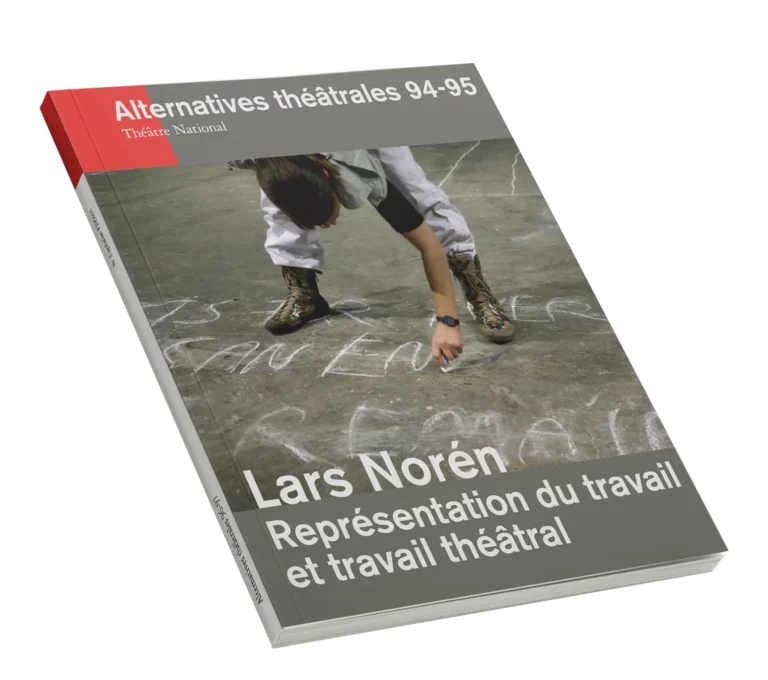« On doit gagner sa vie avec amour. Mais tout comme on dit que 99 % des marchands échouent, de même la vie des gens en général, mesurée à cette aune,est un échec, et l’on peut prédire la banqueroute à coup sûr. »1
La Vie sans principe, Henry David Thoreau
Joël Pommerat a écrit Les Marchands, pièce publiée aux éditions Actes Sud2, puis il l’a mise en scène en 2006. Comme à l’accoutumée, il écrit et met en scène ses propres textes3. Joël Pommerat est auteur de théâtre, c’est-à-dire qu’il écrit pour le plateau — sur le plateau — avec ses acteurs, avec des mots, des sons et de la lumière. Il crée ses spectacles au sein de la compagnie Louis Brouillard, fondée en 1991. Brouillard, ça lui va bien. C’est un mot qu’il prononce souvent, ainsi que piège, masqué, mystère… Il n’aime pas les choses qui tiennent debout trop facilement4, se décryptent immédiatement. Il n’est pas dupe de la complexité du monde et ne cherche pas à la restituer dans une seule image. Il voudrait montrer les visages tels qu’on les imagine en découvrant les personnages d’un roman, flous. Il cherche à restituer théâtralement le flou du monde et des gens, pour approcher la vérité. De pièce en pièce, il s’en rapproche. Les Marchands— magnifique5 — est le troisième volet d’une trilogie ouverte par Au Monde — magnifique6. C’est donc à cette tragédie magnifique et floue que nous allons nous intéresser ici, à sa manière de dénoncer le monde du travail sans l’énoncer clairement, à sa façon de le représenter sur scène — en lointain écho aux Temps Modernes de Chariot. En moins drôle aussi. Même si, avec Pierre-Yves Chapalain, un des acteurs réguliers de la compagnie, on peut considérer qu’au-delà du caractère tragique des spectacles de Joël Pommerat, qui ne permet certes pas de rire aux éclats, on peut y « sourire, oui, et rire aussi, rire, oui. Ce n’est pas gai mais ce n’est pas à se pendre, non ?»7
Ouverture au monde
De pièce en pièce, donc, le théâtre de Pommerat s’élargit, s’ouvre au monde, à ses aspects comique et tragique, à ses intérieurs et à ses extérieurs. Dramaturge de l’intime, peintre de l’humain, analyste des rapports familiaux — mais pour ce qu’ils font remonter à la surface —, il s’est mis au fil du temps à camper ses figures dans une réalité politique, économique, aux contours plus concrets — selon lui, il ne fait qu’appeler un chat un chat —, à sa manière poétique, sur le mode de l’étrangeté. Dans une esthétique du brouillard. Les Marchands nous parle de gens ordinaires qui exercent un travail ordinaire dans un monde quine l’est pas. « C’était quelqu’un qui était enseveli sous le manque d’argent »8 — dit la narratrice à propos de son amie qui n’a pas de travail. « C’était comme une misère d’un autre temps dans un décor très moderne. Ce qui lui manquait par-dessus tout, c’était un travail.Si on ne travaille pas, alors on ne se sent pas vivre. »9 Dans cette tragédie contemporaine10, c’est le dieu « économie » qui dirige les destins d’individus contraints
à travailler pour juste tenir debout ; et ce sont les morts qui prophétisent l’avenir, enjoignent au sacrifice humain. Il y est essentiellement question de la place que le travail occupe dans nos vies : le problème, c’est d’en avoir ou pas, d’être ou ne pas être, grâce à lui, à cause de lui, pour lui. Sous la forme d’une fable ironique et tragique, Les Marchands aborde les affaires d’une vie « normale » sur fond d’événements surnaturels.
L’enchaînement des malheurs
Les Marchands est tissé d’une suite de drames qu’on hiérarchise difficilement. Une femme assurée du bonheur d’avoir un emploi comme quasiment tout le monde dans la région, doit affronter un grave problème de santé, lié à son activité professionnelle : « Dès que je rentrais chez moi après le travail une certaine souffrance de mon dos commençait à se manifester et j’aurais hurlé je l’avoue… »11 ; l’usine Norscilor va fermer et entraîner la suppression de ce bassin d’emplois ; une mère va tuer son fils pour « sauver » l’entreprise ; l’entreprise, qui va finalement rouvrir ses portes, fabrique des armes qui tuent massivement — un téléviseur d’où sortent les morts et les informations annoncent qu’on dénombre les survivants…Cette vision sombre de l’état des choses et du monde rappelle un des éléments de définition de la tragédie grecque, « l’idée selon laquelle il est préférable de ne pas naître. »12 Dans son article intitulé « Une philosophie de la tragédie », Sam Ijsseling rapporte que le pessimisme était vaincu, chez les Grecs, par la religion et l’art, vaincu par le théâtre qui leur faisait office de miroir, leur faisant découvrir la réalité telle qu’elle était en l’exposant à la critique. C’est ce que fait Joël Pommerat en l’exposant à notre jugement critique.Les Grecs croyaient également et sans réserve au destin, à l’enchaînement des catastrophes sans fin, pensant que les lots de bonheur et de malheur étaient attribués par la voix du divin. Selon Sam Ijsseling encore, l’origine du Mal est une question qui hantait les tragédiographes, et hante encore les philosophes. Elle intéresse visiblement Joël Pommerat aussi : « Je commence vraiment à me demander si un angle de vue pour aborder ce que j’écris n’est pas la question du bien et du mal. Il n’y a pas qu’une seule façon de caractériser mon travail, mais c’en est une qui le caractérise assez bien. »13 Dans Les Marchands, les gens peuvent bien souffrir sur terre puisqu’il existe un monde après celui-ci. C’est l’hypothèse formulée par la femme qui n’a pas d’emploi, pas d’argent, mais un imaginaire débordant. Selon elle, nous vivrions dans un monde qui n’est pas vrai et dans lequel nous nous imaginerions en train de vivre, où la mort serait le monde vrai où