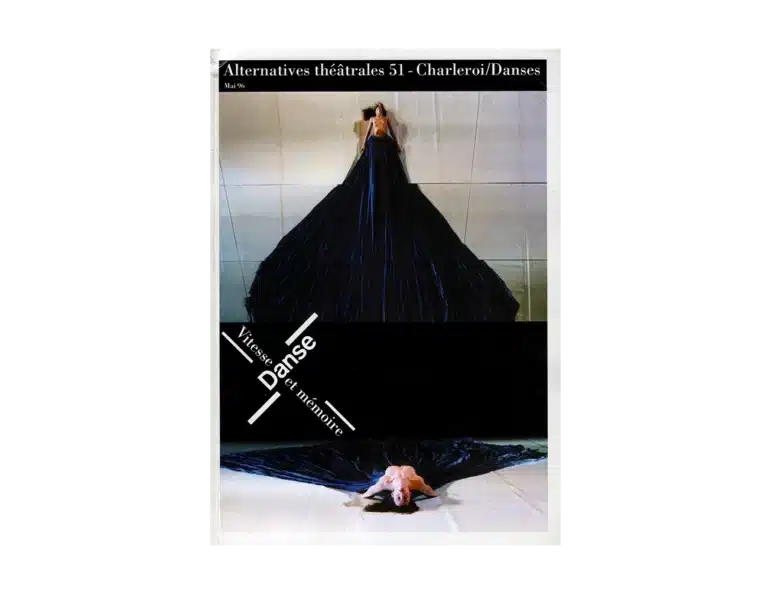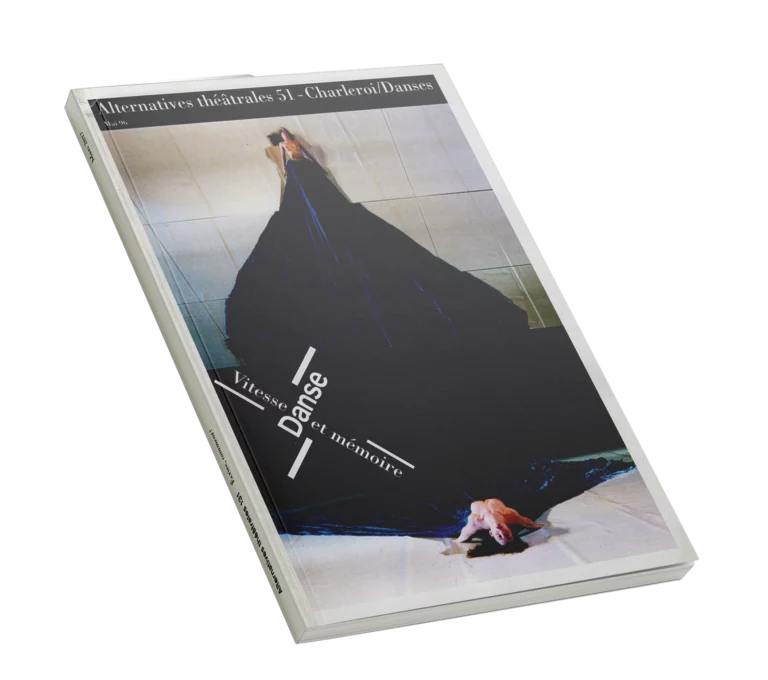FABIENNE VERSTRAETEN : Tu crées ton spectacle, GÉOMÉTRIE DE L’ABÎME, dans le cadre de la troisième Biennale de Charleroi/Danses, dont le thème est « Vitesse et mémoire ». Ces deux notions comptent-elles beaucoup dans ton travail ?
Claudio Bernardo : Oui, car pour moi la danse est mémoire et vitesse. D’abord, pour ce qui est de la mémoire, mon travail chorégraphique est né de ma situation d’étranger en Belgique. Cela m’a permis de faire vivre ma mémoire sur mon pays, d’avoir la distance qui permet l’analyse. J’ai essayé de créer des spectacles qui parlent du Brésil, mais d’une réalité autre que l’imagerie de « Brasil Tropical », du football ou du carnaval.
D’autre part, dans plusieurs de mes spectacles, j’ai utilisé des textes de manière théâtrale, et j’ai constaté que chez le spectateur, le temps d’observation et de compréhension d’un mouvement n’est pas du tout le même que le temps de compréhension de la parole. C’est un autre temps. On pourrait dire que la danse, c’est l’instinct et que la parole, c’est la raison, mais il y a des mouvements qui peuvent aussi toucher l’intellect. J’essaie de gérer ces temps différents, en travaillant le rythme, les mots, la façon dont le mot apparaît : qu’est-ce qui fait que la parole apparaît à un moment donné dans le corps ? Quel temps, accéléré ou dilaté, donner à cette parole, pour trouver un équivalent entre la gestuelle et les mots ? Dans mes premières pièces, le texte était traité très musicalement. J’essayais d’arriver à des enchaînements très répétitifs qui produisent une sorte de transe. Le corps était chargé d’énergie, et tout à coup l’interprète commençait à parler, à jeter la parole. J’avais choisi le texte pour son sens, mais j’essayais de le faire venir comme un vomissement du corps vers la parole. Les gestes étaient très petits pour aider le danseur à faire démarrer le sens de sa parole. Plus tard, dans LA Voix HUMAINE, j’ai essayé de séparer la danse et la parole, de les traiter dans deux cadres différents, tout en me demandant si ces deux forces pouvaient interagir l’une sur l’autre sans être nécessairement mélangées. Il fallait presque mettre le spectateur dans un état différent de la normalité parce qu’il y avait trop d’informations, et les gens voulaient suivre les mouvements, mais aussi entendre la parole. Le public n’est pas encore tout à fait prêt pour cette dissociation, même si les gens regardent MTV où tout va très, très vite, où tout est dans l’accélération…
F. V.: Tu as monté LA Voix HUMAINE de Cocteau, un texte de théâtre. Dans plusieurs de tes spectacles, Le texte est très présent. D’où vient cet intérêt pour le théâtre ?
C. B.: Je n’ai jamais voulu faire de la danse abstraite. Au Brésil, j’avais lu des livres de Béjart. Ses écrits me passionnaient. C’est ce type de danse-là que j’avais envie de faire. Quand je suis arrivé en Europe, j’ai été un peu déçu : Mudra vivait une époque de changements, ce n’était plus une école de recherche ; la technique était devenue plus importante. Et en même temps je découvrais la danse abstraite venant d’Amérique : Trisha Brown, Cunningham, l’héritage de Martha Graham. Ce qui m’importait, c’était la recherche de Béjart par rapport au sens, la question de la spiritualité. Pour danser, pour entrer sur scène, il faut plonger en soi, s’oublier, il faut donner accès à d’autres choses qui nous traversent il faut chercher ce qu’on a envie de dire, à qui on a envie de le dire et pourquoi…, questions auxquelles je n’ai toujours pas de réponse aujourd’hui. La première fois que j’ai créé une chorégraphie, c’est parce que j’étais étranger dans un pays étranger où je n’avais aucune référence culturelle. La force de mon travail était et est encore celle-là.
F. V.: Est-ce qu’il y a des moments, dans ton travail, où la danse apparaît pour elle-même, pour le plaisir d’elle-même ?
C. B.: Oui, mais c’est alors la « danse de tous les jours », la danse des gens qui vont en discothèque ou la danse de salon. C’est la danse de tout le monde, ce n’est plus la danse chorégraphiée. Il y a aussi une autre forme de plaisir : des moments plus mystiques, où le temps semble presque dilaté, où les corps flottent. C’est dans USDUM que j’ai découvert cet état : l’oubli. Pour la première fois je ne tenais plus mon corps. Je me permettais de basculer, de faire des choses « fausses » par rapport au mouvement, je pouvais être là sans penser qu’il fallait être beau, que mon pied devait être tendu… Mon corps avait une lourdeur par la fatigue, et la fatigue jouait beaucoup sur le spectacle. Cet état-là, cet état de transe, me procure un plaisir énorme. C’est l’abandon.