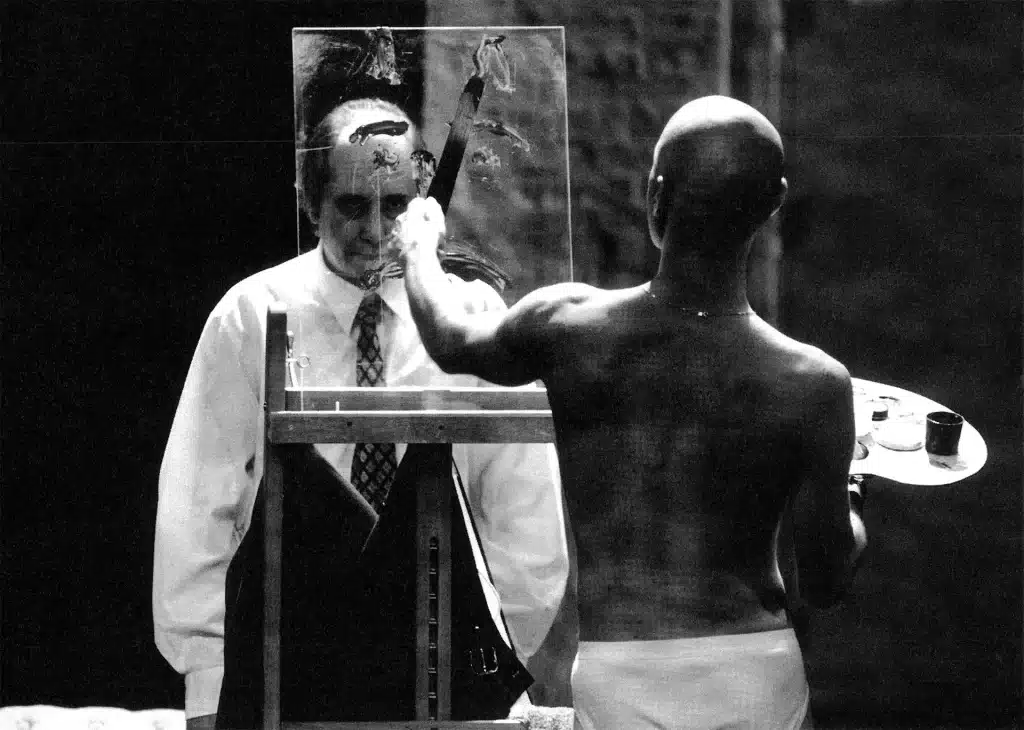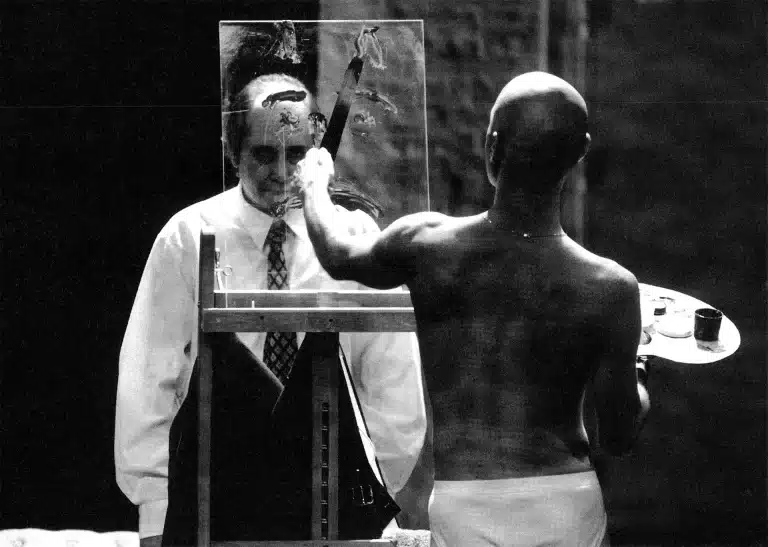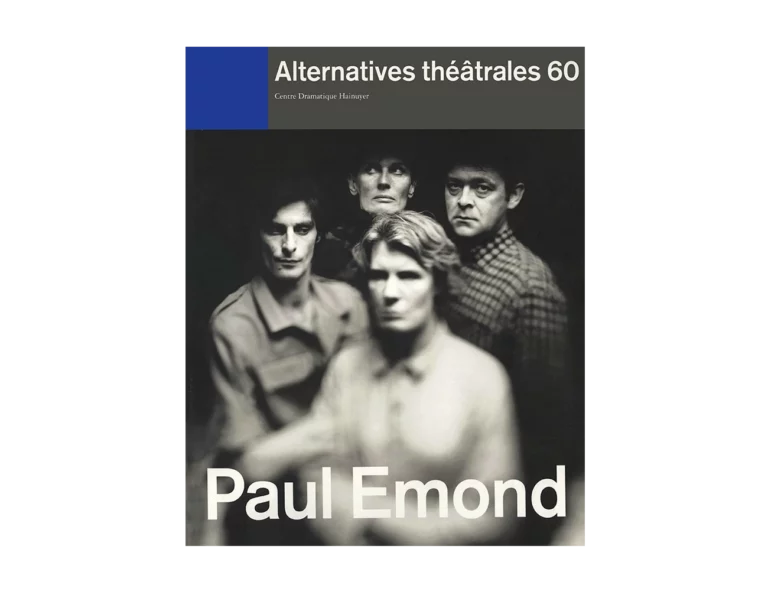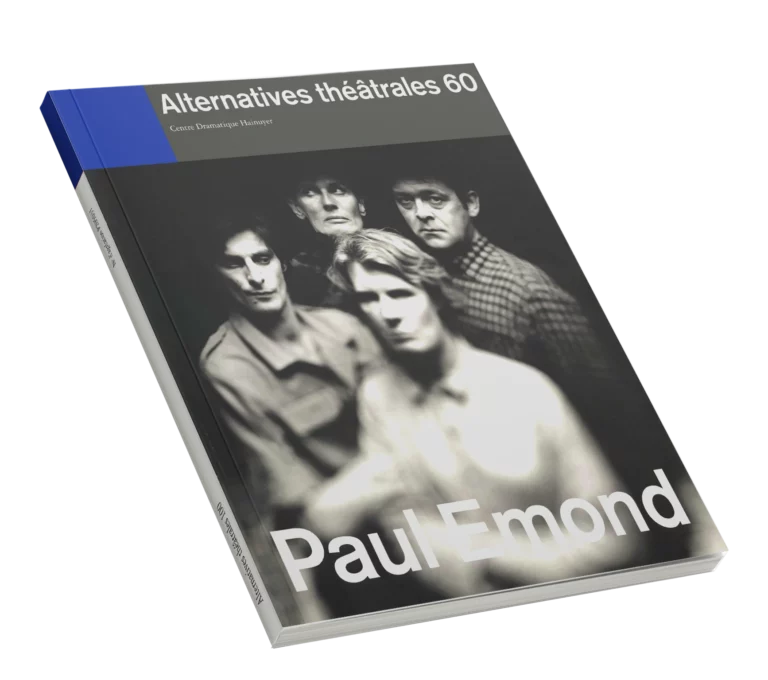RACONTER DES HISTOIRES. Peut-être cette expression rend-elle compte, un peu mieux qu’une autre, de l’activité de nombre de personnages des œuvres fictionnelles de Paul Emond. Dans la plupart des romans, nouvelles ou pièces de théâtre, vous trouverez un de ces bavards impénitents qui n’ont de cesse de vous parler de leur vie, de leurs amours, de leurs exploits, bref, penserez-vous, de vous raconter des histoires. Après un certain temps (ou un temps certain), vous vous sentirez interpellé par le pouvoir ambigu de cette expression : raconter des histoires ne désigne pas seulement l’activité du simple récit, mais aussi l’acte discursif qui mêle le vrai et Le faux, où le locuteur, jouant du crédit dont il bénéficie, trompe son auditeur, lui refilant de la fausse monnaie à la place du bon argent. Ce que Jacques Derrida écrivait à propos de LA FAUSSE MONNAIE de Baudelaire peut valoir pour les textes de Paul Emond, comme pour toute une vaste tradition littéraire :
« Tout est acte de foi, phénomène de crédit ou de créance, de croyance et d’autorité conventionnelle dans ce texte qui dit peut-être quelque chose d’essentiel quant à ce qui lie ici la littérature à la croyance, au crédit et donc au capital, à l’économie et donc à la politique. » (DONNER LE TEMPS, p. 126, éditions Galilée).
Préfaçant LE PRODUCTEUR DE BONHEUR, Maja Polackova et Paul Emond ne comparent-ils pas le personnage de Vladimir Minác à « un ou plusieurs de ces éternels combinards et intarissables bavards, joyeux fabulateurs prêts à toutes les audaces, toutes les arnaques, tous les coups aussi fumants que fumeux, bons bougres pourtant, généreux même à l’occasion et surtout s’ils y trouvent avantage, caresseuts de tout poil à caresser, rats de tous les égouts où traînent des restes à suffisance, séducteurs de toute veuve et de toute orpheline, profiteurs de tout profit, exploiteurs de toute crédulité. »
Exploiter la crédulité, voilà le maître-mot ! Obtenir de l’argent contre des paroles, en donnant sa parole ou en racontant des histoires, qu’importe ! Dans PLEIN LA VUE, Céleste Crouque, faux aveugle, se tait sur sa guérison pour continuer à toucher sa pension d’invalide, mais devient intarissable quand il s’agit de prendre Nadia la blonde dans les rets de son discours pour obtenir une nuit d’amour et la possibilité de la cambrioler une fois celle-ci partie le matin au travail. On pourrait désigner ce type de personnage sous l’appellation de « confidence-man » : ce nom, comme le signale Peggy Kamuf, a été donné à partir de 1857 aux États-Unis au « petit voleur qui misait sur la confiance accordée par sa victime afin de la dévaliser de ses biens sous son nez et avec son accord » (VISA OÙ AMERICAN EXPRESS. DE LA LITTÉRATURE À L’ÂGE DES CARTES DE CRÉDIT)1, Ni haine ni violence, mais des paroles. Herman Melville, lecteur de Paul Emond bien avant nous, fera de cette expression intraduisible le titre d’un de ses romans.
Lecteur, spectateur, vous auriez tort de vous croire à l’abri de ces pratiques. Ne vous a‑t-il pas déjà fallu tout un temps pour comprendre que raconter des histoires, activité favorite des professeurs et des écrivains, c’était aussi tirer avantage de son crédit ? Eh bien, dites-vous que vous aussi, vous êtes victime du crédit que vous avez accordé aux personnages de Paul Emond et à l’auteur lui-même : Jean-Joseph Charlier dit Jambe de Bois vous a tenu en haleine durant toute la pièce avec, pour seuls accessoires, un canon et une jambe de bois ! Rassurezvous, nul ne peut être certain d’éviter la contamination, pas plus le bavard ou Paul Emond que vous, car raconter des histoires, c’est souvent aussi se raconter des histoires.
Jean-Joseph Charlier ne vit-il pas les histoires qu’il raconte ?Plus sûrement que sa jambe de bois, celles-ci l’aident à tenir debout, meilleures prothèses que sa prothèse, que toutes les autres jambes de bois, neuves ou d’argent, reçues pour services rendus. Pauvre Sganarelle de la Révolution belge, il (se) les raconte inlassablement en espérant vainement un revenu : « Ma pension ! Ma pension ! Ma pension ! » sont les derniers mots de la pièce.
La jambe de bois de Jean-Joseph Charlier, la canne blanche de Céleste Crouque, la chaise roulante d’Yvette mettent en évidence ce que je nommerai après David Wills l’effet prothétique : « La prothèse traite du sens et du fonctionnement des articulations entre les choses de deux ordres qu’on suppose être distincts l’un de l’autre : père/fils, chair/fer, théorie/fiction, traduction/citation, littéral/figuré, familier/académique, (…), nature/artifice, public/privé, droit/boiteux, et ainsi de suite. »2 Les textes de Paul Emond, tout à la fois, s’écrivent à partir de cet effet prothétique et le donnent à lire. Écoutez la chanson d’Yvette, clouée dans son fauteuil roulant, tout au début de À L’OMBRE DU VENT :