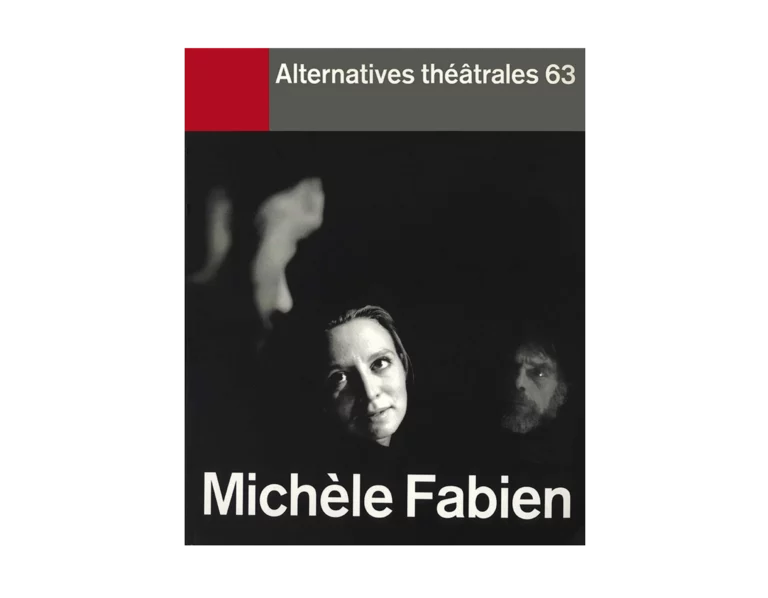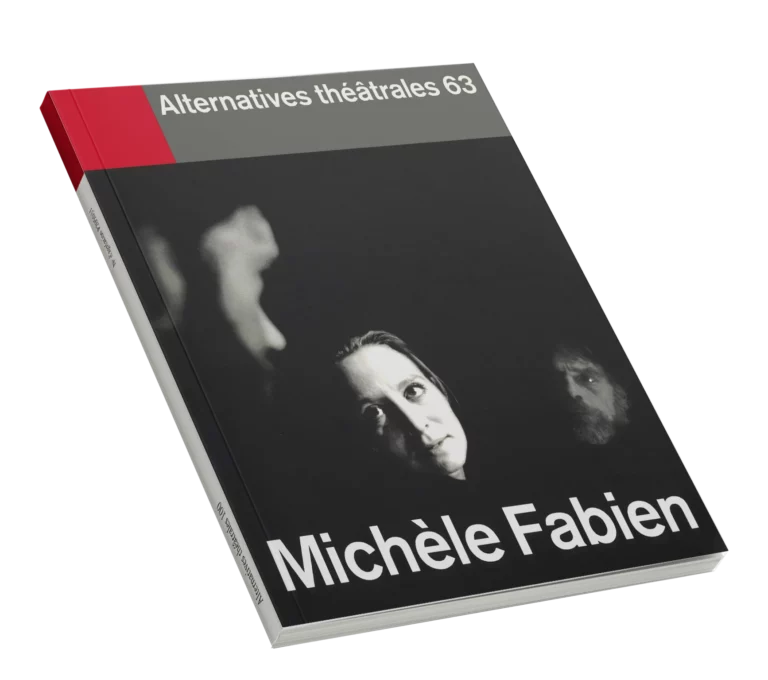TOUTE ACTIVITÉ connaît des débuts. L’écriture ne fait pas exception. Elle partage avec n’importe quel parcours professionnel un certain nombre de constantes. Comme pour toute carrière, parler des débuts, c’est parler de précarité, d’incertitude, de volonté de réussir, du désir de trouver sa place. C’est parler d’une période d’apprentissage et d’efforts. Cet aspect là n’est pas propre au métier d’auteur. Il caractérise tout commencement.
En revanche, il est plus difficile de définir ce qui se joue dans les débuts d’un point de vue proprement artistique. Car il ne faut envisager alors que la relation intime entre l’homme et son art. Parler des débuts en écriture. Sur Le terrain de la page. Avec les mots. Parler des premières surprises, des premières luttes, des premiers échecs, de l’affirmation d’une singularité.
Il est difficile de parler d’une période dans laquelle, pour une large part, on est encore plongé. Mais il me semble que prendre ses marques en écriture, c’est faire l’expérience d’un double mouvement. Il faut, d’une part, apprendre à accepter l’écriture, à s’y abandonner, à se laisser aller là où elle nous porte. Et d’autre part, il faut chercher à y imprimer sa voix. La marquer de son sceau. À la contraindre donc, comme un corps étrange que l’on serre contre soi.
Du pari initial d’écrire à l’entrée effective en écriture, il ne s’agit peut-être que de cela : apprendre l’écriture, c’est-à-dire accepter ce qu’elle impose, tout en lui imposant son propre désir.
Le pari initial
Le pari de l’écriture, on le fait avec soi-même. Le jour où, sans que l’on puisse savoir pourquoi, on se met à sa table et on écrit les premières phrases d’un texte. Pourquoi parler de pari plutôt que simplement de tentative ou d’essai ? C’est que je crois que pour celui qui est un auteur en devenir, il se joue, ce jour-là, quelque chose de plus grave et de plus solennel qu’une simple tentative. Il n’y a pas d’essai innocent. Accepter de jouer, c’est déjà espérer gagner et prendre le risque de perdre. Ce n’est pas « faire un tour, pour voir ». C’est parier. Parier que cela a encore un sens, d’écrire aujourd’hui, pour Le théâtre. Parier, sans qu’on puisse en savoir rien, que ce qu’on fera pourra avoir quelque qualité. Parier même, plus modestement, qu’on ira au bout de ce premier texte. Parier que cette première rencontre avec l’écriture sera le début d’un compagnonnage de tous les instants. Parier qu’on a les épaules assez larges pour cela. Parier que de cette rencontre avec l’écriture sortira quelque chose. Que l’on saura se plier à cette discipline et lui imposer aussi quelque chose de soi.
Le pari se fait, un beau jour, dans la solitude d’une conscience. Il est, je crois, le point de départ de tout cheminement. La première expression du désir. Encore hésitant, mais déjà têtu.
L’annonce
Je repense toujours avec émotion à toutes ces générations successives de jeunes gens qui ont un jour prononcé cette phrase : « Papa, Maman, je voudrais être comédien(ne).»
Même chose pour l’écriture. Les débuts sont aussi caractérisés par cela. L’annonce. Il faut avoir l’audace et le courage de le dire. « J’écrirai ». Derrière cette simple phrase, il faut entendre non seulement l’expression d’un désir mais aussi une prise à témoin. Une fois ce désir exprimé, la pression croît. Car ne pas écrire serait, dès lors, un aveu d’échec. Cette annonce fonctionne comme une première prise de risque. Il faut se battre pour ne pas décevoir. S’en tenir à ce que l’on a dit. Annoncer son désir, c’est se choisir des témoins à son ambition. Et avoir des témoins, c’est prendre le risque qu’il y ait des spectateurs à son échec.
C’est d’autant plus délicat que cela se fait à une période ou, par définition, l’œuvre n’est pas encore née. C’est donc nécessairement une anticipation, une annonce prématurée. On le dit pour s’en convaincre. On l’annonce pour ne plus pouvoir reculer. On le crie haut et fort pour être contraint de tenter jusqu’au bout l’expérience. Et effectivement, une fois dite, cette phrase contraint.
Peupler la solitude
Écrire est une activité solitaire. À cela, au moins, on a pu se préparer. Ce à quoi on s’est peut-être moins préparé, c’est à la nature de cette solitude. Les premières lettres de refus des maisons d’édition. Les premières critiques. Sans appel. Décourageantes. Ou pire, l’indifférence totale. Les textes qui s’accumulent dans les tiroirs et qui n’ont aucun lecteur. L’absence totale de retour sur ce qu’on écrit. L’incertitude qui en découle quant à la qualité de ce que l’on fait. La certitude, même parfois, de faire mal mais l’impossibilité de rectifier le tir faute de conseil extérieur. On se demande alors combien d’années vont passer ainsi. Combien de tiroirs vont se remplir avant que la lassitude ne l’emporte ?
La solitude est évidemment inhérente à l’écriture. Il n’y a pas de raison pour qu’elle disparaisse avec les années et il est probable qu’elle accompagne un auteur jusqu’à la fin de ses jours. Mais ce qui change peut-être, c’est que durant cette période des débuts, elle est périlleuse. On est seul lorsque l’on écrit et l’on est seul aussi lorsque l’on a cessé d’écrire. Accompagné par aucun lecteur. Et c’est cette seconde solitude qui mine le plus et qui, peut-être, est caractéristique des débuts. Elle lasse et décourage. D’où l’impérieuse nécessité de la peupler. Par tous les moyens. Faire appel à l’avis des proches. Leur faire lire les textes. En discuter. Lire, aussi. Pour apprendre des autres auteurs.
Jusqu’au jour où pour la première fois, on rencontre quelqu’un par son écriture et par elle seule. Ce n’est plus un ami où un parent qui, vous connaissant, lit ce que vous faites. C’est pour la première fois quelqu’un, qui ayant lu ce que vous écrivez, vous rencontre. Pour moi, cette personne, c’est Hubert Gignoux. Premier regard extérieur sur ce que j’écrivais. Regard critique. Exigeant et bienveillant. Cette rencontre a été essentielle. Précieuse et cruciale. Parce qu’elle a brisé le cercle vicieux de l’écriture solitaire. Elle a indiqué une direction. Elle m’a soutenu et me soutient encore. Elle a la double vertu de me forcer et de me renforcer.