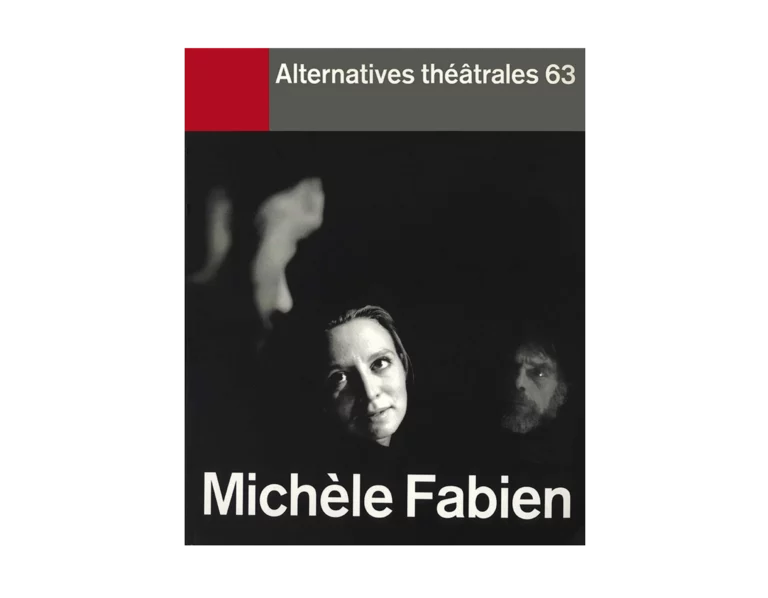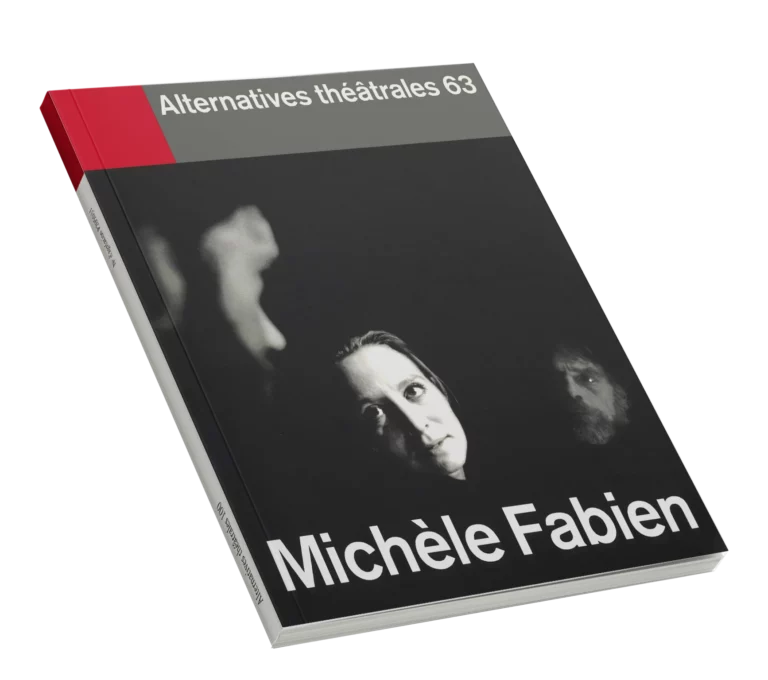Atget : Ce que vous pouvez écrire, c’est que le vieil homme a traversé
beaucoup de temps, mais qu’il n’a rien appris, sauf une chose,
aujourd’hui, que la photo, parfois, vous fait aller là
où il n’y a plus rien, et que c’est bien ainsi. ATGET ET BERENICE.
En août 1992, Michèle Fabien avait accepté de répondre à quelques questions sur l’écriture et le « métier » d’auteur dramatique dans le cadre d’une réflexion sur le statut et l’image du dramaturge dans l’institution théâtrale en Belgique francophone. Ces quelques pages n’ont jamais été publiées. Michèle Fabien y livre des remarques sur son parcours, sur le théâtre, avec une grande spontanéité et beaucoup de simplicité. Son regard, parfois sans illusion, sait aussi se colorer d’ironie. Un regard malicieux dont les photos et le souvenir protègent désormais la trace.
Comment on devient auteur…
PENDANT L’ADOLESCENCE, comme beaucoup de jeunes, j’ai écrit toutes sortes de choses : des poèmes, des romans que je n’ai jamais terminés, des journaux intimes, et aussi une pièce en alexandrin et en cinq actes dont les personnages s’appelaient — quelle originalité ! — Pyrrhus, Andromaque, Hermione, etc. Le cinquième acte n’a jamais été terminé. Heureusement !
Ce qui, plus tard, a stimulé cette activité, c’est mon incapacité à devenir actrice. Sur une scène, avec mon corps, je suis incapable de passer à la fiction ; avec les mots, c’est plus facile.
Difficile de parler des auteurs qui m’ont influencée : adolescente, j’aimais beaucoup Racine ; à l’âge adulte, j’ai découvert Genet et Brecht. Brecht le théoricien plus que l’auteur, d’ailleurs. Cela a déterminé une conception du théâtre comme pratique civique, et pas mal de questions sur la représentation, l’illusion dramatique, le leurre, le faux-semblant, le mimétisme, etc.
Mais en ce qui concerne le passage à l’écriture de fiction, c’est HAMLET-MACHINE de Heiner Müller qui a, selon moi, été la pièce La plus déterminante. Ce texte qui ne ressemblait pas à une pièce de théâtre m’a libérée. Je me suis dit : « Si on n’est plus obligé de faire des situations, des personnages, des entrées et des sorties, si on n’est plus obligé de raconter une intrigue, alors, cela peut être intéressant d’écrire pour le théâtre ». J’aurais dû savoir cela déjà à partir des lectures que j’avais faites des Grecs, mais il se fait que c’est le travail sur Müller qui a re-déterminé une autre façon de Lire les pièces grecques, plus intéressante, je crois.
L’émergence
Ma première pièce montée n’est pas ma première pièce écrite. La première pièce montée s’appelle JOCASTE, c’est une sorte de commande. Je tournais autour d’ŒDIPE ROI depuis un bon bout de temps, j’aurais bien aimé que Marc Liebens monte cette pièce, mais lui, qui avait terminé un trajet sur les « classiques » et ne se consacrait plus qu’aux contemporains, m’a proposé de faire une JOCASTE. Contrainte : il ne faut qu’un seul personnage — pour des raisons économiques évidentes — et il faudrait imaginer un musicien.
Le regard sur cette première fois
Un regard ému, forcément, reconnaissant aussi, vis-à-vis du metteur en scène et de l’actrice qui ont pris le risque de jouer le texte de quelqu’un qui n’avait, et pour cause, aucune réputation d’auteur. Ensuite, j’ai Atget : Ce que vous pouvez écrire, c’est que le vieil homme a traversé beaucoup de temps, mais qu’il n’a rien appris, sauf une chose, aujourd’hui, que la photo, parfois, vous fait aller là où il n’y a plus rien, et que c’est bien ainsi. ATGET ET BERENICE. eu la chance de la voir jouée dans quatre mises en scène différentes et par trois actrices différentes. À chaque fois, des choses différentes se passent
La place de l’auteur de théâtre contemporain dans l’institution
Mon cas est un peu particulier puisque je suis dramaturge à l’Ensemble Théâtral Mobile et que c’est dans le cadre de cette institution que j’écris mes pièces, que je fais les dramaturgies, les traductions et les adaptations. Il n’y a donc pas à proprement parler de seconde profession et mon activité de dramaturge est très liée dialectiquement à mon activité d’auteur. Écrire pour le théâtre, c’est, pour moi, répondre à un spectacle précédent, l’interroger, le critiquer, l’utiliser, etc.
Je ne suis donc pas obligée d’envoyer mes manuscrits à gauche et à droite comme on envoie des bouteilles à la mer en sachant très bien qu’ils ne seront pas lus. Il ne faut pas se faire d’illusion : un auteur qui travaille seul dans son coin sans aucune connivence avec le monde du théâtre (et de préférence le monde des metteurs en scène, car ce ne sont pas les acteurs qui décident) un auteur solitaire, donc, n’a, je pense, pratiquement aucune chance d’être monté.
Les auteurs contemporains n’étant pas très connus, ne font pas recette. Des directeurs courageux peuvent mettre à leur programme ou peuvent s’adjoindre un ou deux contemporains, mais pas plus : institutionnellement, ils n’ont pas le droit de vider les salles à tous les coups. Ils ne cherchent donc pas systématiquement des textes nouveaux. Cela dit, je trouve quand même que les auteurs contemporains ont leur place dans les institutions. Des gens comme Michel Deutsch, Enzo Cormann, Yves Laplace, Philippe Minyana, Joël Jouanneau sont montés régulièrement, et pas dans des petits théâtres inconnus.