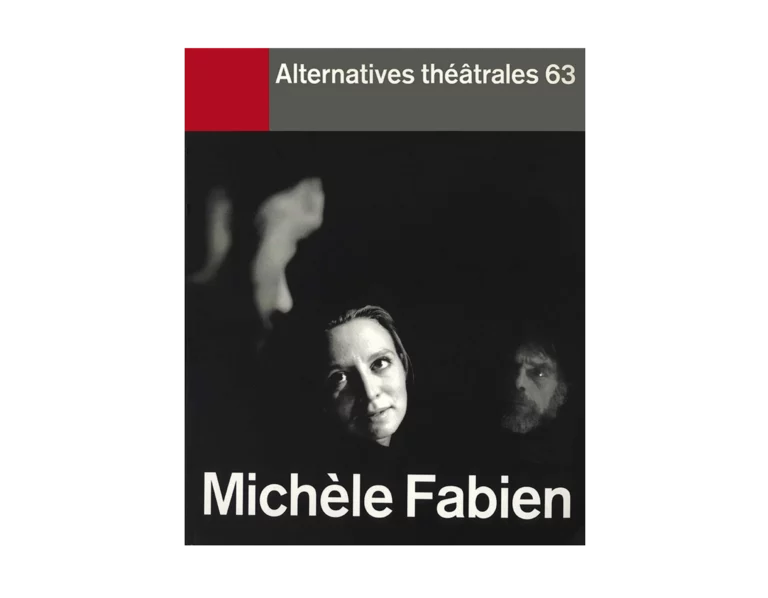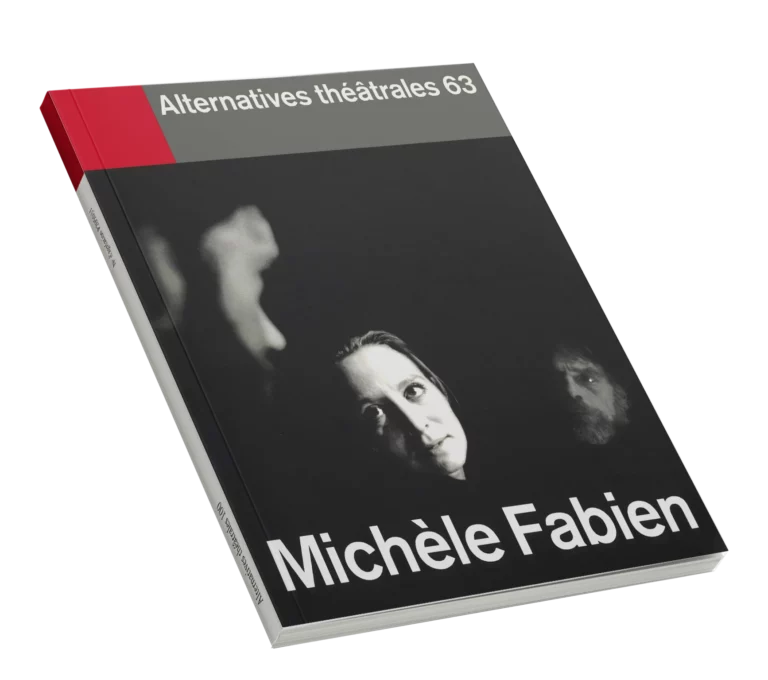Ces mots sont extraits de SARA Z : ils appartiennent à un des propos du narrateur lorsqu’il décrit le tableau, à la fin de la pièce.
MICHÈLE N’EST PLUS LÀ. Secousses dans le cœur, et l’évidence de ce désert : se creuse en moi le cercle du vide, vertigineux. Je pense à ce qu’elle représenta, de plus en plus, pour moi tout au long de ces vingt-cinq dernières années, et tout se consume, ne laissant que l’espace de sa cendre. Les souvenirs se pressent, éblouissants et incertains. Tout se bouscule devant cette effroyable violence qui épouvante et se dénoue aussitôt en souffrance. Je fais, pendant quelques instants, l’épreuve du rien. Et puis, l’irrévocable par simple effort de mémoire, me refait parcourir l’itinéraire de l’angoisse : lettres d’elle relues dans les larmes, photos retrouvées, sacralisées par l’Absence. Tout cela me la rend, hors-temps, dans une suffisance éternelle. Qui autorise et-endigue à la fois la peine.
Je n’aurais pu écrire dans cette émotion-là, dans cette exaltation intime du chagrin. J’ai donc, dans un premier temps, repris un texte, écrit lorsque Michèle m’avait envoyé SARA 7 ; je l’ai retravaillé, cassé, refait mien, en tentant de ne céder pas à cette dépression, à cet effondrement où je suis, la sachant ailleurs. Mais, par peur sans doute, je l’ai glacé.
J’ai aimé SARA Z. Et pas seulement parce que Michèle y révèle, autrement que dans sa pratique d’adaptatrice ou d’écrivain, son étonnante maîtrise du dispositif de réécriture. Par-delà la conception strictement interprétative de celle-ci, elle procède ici à une réactivation textuelle de la nouvelle de Balzac, .SARRASINE, en faisant advenir un « texte second », par déplacement, par jeux sur l’implicite, en débordant audacieusement une source requise comme ressource … Passages du clair au chiffré, métamorphoses qui font de Sara la jumelle d’une Lol V. Stein, par exemple. Qui font aborder la salle de bal, où se tiennent le narrateur et Sara, à des rivages de lumière. Dans la nuit opaque d’une parole qui se cherche.
C’est que Michèle a voulu dire que tout ne pouvait se sceller que là, dans ce royaume nocturne de la fête apparente, où une jeune femme désigne l’altération qui s’empare d’elle lorsqu’elle rencontre une voix donnée : à la mort. Dont la déchirante pureté s’est fondée sur du renoncement (voulu ou non) au désir. Et d’elle, au plus vif du cœur, déferle alors une manière de miséricorde. Moments de porosité et d’anxiété, où le douloureux élancement qui la fait chanceler et vouloir quitter, joue comme écho de cette vie exilée, comme mystérieusement mutilée du chanteur.
Sara comprendra peu à peu seulement que la voie illuminante est celle de Zambinella, le castrat. Peu importe vraiment. L’enjeu est ailleurs : non pas dans le dévoilement progressif de cette « monstruosité », mais dans la découverte de son inguérissable faiblesse, en elle, de son impuissance essentielle. Qui lui fait reconnaître Zambinella comme une personne à part entière. Qui lui fait éprouver, à elle, une mystérieuse fraternité avec celui qui est autre.
L’émotion qui l’envahit à l’écoute du chant, c’est cela pour moi, ce long sillage de doute laissé derrière elle, cette trace entrevue dans le tourment du désir : la révélation sur l’être-même, pulvérisant pour elle le cercle du moi.
— Parce que le chant a conjoint, dans le même temps, apparition — mondaine — et retrait — du régime amoureux —, il a fini de recouvrir les images radieuses du bal pour que Sara lise la ruine, en’elle, comme si on touchait, grâce à la voix, aux troubles de l’identité. Sara est perdue. Elle veut s’en aller pour échapper au jour, au distinct. Bouleversée par cet ailleurs opaque, imprévu, sauvage, c’est à une tout autre profondeur que s’ancrent désormais les propos qu’elle adresse au narrateur qui semble l’aimer. Le temps s’est suspendu : Sara est renvoyée à sa pure solitude. Elle a accepté le manque essentiel auquel elle ne sait ou ne veut donner de nom, elle a accueilli l’irruption de l’Aurre en soi.
Dans ce fleuve d’inquiétude et de douceur qu’a constitué pour moi le texte de Michèle, la curiosité brûlante de l’héroïne balzacienne se consume d’elle-même : Michèle a remodelé cette histoire dans une sorte de liturgie qui annule jusqu’à l’idée même d’un secret qui se déroberait.
Par elle bercées et réconciliées, des images en faisceaux se mettent à converger et n’en dessinent plus qu’une seule : celle d’une femme, Sara, qui a compris que le théâtre et la représentation pouvaient aller jusqu’à cet extrême, la mise à mal du corps. Michèle métamorphose alors la figure du castrat et la ramène dans la sphère de l’au-delà ou de l’en-deçà de la distinction sexuelle, dans le désir enfantin d’être objet d’amour pour quelqu’un.
Sara, quant à elle, aura gagné, au terme de cette nuit enchantée/désenchantée, un savoir sur la souffrance, un vécu de la dépossession. Quasi absente à elle-même au début de la pièce, elle aidera le narrateur à jeter sur la différence un autre regard : non plus celui qui s’obsède sur l’interrogation, l’attente ou le secret, mais qui avoue qu’’identifier cela n’est plus nécessaire. Aveu des manques qui (dés)équilibrent ou inanité de tout ceci ? À la fin de la nuit, l’aurore peut enfin les surprendre, les figures du bal sont devenues fantômes dans un temps dévoré. Demeure la trace que Sara laisse en nous : poignante, fragile et mortelle.