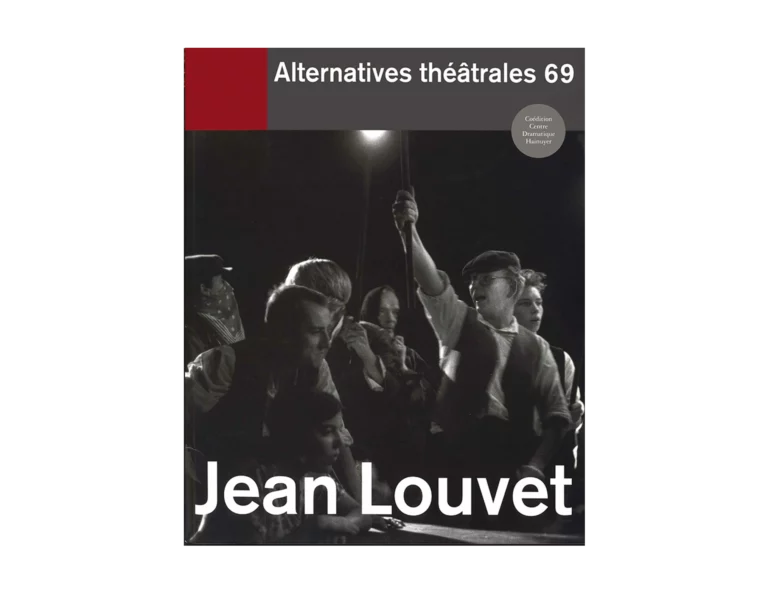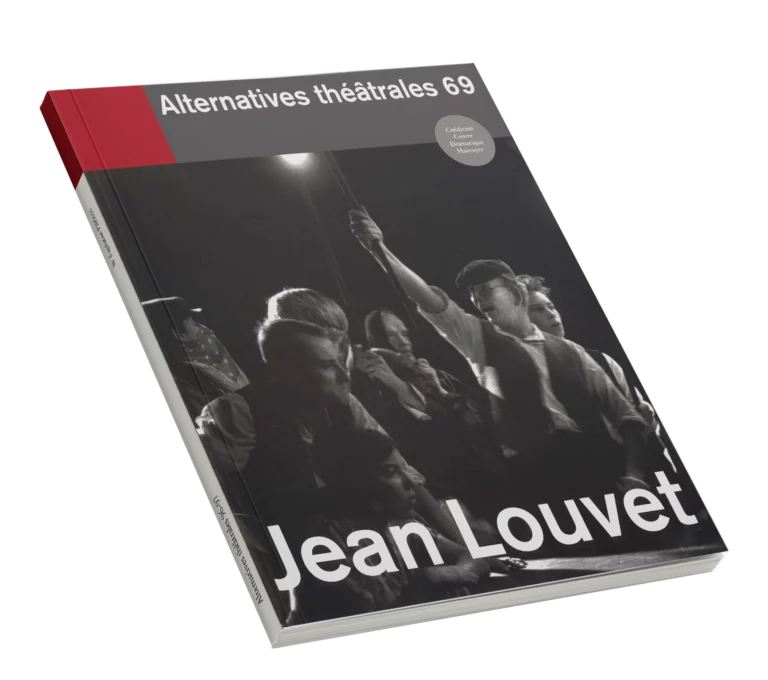NANCY DELHALLE : Vous vous rapprochez de Jean Louvet dans le cadre du mouvement pour une culture wallonne auquel vous prenez part tous les deux. Pouvez-vous retracer le contexte dans lequel ce mouvement s’est intensifié ?
Jacques Dubois : Nous avions eu, Louvet et moi, plusieurs conversations qui touchaient à la déréliction culturelle et intellectuelle de la Wallonie. Dans Carré-magazine, dont l’existence fut brève, nous mettions l’accent sur la méconnaissance de cette culture, sur le silence des intellectuels. Il y avait eu aussi, à la librairie Pax à Liège, une présentation du livre LA BELGIQUE MALGRÉ TOUT, ensemble de textes recueillis par Jacques Sojcher. Le livre qui proposait aux créateurs d’adhérer à une Belgique en creux, à un pays se définissant négativement, nous paraissait stimulant. Mais nous avions l’impression aussi qu’il ne nous représentait pas. Ce « creux » pour nous était un luxe bruxellois ; les Wallons souhaitaient aller, au contraire, vers une pleine conscience de leur identité. Forts de ce sentiment, Louvet et moi avons suscité la rencontre avec Jean-Jacques Andrien, Julos Beaucarne, José Fontaine et Michel Quévit, et un premier noyau s’est constitué.
Jean Louvet, à ce moment, est déjà plongé dans toute une réflexion sur le destin de la Wallonie. Après les grèves de 60, il s’est engagé dans une expérience de théâtre politique. Mais chacun de nous avait alors abordé la question du destin wallon selon son propre parcours. Car les grèves de 60 ont été décisives pour notre génération1. André Renard2 qui en avait pris la tête avait lancé le grand thème du fédéralisme et des réformes de structure, avait ensuite fondé le Mouvement Populaire Wallon qui rassemblait la gauche wallonne et auquel nous étions nombreux à avoir adhéré. Or, au début des années 80, le fédéralisme se met en place et une Région wallonne va bientôt exister. C’est une victoire mais nous la jugeons toute partielle parce que le levier économique mis en place n’est pas doublé par un levier culturel.
Dès lors, au début des années 80, notre rencontre prend un nouveau sens. Comment faire émerger une culture ? Plus immédiatement encore : comment faire pour que les gens de culture aient en Wallonie l’occasion de se rencontrer et de se parler ? Nous sommes de La Louvière, de Gembloux, de Liège ou du Brabant wallon et, soudain, nous avons envie de nous fréquenter. Un autre axe se met en place, une alternative à Bruxelles. Nous découvrons ainsi dans le concret que la Wallonie n’a pas le discours de son histoire, que ses intellectuels et artistes manquent d’un point de rassemblement. Louvet apporte l’idée forte qu’un peuple n’existe que s’il donne des représentations de lui-même et, que pour y arriver, il lui faut des œuvres, des personnalités, des emblèmes. C’est ainsi que de très petites nations peuvent rayonner à l’étranger, telle que l’Irlande avec des écrivains comme Synge ou Joyce. La Wallonie a donc besoin de s’affirmer sans retard par sa culture, et par une culture qui ne soit pas seulement dialectale ou folklorique.
N. D.: En tant qu’intellectuel, vous bénéficiiez déjà d’une renommée internationale. À quoi correspondait ce besoin de reconnaissance de la culture régionale à laquelle vous appartenez ?
J. D.: C’est vrai que, du point de vue de mes travaux universitaires, je n’étais pas dans le repli. J’avais publié à Paris, enseigné aux États-Unis. Le Groupe μ3 dont je faisais partie,’ avait un retentissement international. D’expérience je savais que la Wallonie n’avait guère d’image à l’étranger. Or, j’avais été rendu sensible très tôt à mon appartenance. D’abord par un père résistant et membre de Wallonie Libre4. Ensuite par ma participation à un journal d’étudiants assez impertinent, LA PENNE, qui se disait « franc Wallon » et avait un engagement politique.
N. D.: Quels étaient, à l’époque du MANIFESTE POUR UNE CULTURE WALLONNE, les contours du concept de culture wallonne ? Concept qui est à considérer non comme une essence mais davantage comme une construction.
J. D.: Ce fut un objet de débat récurrent. Nous découvrions au fur et à mesure qu’il fallait nourrir ce concept. Par exemple, nous étions attentifs à l’idée que la Wallonie était constituée de Wallons de souche mais aussi de beaucoup de gens venus d’ailleurs, installés chez nous pour y travailler et y faire leur vie. Donc il fallait d’emblée écarter l’idée d’une appartenance ethnique. Il fallait également défendre ou faire accepter la notion de culture mineure.
Étouffée par la Belgique, une Belgique très artificielle à maints égards, la culture de Wallonie avait besoin de tout un travail d’identification et de réaffirmation. Un travail social. La culture wallonne ne s’offrait pas toute faite. En outre, elle ne se limitait pas à des musiciens, des écrivains ou des cinéastes, mais englobait également des façons de vivre, de travailler, de penser. Jean Louvet pouvait ainsi déclarer de façon provocante : nous en sommes encore à l’âge de la pomme de terre ! Et c’était façon de dire qu’il y avait, dans la tradition wallonne, tout le souvenir d’années de pénurie et de souffrance. Toute une posture archaïsante aussi.
N. D.: Comment s’est élaboré le MANIFESTE POUR UNE CULTURE WALLONNE ?
J. D.: Le groupe de départ commence à élaborer quelques thèses et rédige un texte. Nous revendiquons donc de doubler le projet fédéraliste, qui est social et économique, d’un projet culturel. Nous arrivons aussi à la conclusion que la Communauté française de Belgique telle qu’elle se met en place n’est pas apte à nous satisfaire et que la Région wallonne devrait être compétente en matière culturelle et en matière d’enseignement. Une centaine de personnes se réuniront, discuteront le texte et le signeront avec nous. Comme le Parti Socialiste est alors au pouvoir, avec Philippe Moureaux à la Culture, et que beaucoup d’entre nous sont membres ou proches de ce parti, il nous paraît important de rencontrer Moureaux. Les objections sont solides, la discussion tendue. Néanmoins, en cet automne 1983, nous lançons le Manifeste à travers des conférences de presse tenues le même jour à Liège, Charleroi et Bruxelles.
À posteriori, Je pense que nous aurions dû donner plus d’ampleur à la diffusion de ce Manifeste et appeler ceux qui s’y reconnaissaient à nous rejoindre. Sur le moment, le Manifeste fit du bruit mais au total son effet se dilua trop vite. Nous n’avons pas réussi, je pense, à en gérer l’impact. Il aurait sans doute fallu que l’un de nous se fît le leader du mouvement mais celui-là ne s’est pas trouvé. Par ailleurs, du côté de la gauche, ce fut assez largement la conspiration du silence : peur de compromettre les équilibres politiques, les alliances Bruxelles Wallonie.