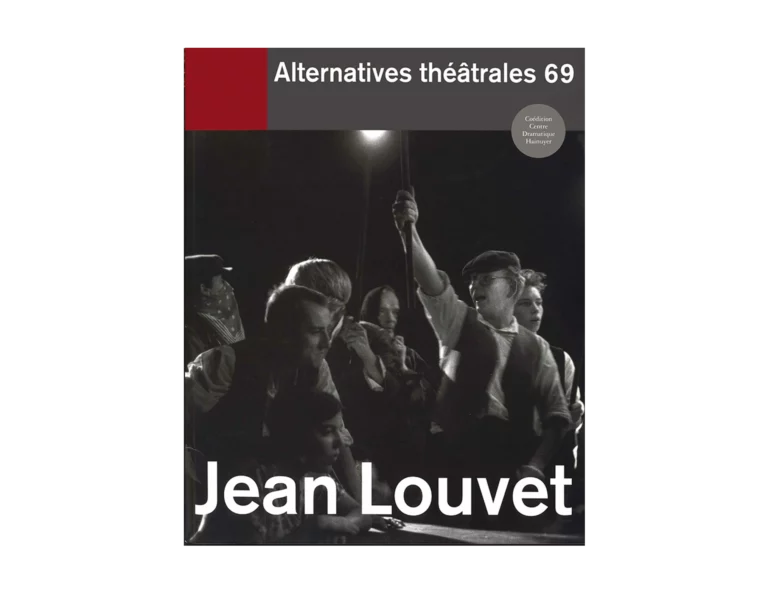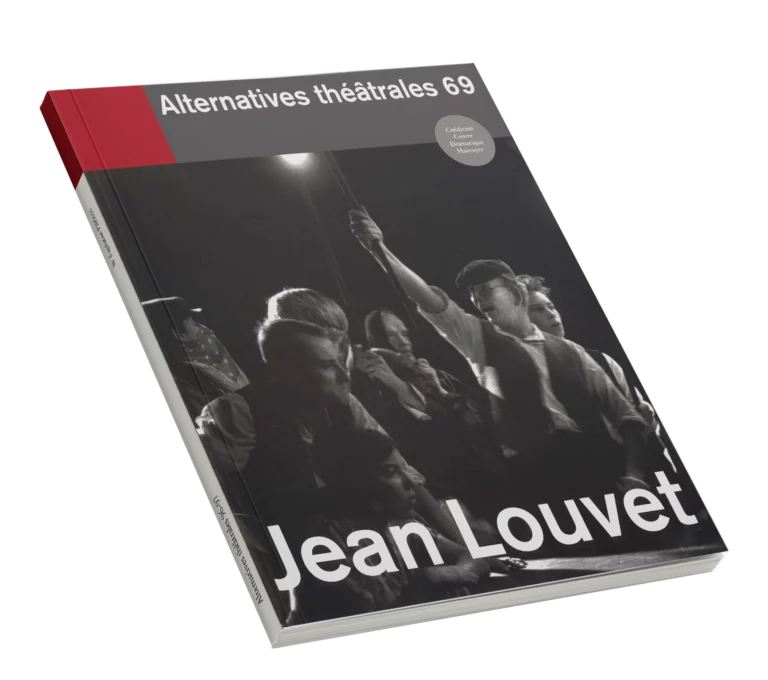MONTER EN 1961 LES FUSILS DE LA MÈRE CARRAR de Brecht, un peu plus d’un an après la grève générale de 60/61, avait sans doute à voir, le recul aidant, avec les problèmes des armes, certainement en 1936 lors de la guerre civile en Espagne et accessoirement en 60/61 quand le mouvement social à caractère insurrectionnel toucha à sa fin et à son échec et que des groupes ayant fait partie de la Résistance envisagèrent de sortir les armes cachées depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. Baroud d’honneur sans doute. Mais l’essentiel pour la naissance de ce théâtre prolétarien était la rencontre avec un auteur peu connu à l’époque en Wallonie. Même si l’apprentissage se fit dans l’urgence, avec l’aide du Berliner Ensemble qui nous envoya une documentation efficace, l’essentiel du théâtre épique ne m’échappa pas. C’était une forme de théâtre que je ne connaissais pas du tout, que je découvrais à la hâte. À l’université, entre 1955 et 1959, j’avais étudié le théâtre de Beaumarchais, de Sartre et d’Artaud, mais ma culture théâtrale était restée faible.
C’est donc grâce à une pièce, LES FUSILS DE LA MÈRE CARRAR, relativement mineure, inscrite encore dans le théâtre aristotélicien, que notre toute fraîche curiosité avait débordé d’un cadre formel traditionnel.
Quand un ouvrier métallurgiste du « Théâtre prolétarien » me suggère d’écrire une pièce sur la grève générale, ma femme Janine Laruelle, qui fonde avec moi « Le Théâtre prolétarien » me rappelle qu’encore étudiant, j’avais griffonné à la hâte un court texte de théâtre que m’avait inspirée la conférence de Sartre, à l’U.L.B… sut les « Questions de méthode ». Je l’avais oublié, j’avais été auteur dramatique sans le savoir.
Ce que je vais retenir de Brecht en écrivant LE TRAIN DU BON DIEU, c’est la construction en tableaux pour casser l’axe de la narration, les procédés de la distanciation (la dérision, par exemple, la parodie qui nous rapproche parfois de la « cruauté » d’Artaud), le refus du psychologisme, le va-et-vient permanent de la contradiction.
Là où je vais me démarquer de Brecht : disparition du personnage principal et développement de la dimension fantasmatique individuelle et collective du prolétariat, faire une très large part à la parole des ouvriers.
Il était tout indiqué, à mes yeux, d’accorder la parole à la classe ouvrière, car je venais de vivre intensément une grève générale où j’avais assisté, quasi jour et nuit, à une sorte de réenchantement de la parole politique. Au cours des nombreuses assemblées générales, quotidiennes peut-on dire, les ouvriers ne délèguent plus leur parole à des professionnels comme en temps de paix sociale, ils la prennent, ils la cherchent, ils la clament. Ce fut surtout dans les premiers temps de la grève quand les « manuels et les intellectuels » se retrouvaient ensemble dans les assemblées ; par la suite, une manœuvre bureaucratique a consisté à séparer les travailleurs en différents secteurs « car les problèmes techniques sont trop complexes (déjà…) pour être traités par tout le monde ». En plus, une des vertus de la grève générale, c’est de réinscrire les travailleurs sur l’axe du temps : on rappelle les luttes d’hier, on organise celles d’aujourd’hui et on tâche de se construire un avenir — en l’occurrence, à plus long terme, changer la forme de l’État belge et imposer des réformes de structure.
Quant à la dimension fantasmatique, ayant vécu vingt ans dans la classe ouvrière, même si je n’avais pas fait l’expérience essentielle du travail, j’avais partagé de très près l’univers fantasmatique qui hantait les jours et les nuits de ma famille ouvrière, restreinte et large, les voisins, les compagnons de travail de mes parents. Moi-même, comme fils d’ouvrier, j’avais subi pendant vingt ans les effets de la condition prolétarienne. Comment arriver à vivre sans être écrasé par les aliénations alors que le système vous marque d’une manière indélébile : « Tu n’es rien ». Et pourtant je vis. Par quel biais, dès lors, devenir « quelqu’un » à ses propres yeux et à ceux des autres, vaincre la peur, l’humiliation ? C’est sur cette lancée post-brechtienne que j’écrirai L’AN 1 qui contient de longues répliques écrites dans un style épique, puis MORT ET RÉSURRECTION DU CITOYEN JULIEN T. C’est avec À BIENTÔT MONSIEUR LANG que je prends mes distances avec le théâtre didactique (quitte à y revenir par la suite).
Pour l’heure, avec Frédéric Lang, illusions et artifices sont convoqués dans une série de tableaux qui se voudraient relever de la comédie (en fait, les spectacles n’échapperont pas au genre noir) avec pour effet de briser l’anneau de clichés très à la mode à l’époque sur le théâtre brechtien : soirée de patronage, spectacle ennuyeux, prêchi-prêcha, messe rouge, etc.). Les simulacres frôlent parfois le vertige avec un Monsieur Lang « intellectuel de gauche » dont le coup d’œil critique aigu se met à tourner en rond.
C’est sans doute avec L’AMÉNAGEMENT que le choc est le plus dur : les promesses de l’Histoire viennent languir sut la pelouse d’une jolie villa hantée par la beauté d’une femme en pleine crise d’identité. L’amant devient aussi malade que Hilde : la dépression idéologique a gagné les corps, les têtes. Le couple erre dans les couloirs de la villa qui sentent bon la peinture fraîche d’un aménagement qui prend vite des allures de métaphore : qui aménage qui ?
Théâtre du quotidien ? Sans doute. Plus de passé, pas d’avenir : le présent est opaque, la vie quotidienne illisible. La langue aussi ; le naturalisme guette. Une classe moyenne sans repère monte sur la scène : elle sera promise à un grand avenir. La marchandisation du désir n’en fera qu’une bouchée. Je ne lâche pas prise d’ailleurs, car, un an plus tard, en 1971, c’est encore la classe moyenne qui m’inspire quand j’écris LE BOUFFON qui va traiter plus précisément du poujadisme.
Après LE BOUFFON, je vais me risquer à une entreprise difficile, je crois, au théâtre et qu’en tout cas j’ai eu beaucoup de mal à terminer : la confiscation de la parole par La société marchande post-marxiste — ce qui a l’air banal en soi — ce qui l’est moins étant de vouloir représenter la métamorphose des signifés sur une scène de théâtre ;en fait, comment mettre en scène l’écart entre signifié et signifiant ?
Après ce périlleux exercice, CONVERSATION EN WALLONIE va tresser des contradictions qui me sont plus familières : celles de Jonathan, fils d’ouvrier, appelé à faire des études supérieures, les ambiguïtés de l’imaginaire ouvrier et quelques aspects de la culture populaire wallonne. Le tout sur fond d’amnésie abordée pour la première fois. Comment jouer l’amnésie ? Comment, par la suite, ne pas se répéter ? Ici, c’est le personnage du revenant qui ouvre la série des pièces qui ont trait à l’amnésie. J’ai continué à chercher l’écriture de cette parole ouvrière et à traquer les ferments d’idéologie dominante dans le discours ouvrier qui conduit cette classe sociale immense de potentialités à venir échouer sut sa propre négation : extraordinaire phénomène que celui de l’involution de ce combat.