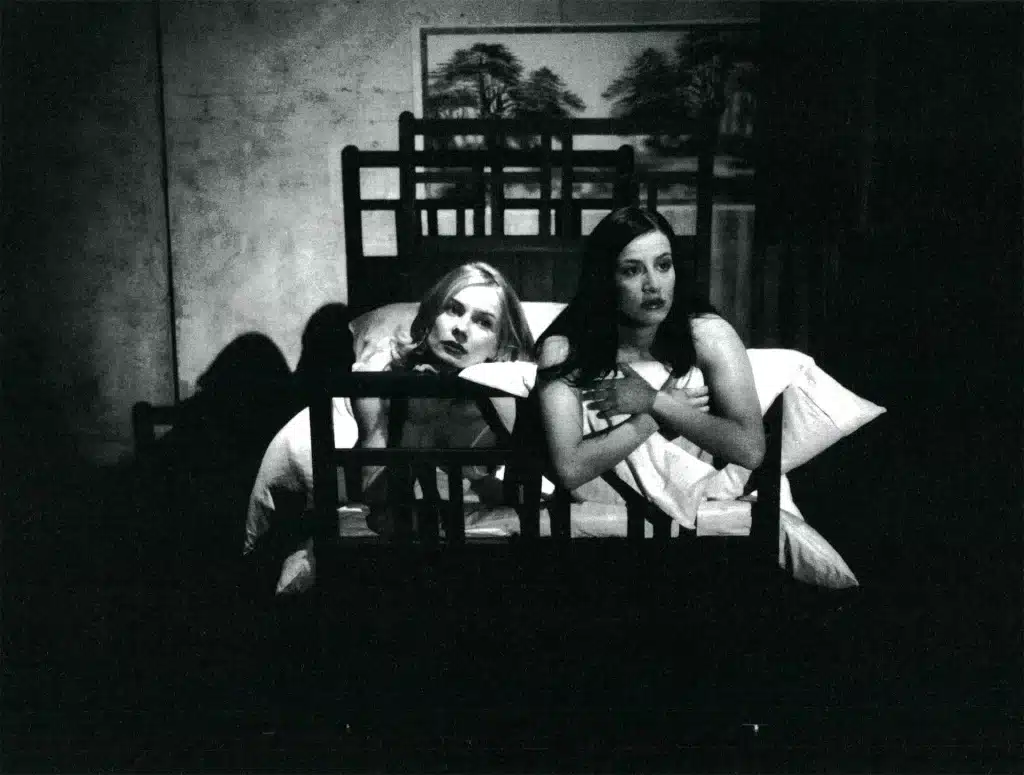Krzysztof Mieszkowski : Tu es directeur et metteur en scène dans ton théâtre. Il semblerait que ce soit la meilleure situation pour réaliser tes intentions artistiques.
Grzegorz Jarzyna : Le bruit court qu’au Théâtre Rozmaitości de Varsovie, nous pratiquons une falsification scénique, alors que nous travaillons sur de véritables émotions. La philosophie du théâtre qui provient de Krystian Lupa, que nous avons connu à Cracovie, consiste à reconnaître l’acteur comme un médium : il n’y a, en effet, pas de différence entre lui et le personnage qu’il joue. Nous avons un même but : faire un véritable théâtre, renouant avec ses origines.
K. M. : Tu cherches donc dans le théâtre un monde dans lequel il n’y aurait pas de différence entre la vie et l’art.
G. J. : La vie et l’art ne forment pas une unité, bien qu’ils se mélangent dans la même sauce.
K. M. : Je pense à une liaison entre l’existence et l’esthétique.
G. J. : Le théâtre est une sorte de laboratoire, dans lequel nous pouvons expérimenter, recréer nos comportements et nos principes de vie, les observer de près. Nous ne créons pas un nouveau réalisme, un syndrome contemporain. Nous ne voulons pas calquer la réalité. Nous aspirons à refléter le phénomène de l’espace éclaté.
K. M. : J’ai cependant l’impression que dans ton théâtre, la personne qui décide de son aspect, c’est toi.
G. J. : Les frontières de mes capacités créatrices sont déterminées par l’acteur. Plus il est sensible, plus il est fort, plus il possède une grande personnalité, plus vite nous nous accordons. Je n’ai pas le talent de Kantor qui pouvait travailler avec un bijoutier, un journaliste ou un peintre.
K. M. : Tu préfères donc avoir affaire à un acteur-technicien, possédant en plus des dons de médium ?
G. J. : Oui, je recherche un acteur qui possède bien les métalangages.
K. M. : Ressens-tu le besoin de partager tes conceptions sur le monde avec les acteurs ?
G. J. : Je peux travailler avec n’importe qui, quelle que soit son orientation sexuelle, politique, sociale ou religieuse. Je pense que le théâtre est une rampe de lancement qui vous envoie loin de tout le contexte culturel bourgeois.
K. M. : M’intéressent tes rapports avec Lupa. Est-il toujours pour toi un modèle ?
G. J. : J’ai grandi sur son continent, et maintenant je m’éloigne de lui, en griffonnant sur une petite île. Son théâtre devient pour moi, aujourd’hui, de plus en plus exotique. Il provient d’un autre monde, celui de ma jeunesse. Après les spectacles que j’ai réalisés, j’ai appris quelque chose sur le théâtre, mais je me sens toujours son élève. D’où peut-être ces foutus pseudonymes.
K. M. : Dans quel but es-tu parti en Asie ?
G. J. : J’ai lu quelques livres. Je pensais qu’en visitant tous ces lieux imprégnés de théâtre, je découvrirais un système théâtral.
K. M. : Tu te considérais alors comme un philosophe ?
G. J. : Philosophe, ça résonne pas mal… Mais je ne peux pas dire que j’ai un cerveau philosophique.
K. M. : Un homme jeune entrant dans la vie ne peut pas être philosophe ?
G. J. : Peut-être. J’étais plutôt rêveur ; j’avais besoin de voyager en Orient, car je considérais que, là-bas, le théâtre avait conservé sa pureté première, son essence.
K. M. : Tu as derrière toi une expérience atypique pour la plupart des Européens. Pour un artiste, ce sont des significations fondamentales.
G. J. : En Papouasie, j’ai compris que toutes les formes théâtrales proviennent de la peur devant la réalité. Elles sont un cri lancé vers toutes les forces surnaturelles, un appel à leur protection.
En Inde, Dieu m’est apparu sur la scène.
En Indonésie, j’ai vu l’illustration vivante des écrits d’Artaud : le beau, conservé par la tradition, qui éveille l’angoisse.
Le Tibet tendait vers l’harmonie.