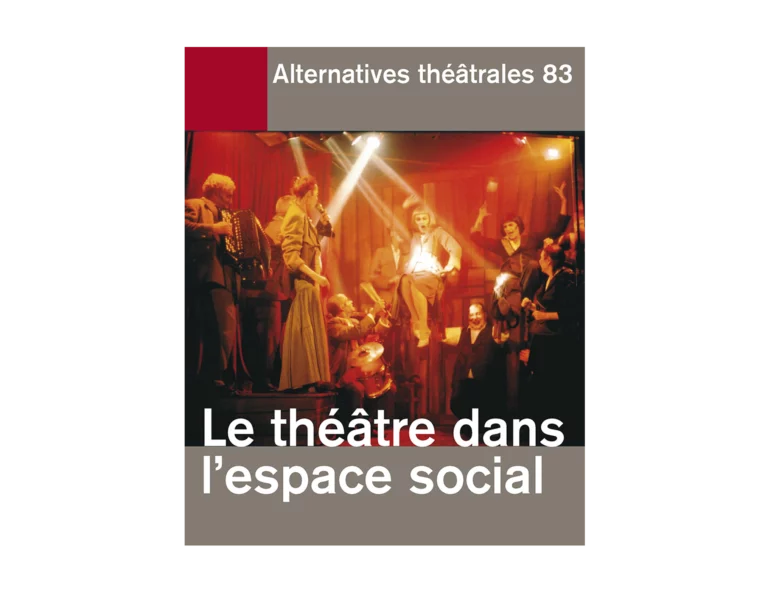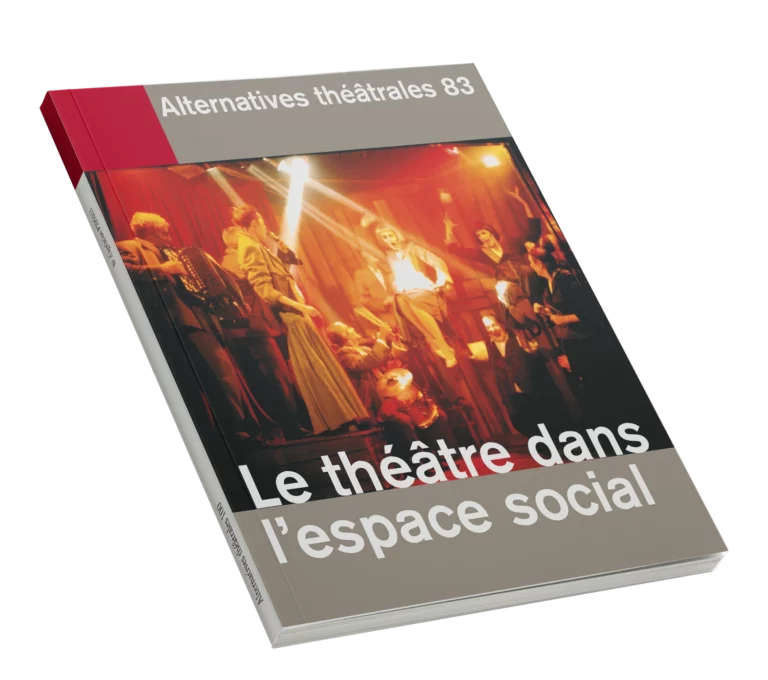Entretien avec Jean-Louis Colinet
Jean-Louis Colinet a été créateur du Théâtre de la Renaissance et a réalisé diverses mises en scène dans des théâtres belges. En 1988, il devient directeur général du Théâtre de la Place à Liège et en 1999, directeur du Festival de Liège. Il est nommé directeur
du Théâtre National en mars 2004.
Alternatives Théâtrales : Ton parcours commence par la création d’une compagnie de théâtre action…
Jean-Louis Colinet : Je ne sais pas si c était du « théâtre action ». En réalité j’ai commencé par une expérience alors que j’étais encore étudiant à l’INSAS. C’était le Fantastic-Sicilian-Musical-Theatre-Club-Band. Cette création a été à l’origine des autres expériences qui ont suivi. C était un travail de création théâtrale tout à fait particulier. A l’époque, c’est-à-dire au début des années 70, le travail dans le champ théâtral européen était assez politique. Tout ce qui était artistique ne pouvait être que politique. Mon travail est né en réaction à une sorte de dérive intellectuelle petite-bourgeoise où il était de bon ton de prendre la parole pour la classe ouvrière et lui expliquer quelles étaient les voies de son salut. Moi qui avais grandi dans la communauté immigrée sicilienne, il y avait là quelque chose qui me dérangeait profondément idéologiquement. J’ai donc développé cette expérience qui avait un côté politique mais culturel au sens quasi ethnologique du terme. Cette communauté avait développé un regard particulier sur la société mais aussi une culture spécifique, un mode de vie et d’expression qui étaient encore très liés au pays d’origine qu’elle venait de quitter. J’ai donc essayé de développer une expérience théâtrale qui soit profondément ancrée dans les modes d’expression de cette communauté. Il s’agissait de travailler à partir des propos et du langage de cette communauté. Outre ce caractère culturel et humain, c’était aussi une expérience politique puisque le discours, le champ de réflexion étaient liés au contexte de crise économique qui pointait déjà. J’ai par la suite, mis en place des projets similaires dans un autre bassin industriel important, la région liégeoise. Ce que cette démarche avait de particulier, c’était qu’il s’agissait de personnes qui ne prenaient pas la parole à la place des autres, mais de gens qui après un long travail de réflexion et de création s’exprimaient eux-mêmes. J’ai continué dans cette voie jusqu’au moment où je me suis rendu compte que cette démarche avait quelque chose de systématique, de répétitif et qu’elle ne se renouvelait pas. En regardant à ce moment-là le champ du théâtre, j’ai pensé que cette démarche, si elle avait pu être reprise par d’autres, aurait pu évoluer, donner lieu à une forme a‑typique mais nouvelle. Mais ce travail n’a pas été investi par la suite par des artistes. Il a surtout été investi par des travailleurs sociaux qui ont vu dans le théâtre une façon d’exprimer des contenus. Ce théâtre en est alors revenu à un statut utilitaire, un instrument d’expression. Cependant les moments de théâtre les plus intenses, les plus inouïs que j’ai vécus, c’est à travers ces expériences-là. Ça devait ressembler à certains spectacles dans des sociétés moins évoluées, moins industrialisées. Le public n’avait pas le sentiment d’aller au théâtre, mais bien d’aller à la rencontre de quelque chose de profondément ancré dans sa propre culture. Les moments où le théâtre se trouve en lien si étroit et si puissant avec une société, une communauté m’ont toujours fasciné. On parle aujourd’hui d’un certain retour du politique dans le théâtre. C’est une chose en laquelle je crois peu. Ou alors il ne l’a jamais quitté. Je pense plutôt qu’on assiste aujourd’hui au développement d’une mode, d’une tendance liée à ce que j’appellerais le théâtre du quotidien. On cherche la théâtralité de l’anti-théâtralité en faisant, par exemple, jouer des personnes qui ne sont pas acteurs, ou en développant une dramaturgie essentiellement liée à un regard sur le quotidien. Mais faire jouer des démunis ou parler de leur quotidien, ce n’est pas nécessairement du théâtre politique. Pour moi, un théâtre politique, c’est un théâtre qui se donne pour objet de transformer le monde. C’est un théâtre dans lequel la conviction, l’affirmation, l’engagement face aux questions du présent occupent une place centrale.
Alternatives Théâtrales : Nous interrogeons ici plus largement le théâtre et l’espace social. Quand tu arrives au théâtre de la Place en 1988, tu reprends la formule d’Antoine Vitez du théâtre élitaire pour tous. Quelles seraient pour toi les caractéristiques du théâtre élitaire ?
Jean-Louis Colinet : C’est un théâtre qui procède avant tout d’une exigence vis-à-vis de lui-même, qui questionne ses pratiques, sa pensée. Le pire ennemi de l’art, c’est la complaisance. Je trouvais cette formule magnifique et je l’ai employée parce que, en Belgique, l’idée d’un théâtre accessible, d’un théâtre ouvert au public, est souvent assimilée à un théâtre racoleur. Le théâtre élitaire pour tous doit être un théâtre de haut niveau, d’aboutissement, de rigueur, de maîtrise, qui reste en lien avec la sensibilité, les préoccupations d’un large public.
Alternatives Théâtrales : Revenons à la formule « pour tous ». Nous savons qu’elle participe d’une utopie. Il a été abondamment démontré qu’une même catégorie sociale profite des moyens consacrés au théâtre. Cela relève-t-il d’une sorte de fatalité ? Est-ce un mécanisme social de reproduction qui reste inchangé ? Par le biais d’une autre politique, serait-il possible d’agir ?
Jean-Louis Colinet : Évidemment. Du reste, il existe d’illustres exemples. Ainsi dans l’ex-URSS une très large partie de la population fréquentait assidûment les théâtres. Il faut susciter chez les gens le désir de la culture. Et dans notre société, rien n’est fait pour cela. Il ne faut donc pas s’étonner que seule une élite intellectuelle fréquente les théâtres. Ce n’est qu’en donnant aux gens ce désir de culture qu’on peut élargir le public. Cela nécessite une politique culturelle qui tienne compte de ça. Il y a pour ça essentiellement deux canaux : l’école et les médias. Ce sont deux espaces de communication, deux espaces où se forgent des valeurs, où se crée l’imaginaire des gens, où s’ouvre leur intérêt, leur regard sur le monde. C’est à l’école, dès le plus jeune âge. Et, c’est aussi dans les médias, véhicule encore plus puissant. Si on optait radicalement pour d’autres attitudes en ces domaines, je suis convaincu que rapidement, le changement s’opérerait. Mais il s’agit d’un processus qui dépasse largement le cadre du travail des artistes ou des institutions.
Alternatives Théâtrales : Quel pouvoir ont précisément les institutions théâtrales pour infléchir cette politique ?
Jean-Louis Colinet : Très limité. A mon sens, il est primordial que le monde artistique investisse le champ politique. Les acteurs artistiques et culturels doivent s’engager, œuvrer au sein même des lieux de décision politique. Il est utile que des artistes soient engagés selon leurs convictions et investissent les partis politiques démocratiques pour peser sur les décisions. Cette politique est à l’évidence une catastrophe dans la social-démocratie. Personnellement je milite activement dans ce sens, mais j’avoue qu’un long chemin reste à parcourir.
Alternatives Théâtrales : Les horaires de spectacle, par exemple, ne correspondent pas aux horaires scolaires. On a supprimé les matinées scolaires (qui conduisaient peut-être à l’échec)…
Jean-Louis Colinet : Quand je dis désir de culture, je ne pense pas seulement au théâtre. Pour reprendre une formule bien connue je dirais qu’aujourd’hui, à l’école, étudier le système digestif de la vache semble bien plus important que d’apprendre à apprécier un quatuor de Haydn. On considère que le système digestif de la vache est une chose essentielle, en revanche, analyser, décoder un chef‑d’œuvre de la peinture de la Renaissance italienne est tenu pour superflu ! On peut changer cela, mais c’est une décision politique sur laquelle les institutions culturelles ont peu de poids. Mais l’élargissement des publics n’est généralement pensé que sous l’angle quantitatif. Cet aspect est certes important, mais la question « quels publics fréquentent quels théâtres », la problématique du spectre social, me paraît tout aussi cruciale. En outre, un autre aspect est généralement négligé, c’est celui du type de rapports qu’entretient un théâtre avec son public. C’est une question fondamentale. Ma volonté, c’est de mener avec le public une véritable aventure artistique, de générer chez lui un véritable désir d’ouverture, un réel plaisir de la découverte. Bien sûr, ce travail a un prix. Sensibiliser des publics nouveaux, développer ce travail d’accompagnement requiert des moyens que nous n’avons pas ou dont nous ne pouvons disposer qu’en réduisant les budgets de création.Mais cette question est pour moi un véritable enjeu éthique et je compte renforcer cette action au sein du Théâtre National.