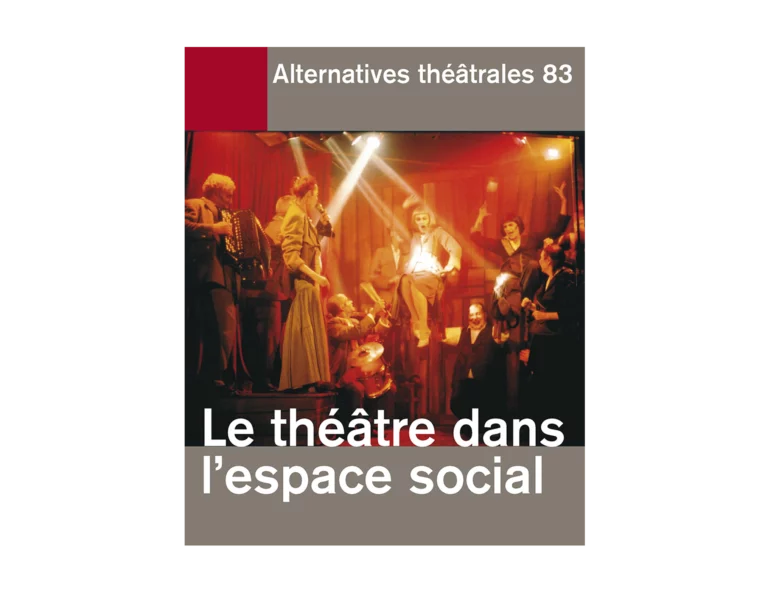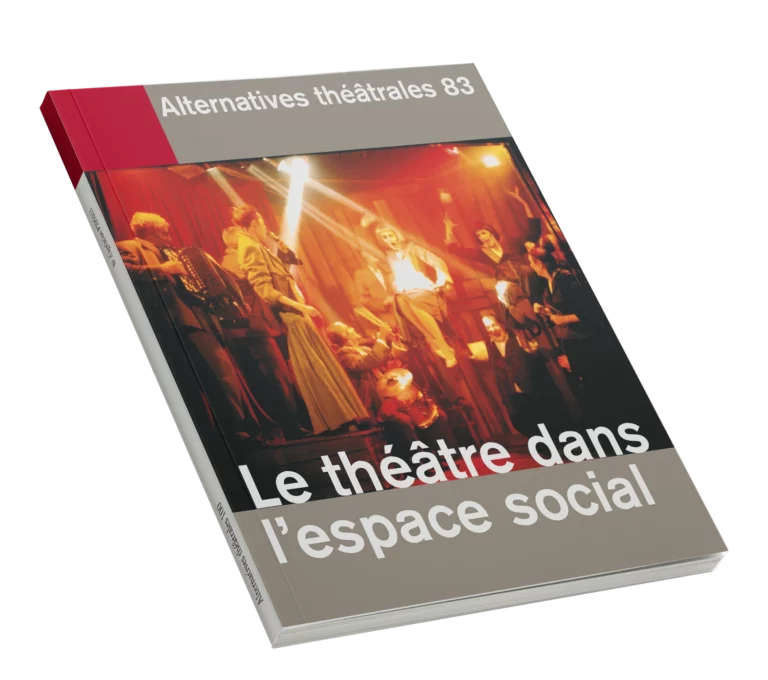Depuis la fin des années 90, plusieurs scènes de théâtre en Belgique comme à l’étranger, accueillent des spectacles élaborés en décalage des normes traditionnelles : ateliers avec des personnes émargeant au CPAS, spectacles avec les habitants du quartier, mises en scène de témoignages… Certains artistes manifestent, dans le cadre même de leur création, une préoccupation sociale au vu de laquelle le discours critique a parfois conclu que le « réel » faisait retour au théâtre. Le théâtre (re) découvrirait qu’il s’inscrit dans un espace social auquel, désormais, il ne pourrait plus rester indifférent. La société interpelle-t-elle aujourd’hui plus qu’hier, laissant penser à une pression croissante de l’histoire en marche ? S’agit-il d’un plus grand degré de perméabilité du théâtre au contexte social et politique duquel il émane ?
En fait, ce souci semble surtout porté par une génération qui émerge, exprimant ainsi un malaise à l’égard d’un monde théâtral clos sur lui-même.On le sait, les salles drainent invariablement le même type de public relativement scolarisé et doté de mêmes dispositions sociales. Les autres, ceux qui ne fréquentent guère les théâtres, conçoivent l’idée d’un art obsolète, figé dans un certain nombre de codes historiques (le rideau rouge, la diction emphatique…) qu’ils tiennent pour universels. Ou alors, ce sont les normes du théâtre de Boulevard qui ont pris possession des esprits nimbant la notion de contemporain de connotations d’ennui et d’incompréhension. Au final, de larges pans de la population contribuent à soutenir un art auquel ils n’ont pas accès.
Cette « coupure » n’est pas nouvelle, elle existait à l’époque des nobles mécènes, avant que l’art, et le théâtre en particulier, ne construise son autonomie. Au fil du temps, une organisation et un fonctionnement plus indépendants ont été acquis par rapport au pouvoir de l’argent ( les théâtres commerciaux si courants au XIXe siècle en Belgique ont presque disparu), mais, aussi, théoriquement du moins, par rapport au pouvoir politique. Les artistes forgeaient donc désormais leurs propres lois, leurs propres codes, leur propre esthétique dans une certaine souveraineté. Mais, même lorsque, dans la ligne de Vilar, on tint le théâtre pour un « service public », il fallut constater l’impossibilité d’élargir le cercle des spectateurs à toutes les couches sociales. La coupure réapparaissait — avait-elle jamais disparu sous les discours de la démocratisation culturelle ? — entre le monde théâtral et ce public potentiel que composent les citoyens d’une démocratie. Moins aliénés aux contraintes économiques de la rentabilité et à celles du service idéologique, les créateurs eurent à conquérir une place dans leur monde autonome en avançant des critères strictement artistiques.
Que devenait alors le souci du public ?
Sans pour autant la balayer d’un revers de main, il est permis de se demander si cette question relève de la responsabilité de l’artiste. La prise en compte de ce facteur dans le geste créateur ne freine-t-elle pas le travail de recherche et d’expérimentation ? Comment innover, approfondir, renouveler, oser, essayer si un impératif de compréhension et d’accessibilité rappelle sans cesse à l’ordre ? Au contraire, n’appartient-il pas à une politique culturelle de permettre à un nombre croissant de « spectateurs » de jouir du théâtre contemporain, en diffusant l’offre, mais surtout en veillant à ce que soit exercée la fonction majeure de la pédagogie ? Car les formations facultatives, les rencontres, les stages…, requièrent une démarche volontaire et consciente, démarche toujours accomplie peu ou prou par une même catégorie de personnes. En quoi on se situe dans un processus de reproduction.
Or, quelle place occupe aujourd’hui l’art contemporain dans un cursus scolaire « moyen » ?