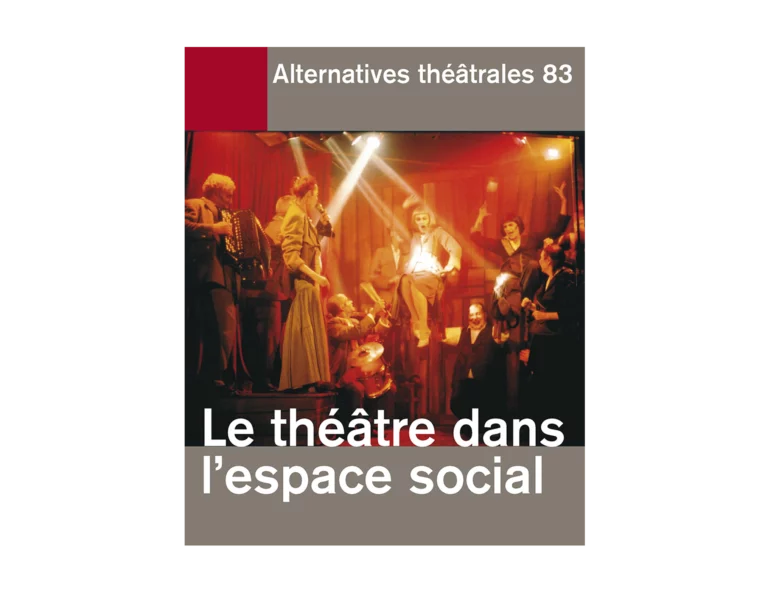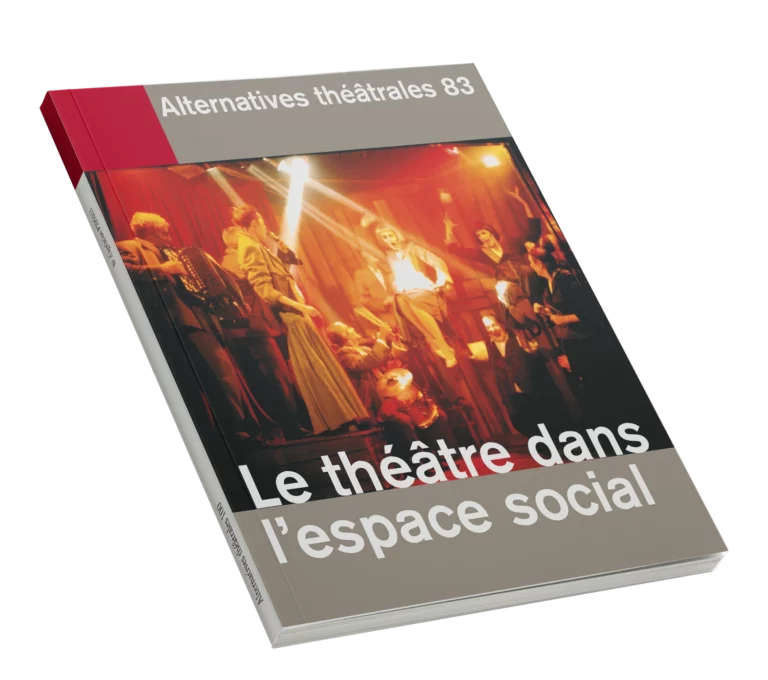Entretien avec Henry Ingberg
Henry Ingberg est Secrétaire général du Ministère de la Communauté française, Wallonie-Bruxelles. Il est également professeur pour la gestion des institutions culturelles à l’Institut des Arts de Diffusion (IAD) et au Centre d’Études théâtrales (CET) de l’Université de Louvain.
Bernard Debroux : Tu as pu suivre de près et participer à la politique du théâtre en Communauté française ces trente dernières années.Comment a‑t-elle évolué ? Le paysage théâtral a‑t-il beaucoup changé ? Les moyens financiers ont-ils augmentés ? Ont-ils été répartis différemment ? Quelle place le théâtre occupe-t-il au sein des autres domaines artistiques et culturels ?
Henry Ingberg : Le théâtre a considérablement changé. Quantitativement et qualitativement. On a assisté à une croissance impressionnante de compagnies à vocation professionnelle. J’entends par là une activité qui se développe dans la perspective d’un métier pratiqué à temps plein, même si pour un certain nombre de personnes au sein de ces compagnies, la volonté de travailler à temps plein se heurte à la limite des subventions obtenues. La croissance est donc très importante. Mais s’il y a eu un effort systématique d’implantation en Wallonie, il reste qu’à peu près 80 % des théâtres ont leur siège à Bruxelles. L’implantation des centres dramatiques en Wallonie traduisait la volonté d’en faire des lieux de création mais aussi des lieux de polarisation et de coordination des différentes initiatives dans leur région. Malgré cela il faut reconnaître que la création de nouvelles compagnies à vocation professionnelle reste plus importante à Bruxelles qu’en Wallonie. Sans doute parce qu’on trouve à Bruxelles un public potentiel plus important et plus directement accessible, alors que dans les régions il y a un travail de défrichage plus important à faire pour trouver de nouveaux publics. Il y a là une réflexion à mener en concertation avec la profession. Est-ce que cette croissance quantitative des compagnies a eu un impact sur l’élargissement des publics ? Est-ce que ce public se répartit différemment ? On a des réponses intuitives. Le dernier qui, avec l’appui du Ministère, a travaillé sur cette question, c’est Michel Kacenelenbogen au moment de la création du théâtre « Le Public ». Il tenait à l’époque un discours disant que les subventions n’étaient pas indispensables. L’enquête qu’il avait réalisée s’était heurtée à la critique d’un certain nombre de théâtres subventionnés qui se sentaient injustement remis en question. C’est dommage car on n’a pas eu cette mise à plat intéressante pour tenter de cerner avec précision le nombre et les caractéristiques des publics du théâtre. Il ne s’agit pas de rendre les compagnies prisonnières d’un système d’audimat, mais ne pas savoir précisément à quel public on s’adresse et ne pas pouvoir fournir des données précises qualitatives et quantitatives, c’est un point qui fait problème. Et, curieusement, il y a incontestablement une réticence à traiter cette question. En revanche pour ce qui est du répertoire, des lieux, du nombre des représentations, des éléments budgétaires, on a absolument toutes les informations nécessaires. Qualitativement, l’évolution est aussi très significative. On a vu arriver des gens qui ont apporté un souffle nouveau dans le domaine du théâtre, abandonnant les formes « classiques » pour développer des formes de créations contemporaines. Ce mouvement qu’on a appelé à ses débuts celui du Jeune Théâtre a accompagné la création de courants (théâtre du corps, théâtre critique, théâtre-action, théâtre pour l’enfance et la jeunesse). On a même vu ces dernières années le renouvellement de genres comme le « boulevard » avec des expériences comme celle du Théâtre de la Toison d’or. On voit donc que l’éventail des types de théâtre s’est considérablement élargi à tel point qu’il est même devenu difficile de les ranger dans des catégories, car on se trouve face à une individualisation des projets remis par leurs auteurs et à leur volonté affirmée de défendre leur originalité. Toute cette évolution a fait que nous ne sommes plus du tout en face d’un paysage semblable à ce qu’il était il y a quelques dizaines d’années. On se trouve confrontés à une évolution quantitative et qualitative remarquable, comme si l’activité théâtrale générait elle-même au fur et à mesure de nouvelles initiatives. Par rapport à cela, le rôle du financement par les pouvoirs publics reste primordial et joue à deux niveaux : les aides doivent permettre aux artistes de créer dans des conditions professionnelles et donc servir à payer les différentes étapes qui amènent les projets sur le plateau, mais aussi permettre au public d’accéder aux représentations dans des conditions financières acceptables sans avoir à supporter les coûts réels des productions. A cet égard il est intéressant de revenir à l’expérience du théâtre « Le Public ». L’intention affirmée et proclamée de son animateur était qu’un théâtre de qualité pour un large public est possible sans subventions. En réalité il a bien fallu constater que pour un certain type de théâtre (que ce soit Tchékhov, Brecht et a fortiori les auteurs contemporains), dès qu’on arrive sur le plateau avec plus qu’une personne et qu’on veut aussi travailler avec les différentes techniques du théâtre (décors, lumières, son, costumes), dans une salle de 400 places, on doit monter considérablement le prix des places et on provoque alors une ségrégation du public par l’argent. D’où la nécessité des subventions publiques, dont bénéficie aussi à présent le théâtre « Le Public ». C’est donc la volonté d’accompagner professionnellement les différentes étapes de la création et le souci de permettre l’accès démocratique aux représentations qui légitiment l’intervention des pouvoirs publics dans l’économie des théâtres. En matière budgétaire, il faut savoir que dans le domaine du théâtre, comme dans celui de la musique qui a des dimensions budgétaires comparables, 60 % au moins des moyens publics sont octroyés aux grandes institutions. Ce qui signifie pour le théâtre qu’à côté du Théâtre National et des grandes compagnies soutenues par des contrats programmes, on se trouve face à un grand nombre de jeunes compagnies qui pratiquent un système qui oblige leurs membres à un va-et-vient entre le chômage et des périodes d’engagement, ce qui socialement, moralement et artistiquement est tout à fait contestable. Pour le théâtre comme pour la musique, on a des budgets importants (de l’ordre de 35 millions d’euros chacun), avec une croissance parmi les plus fortes dans nos budgets d’une année à l’autre, et ils se révèlent pourtant insuffisants… L’activité se développe plus rapidement que l’augmentation des fonds publics qui seraient nécessaires. Ce sera un des grands débats que nous aurons à l’occasion des états généraux de la culture. On peut certes imaginer d’abandonner certaines expériences pour permettre à d’autres de prendre le relais, mais je crains que ça ne permette pas d’inverser la tendance que je viens d’indiquer. Ce qui a changé également, c’est le cadre institutionnel. On était resté très longtemps dans le cadre de l’arrêté royal de 1957 qui organisait le théâtre avec des procédures réglementaires : on perçoit des subventions si on engage x comédiens, etc. L’effet pervers de ce système était que, pour avoir des subventions, il fallait d’abord engager des gens, ce qui entraînait une forme de cavalerie. Les subventions venaient plus tard, après que les dépenses aient été effectuées et plus on engageait de comédiens, plus on avait de subventions, mais qui couvraient les dépenses de l’année précédente. On allait dans le mur ! Il en a résulté une série de déficits cumulés qui étaient dus, principalement, à la volonté d’augmenter l’activité des théâtres plus qu’à la mauvaise gestion. Cela a abouti à une série d’opérations visant à remettre les compteurs des déficits à zéro, mais c’était chaque fois ponctuel et, les causes subsistant, on repartait généralement vers un nouveau déficit. Bien plus, ceux qui retrouvaient un équilibre budgétaire finissaient par penser qu’ils avaient péché par timidité et naïveté. C’est cette analyse qui a débouché en 1992 sur la politique des contrats-programmes. Cette politique a permis aux pouvoirs publics d’arrêter l’inflation d’aménagement des lieux (certains théâtres utilisant une partie importante de leurs subventions pour aménager des bâtiments) et aux théâtres de pouvoir développer leurs projets à moyen et long terme puisque le contrat-programme assurait des aides financières régulières pour des périodes de 4 ou 5 ans. On respectait ainsi l’originalité des projets sans les soumettre à des normes automatiquement appliquées. Le décret sur les arts de la scène qui est venu ensuite fait la synthèse de tous les éléments qui ont été expérimentés dans les rapports initiés par les pouvoirs publics en concertation avec le secteur théâtral. Ce décret intègre le système des contrats-programmes et des conventions. Il intègre les aides aux projets qui avaient été définis dans un autre arrêté royal et il intègre aussi le théâtre-action, le théâtre de rues et le théâtre forain. Donc on voit que l’évolution de la politique a été de stabiliser une série d’institutions pour leur donner un cadre de travail solide dans une certaine durée, tout en permettant à des initiatives nouvelles de voir le jour. Le décret permet aussi des dialogues et des ponts entre les institutions et ces initiatives nouvelles. Il ne s’agit pas de régler ce problème de manière autoritaire et réglementaire.