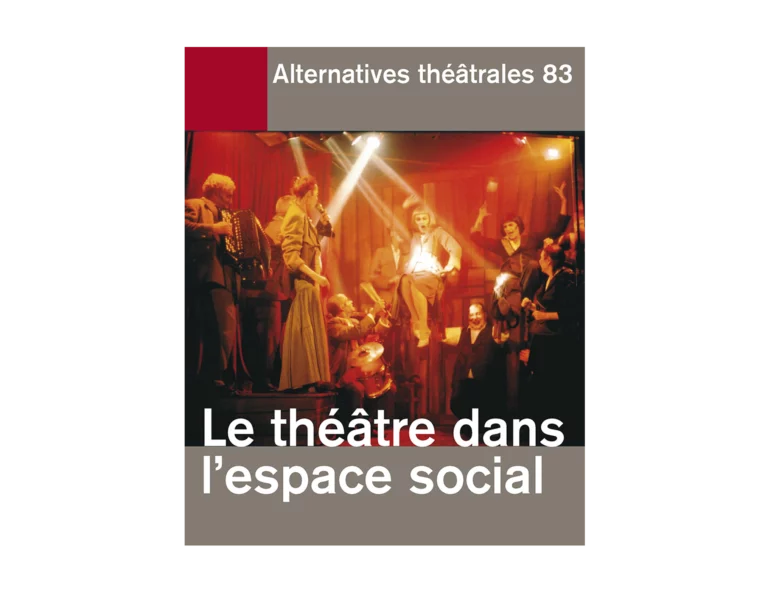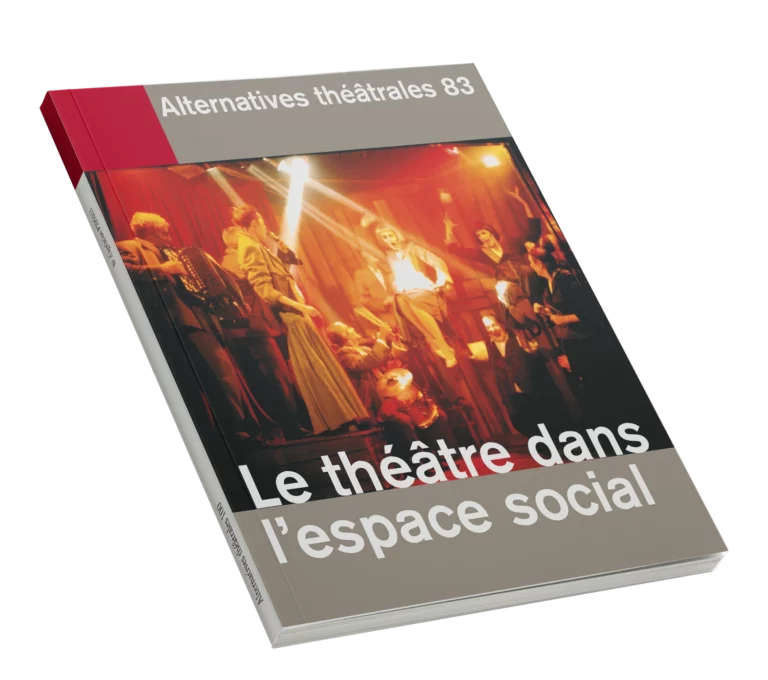Le fil d’une recherche
Philippe Ivernel, Victoriaville, Québec, Juin 20041
AU LENDEMAIN DE MAI 68, comment ne pas tenter, sous l’inspiration des événements, d’actualiser fortement notre travail au sein du Laboratoire des Arts du spectacle du CNRS ? Il nous parut nécessaire de rouvrir la question du théâtre politique, et ce, sous sa version sans doute la plus radicale, le théâtre d’intervention, qui ne relève pas de la représentation instituée. Ce théâtre militant passe souvent par des modes de production autoactifs et par une diffusion hors les murs. Professionnels et amateurs — mélangés ou non — créent alors par improvisation collective, « en relation dialectique avec les événements sociaux », selon une formule datant des années 1920. Bien des groupes de théâtre ont renoué, au cours des années 1970, avec cette tradition subversive ou, plus exactement, l’ont réinventée, car généralement ils étaient loin d’en connaître l’existence.
Nous avons donc commencé, pour prendre un recul, par une étude des pratiques d’agit-prop qui connurent leur expansion durant les années 1920. Le THÉÂTRE D’AGIT-PROP DE 1917 À 1932 parut en 1977 aux Éditions L’âge d’homme La Cité : quatre volumes comportant une anthologie de textes et une série d’études (où les exemples soviétiques et allemands figurent en bonne place). Ainsi ressurgissait tout un courant disparu,englouti — musée ou promesse d’avenir ? Partant de là,il s’agissait de revenir au présent, qui engage bien davantage notre responsabilité. Ce fut Le THÉÂTRE D’INTERVENTION DEPUIS 1968, deux volumes d’enquêtes et de témoignages publiés en 1983 par la même maison d’édition. Puis vient L’OUVRIER AU THÉÂTRE, DE 1871 À NOS JOURS (Cahiers théâtre Louvain, 1987) qui mettait en débat la vision des années 1920 d’une classe ouvrière consciente et organisée, montant sur la scène (jusqu’à produire son propre théâtre) pour donner à voir et à entendre les progrès de l’humain. Dans ce cadre, j’ai été amené, personnellement, à revenir aux origines de la question culturelle dans la sociale-démocratie allemande, car celle-ci, dès ses débuts dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle, amorce la réflexion sur une pratique prolétarienne de la culture. La problématique que nous avions esquissée en exhumant le théâtre d’intervention des années vingt s’annonçait donc historiquement bien des décennies avant la révolution soviétique et son Octobre théâtral. En France, nous n’avions rien décelé de comparable dans les milieux socialisants au même moment (faute d’enquêtes plus systématiques peut-être, en particulier sur les activités artistiques des « Maisons du peuple », quand elles ont laissé des traces). En revanche la piste anarchiste s’est révélée prometteuse. De ce côté-là, bien des écrits théâtraux n’avaient pas été recensés. Or, une fois rassemblés, ils faisaient apparaître un courant inédit, mal repéré en tout cas, dans l’histoire du théâtre en France. Le théâtre de Louise Michel était oublié dans les archives, celui de Georges Darien éclipsé par ses récits et ses mémoires, celui de Mirbeau, rarement associé à l’anarchisme. Outre ces trois grands noms, les auteurs que nous avons retenus pour constituer une anthologie (AU TEMPS DE L’ANARCHIE, UN THÉÂTRE DE COMBAT. 1880 – 1914. Textes choisis et présentés par Jonny Ebstein, Philippe Ivernel, Monique Surel-Tupin et Sylvie Thomas, trois tomes, éditions Séguier/Archimbaud, 2001) sont soit des anarchistes en vue comme Jean Grave, soit de militants moins connus, voire anonymes, soit des écrivains qui ont sympathisé momentanément ou partiellement avec la cause. Justice et Révolte sont les deux mots clés qui la résument.
Au total, le théâtre d’intervention sort de l’ombre à trois moments visibles : à la fin du XIXe siècle, dans les années 1920 et dans l’après 68. La prise en compte de ces trois moments permet une première évaluation de l’étendue de ses contenus et de la pluralité de ses formes. Nous avons retenu cette appellation pour l’après 68 précisément, après avoir écarté le terme de théâtre militant et celui de théâtre d’animation ; Théâtre militant convenait sans doute bien pour les années 1920, dans la mesure où il suppose une pensée ou une pratique fortement déterminée. Or l’après 68 est très diversifié, et ne se réfère pas nécessairement à un engagement partidaire ni à un courant idéologique prévalant. Nous avons aussi écarté théâtre d’animation, qui ne renvoie pas d’emblée à une action de type social et politique. La notion d’intervention, elle, ramène à Brecht, « eingreifendes Denken », pensée intervenante ; de greifen, saisir, prendre, qui a donné griffe en français. Soit un théâtre en prise, cherchant à planter sa griffe dans le réel, par opposition à un type de théâtre que l’on verrait flotter librement dans les airs.
Un texte de Sartre, datant de 1946 et republié dans le journal Le Monde en 2000, fait relais entre les années 1920, 1968 et l’aujourd’hui. Il cherche à définir ce que veut dire « écrire pour l’époque », formule large s’il en est. Mais de cette formule large, Sartre donne une version particulièrement intense, que nous pouvons verser au dossier du théâtre d’intervention. Écrire pour son époque (ou jouer pour elle, donc), c’est pour Sartre l’intersubjectivité conçue ou plutôt vécue comme l’envers dialectique de l’histoire, comme sa doublure. Au sein de l’époque, chaque parole, avant d’être un mot historique ou l’origine reconnue d’un processus social est d’abord une insulte, un appel ou un aveu. Les phénomènes économiques eux-mêmes avant d’être les causes historiques des bouleversements sociaux sont soufferts dans l’humiliation ou le désespoir. Les idées sont des outils ou des fuites. Les faits naissent de l’intersubjectivité et la bouleversent comme les émotions d’une âme individuelle. Écrire pour l’époque, ce n’est pas la refléter passivement, c’est vouloir la maintenir ou la changer, donc la dépasser vers l’avenir et c’est bien cet effort pour la changer qui nous installe le plus profondément en elle car elle ne se réduit jamais à l’ensemble mort des outils ou des coutumes, elle est en mouvement, elle se dépasse elle-même perpétuellement. Dans cette déontologie, Sartre est prêt à se donner des buts modestes, il n’entend pas forcément parler au nom de l’histoire avec une majuscule puisque, dit-il, vivre c’est prévoir à courte échéance et se débrouiller avec les moyens du bord. C’est, en somme, la version la plus modeste du théâtre d’intervention et de l’effet qu’il peut produire sur son public.