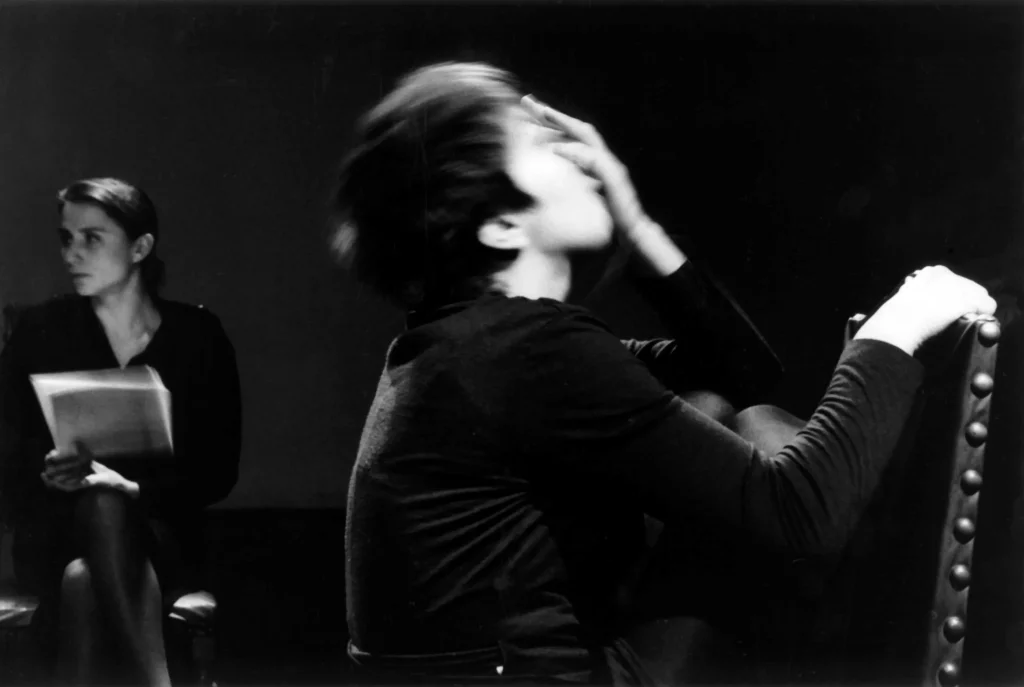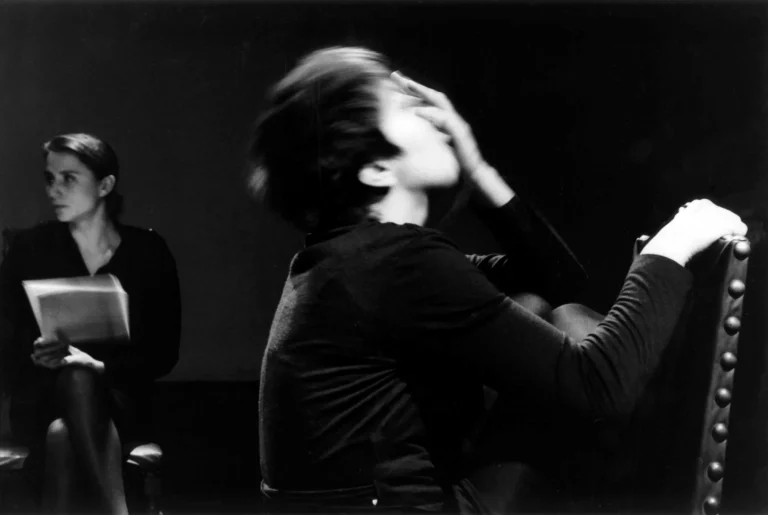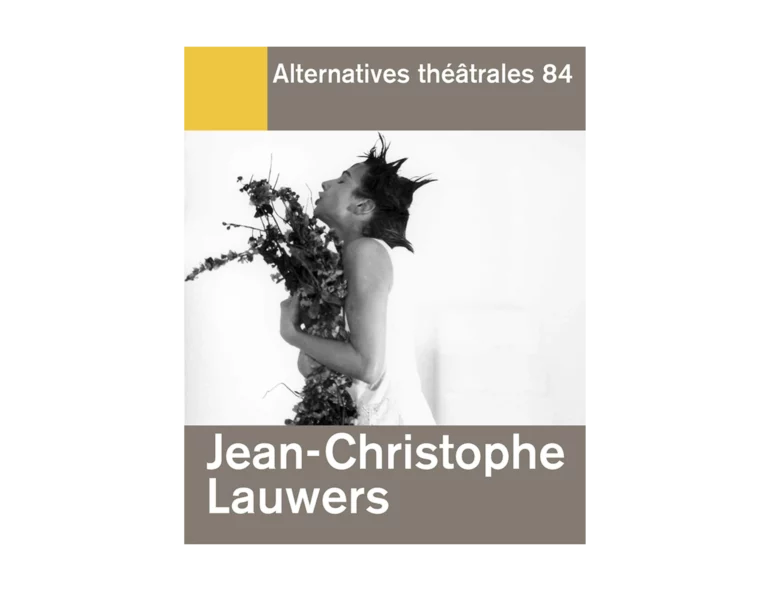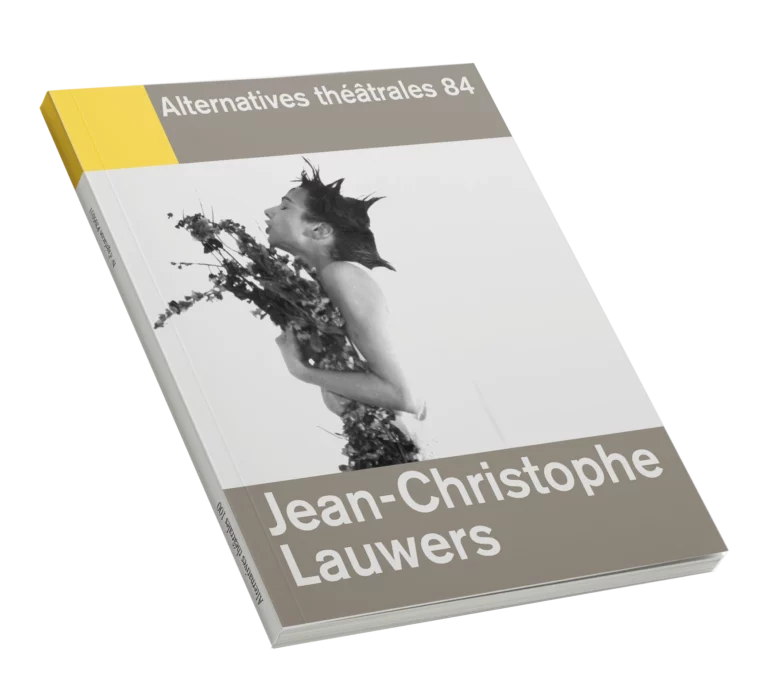J’ai lu quelque part qu’on parlait de « scepticisme joyeux » à propos de Jean-Marie Piemme.
Ce que l’on va dire
ILS ONT DÛ RÉFLÉCHIR longtemps avant de trouver cette formule de scepticisme joyeux, ils ont dû en être fiers, ils ont cru avoir tout résumé en manipulant ce sale paradoxe.
Mais la bonne volonté ne suffit pas ! Encore moins l’amitié ! Sûrement pas l’admiration ! Il y a en Jean-Marie Piemme un bouillonnement : celui de l’impulsion proustienne (car comme j’en suis convaincu, c’est bien Proust qui l’a poussé à écrire), celui du Mal sadien, celui du sang de Robespierre, celui des cendres de Brecht, celui des hurlements d’Eschyle, de Sophocle, d’Euripide, celui de la dyarchie de l’argent et de l’amour (et l’amour chez Piemme se prononce « manque »). Ce bouillonnement nous indique totalement que Jean-Marie Piemme n’est qu’à la genèse de son écriture, qu’il est parti à la recherche, prêtant sa langue au déchirement, s’écartant de loin en loin de la scène du normal. Une telle recherche ne peut qu’échapper véritablement au scepticisme, et ne laisse aucun espace à la platitude bon enfant de la joie, une telle recherche ne peut être qu’obscène et tragique.
Sur la recherche du temps perdu — la genèse de l’écrivain
Pour finir, c’était tout sauf le scepticisme joyeux ; c’est-à-dire que c’était la schizophrénie (la colère, la parole qui touche, le regard qui joue l’ignorance, l’inconnu, le manque flagrant, l’histoire en travers de la gorge, l’amour démesuré pour le théâtre, le relativisme forcé, l’obligatoire rattachement au réalisme, l’incessante recherche du rythme, la demande qui ne succédait ni ne précédait l’attente, l’impossibilité d’être à deux, les paroles prêtées à la femme, la fierté de l’enfant, la sociologie de l’œil, l’instabilité critique, la profonde force) ; les jours avaient appris à creuser une distance entre celui-là et tout autre outrageant visiteur parce que : primo : Piemme en langue courante veut dire obscène ; secundo : le vrai prénom est déjà celui d’un homme blessé ; tertio : la faille de l’écriture (du trou à combler) est déjà présente chez Proust ; quarto : « dans certaines situations, il n’est pas nécessaire de parler » ; quinto : ce n’est pas pour rien que l’on naît en province ; sexto : avec le mur c’est l’idéal qui s’écroule ; septimo : on n’a toujours pas su écrire le cri silencieux (et l’ersatz de son envers : le « gli » n’y changera rien) ; donc je veux dire par là que Piemme gueule sans faire de bruit au moment où les écrivants font du bruit sans savoir gueuler ; je veux dire que Piemme a compris l’écriture par la traversée du corps, mais je veux dire aussi que Piemme a peur de lui-même à cause de cette traversée et ça veut dire que Piemme est un écrivain ; parce qu’écrire que Piemme a commencé à devenir Proust (parce qu’il rate, qu’il biffe, qu’il déchire, qu’il essaie, qu’il commence, qu’il recommence, qu’il apprend, qu’il désapprend, qu’il a touché la fixité du mouvement de la pensée — comme Bacon a touché la mobilité figée de l’homme qui court, qui tourne la tête et qui chie —, parce qu’il est aussi bien Berlinois dans les années 20 que poète lyrique français que tragique grec), parce qu’écrire que Piemme est incapable de se lire texto c’est atteindre le travail de corps qui va permettre de remettre en question ce terme hideux de « scepticisme joyeux », je proclame ici que personne ne saisira l’énigme de l’auteur tout comme personne ne saisira l’« item » de Villon.
Sur les rôles de femmes
Par-delà l’androgynie post-moderne des écrivants germano-hypocondriaques, il y a la féminité des auteurs en corps (on désigne par là ceux qui sont en mouvement, ceux qui ont accepté la distance nourrie par l’« expérience intérieure » ou le « pal ») ; ceux-là sont des trous, des bouches à langues, des peintres à désir (car l’écriture c’est aussi le travail sur la matière), les écrivains féminins sont des hommes qui écrivent comme des femmes par leur bouche d’homme, ce sont des auteurs qui ont été transportés par leur propre violence et qui n’aiment ni ce qui dépasse, ni ce qui pendouille, ni ce qui durcit, ni ce qui agresse, ce sont des hommes-femmes qui n’aiment que les femmes et qui aiment s’y mettre (parce que dedans la femme, le sexe vraiment profondément enfoui et par là invisible, inexistant, on est un peu la femme) ; et pour la fiction, c’est la même chose : faire parler la femme par son corps d’homme, c’est s’y enfouir, c’est s’y enfourner, c’est en jouir ; Piemme fait parler la femme là où Bachman a échoué, et quand Piemme prête sa langue à Anna, à Odile, à Betsy, et à la prochaine, il n’est ni sceptique, ni joyeux, il est profond et tragique.
Par-delà l’écrivain
Après l’auteur, qu’est-ce qu’on trouve, par-delà l’écrivain, qu’est-ce qu’il y a ? Dépassée la fiction, y a‑t-il la réalité (construite ou non, métamorphosée en système de jeu ou restée crue, c’est-à-dire impudique, fragile, pathétique et sans intérêt) ? Les biographies, l’histoire des auteurs, leur vie, ce qu’ils mangent, ce qu’ils boivent, ce qu’ils aiment, ce qu’ils n’aiment pas, comment pissent-ils (debout, assis, couchés, en pied de grue, avec ou sans les mains, en continu ou en saccades, en sifflant, en chantant, en parlant, en pensant, toutes les heures ou en début et en fin de journée…) : on s’en fout.
Mais ce qui nous intéresse chez Piemme, c’est que par-delà le créateur de personnages, de situations, de dits, de non-dits, il y a encore un personnage, et un personnage de théâtre ; il y a aussi le parlé-Piemme, la phrase qui fuse, qui percute, qui tranche, qui gicle après un silence (la parole de Salomon sans l’illusion de la justice) ; la phrase de Piemme est nourrie par Robespierre : souvent dure, sèche, mais à coup sûr indispensable et claire (« Ne savez-vous pas qu’en ces temps, toute indulgence est un crime ? ») ; les actes simples, le traînaillement final des « r », le terrible cynisme (« Français, encore un effort pour être républicains ! »), l’introduction du mal dans sa littérature orale, ont construit le personnage de Piemme qui ressemble à un personnage de Piemme ; la plupart des lâches et des châtrés traînent derrière eux une fameuse boue, Piemme la pousse devant lui, et c’est pour cette raison qu’on n’a, jusqu’à présent, jamais réussi à monter les pièces de Piemme, on n’a jamais su jouer les personnages de Piemme, on a fait du sous-Piemme timide, tiède, on a gommé la quasi-totalité des textes de Piemme (Piemme c’est aussi Sade 91) ; et voilà cette preuve qu’on cherchait : Piemme est bien un personnage de Piemme car il est impossible de parler de lui sans être projeté dans son théâtre, voilà l’ob-scénité de Piemme : il refuse de quitter la scène pour nous rejoindre, il est hors la scène des communs, il est hors notre scène, et pour cela il nous dépasse, c’est pour cela qu’il est au-dessus de nous (parler de la pluie et du beau temps avec Piemme c’est être obscène) ; on a donc su remplacer, en fin de compte, l’expression idiote de scepticisme joyeux, et on peut dire maintenant que Piemme c’est réellement l’obscénité tragique.
La pièce
Commerce gourmand c’est avant tout l’histoire d’Anna S. et de Norden, un homme qu’elle a aimé plus que tout et qui a fui, la confiant pour morte à un autre avec qui elle se mariera, sans trop savoir pourquoi. Mais aujourd’hui Anna est veuve, elle se retrouve dans un bar, un peu ivre, un peu triste où elle rencontre Betsy, jeune femme qui a besoin d’argent pour tourner son premier film. À côté d’elle, ses deux hommes, Frank à qui tout réussit et qui s’apprête à conquérir les États-Unis, et Benny, fainéant et voleur, homosexuel et poète. Frank et Benny qui s’aiment et se déchirent, qui cherchent à retrouver un passé commun que Betsy leur a volé.
Anna indique à Betsy l’adresse de Norden qui lui allouera les sommes nécessaires, en échange d’elle-même, puis petit à petit qui retrouvera en elle une femme qu’il a connue jadis et à qui il veut maintenant donner tout son amour.