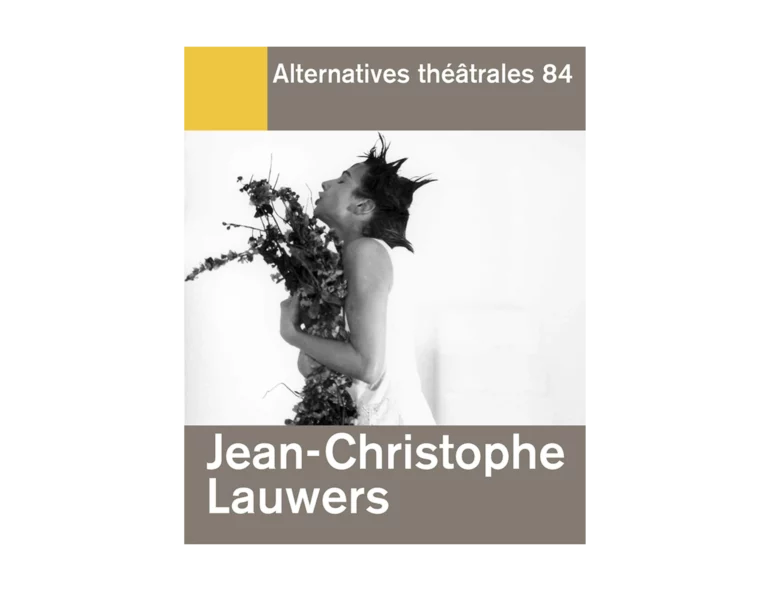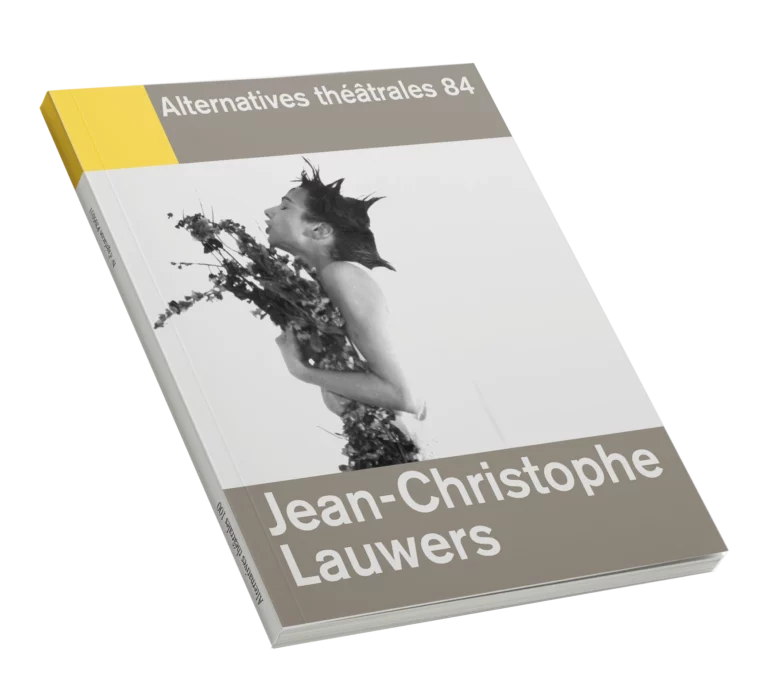CERTAINS METTEURS EN SCÈNE ont des principes et pas de projet théorique, ceux-là, de plus en plus nombreux, travaillent sur la « sincérité » et laissent de côté la « vérité » si chère à leurs aînés. Privilégiant l’intuition, la sensation au détriment du travail dramaturgique et de la praxis, ils ont décidé d’oublier la pulsion pour se réfugier dans l’instinctivité. L’art pour eux n’est plus extirpation mais déversement, l’acteur n’assure plus de fonction symbolique mais emblématique.
D’une société où règne la loi du « tout se vaut — rien n’a de valeur » sauf l’humanitarité et son penchant philosophique qu’est le mielleux humanisme, ne pouvait surgir que des formes artistiques bâtardes, déchirées entre le néoromantisme à la française et le post-modernisme, où tout discours est défendable s’il est sincère. Revêtant les oripeaux d’une tolérance voltairienne, le théâtre de la sincérité modifie l’adage « Je ne suis pas d’accord avec vos idées, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous puissiez les exprimer » en « Je suis en accord avec toutes les idées, mais je soutiendrai jusqu’à l’apéritif tous ceux qui se battront pour en défendre une en particulier ».
On l’aura compris, le théâtre de la sincérité, ses principes de solidarité, de tolérance, de bons sentiments est le fer de lance du « politically correct », vague idéologique dévastatrice aux États-Unis dont la version européenne fait fureur à Sarajevo et Goradze.
Les artistes qui travaillent « la sincérité » ont des principes. Le premier, directement inspiré de l’anthropocentrisme, décrète l’actocentrisme, c’est le comédien, porteur de l’action, moteur du spectacle qui est au centre de l’univers théâtral, il est non seulement objet mais également sujet du spectacle. La scène devient le lieu cathartique où le comédien s’exprime, se confie, tisse avec le spectateur des liens privilégiés, celui du partage de l’expérience. Et qui dit échange, dit communication.
Le théâtre de la sincérité considère les arts de la scène comme médium des préoccupations, réflexions, mots d’esprit de ses protagonistes. En un mot, le théâtre est lieu de communication où rien ne se passe si l’émetteur n’est pas sur la même longueur d’onde que le récepteur, si le langage n’est pas issu d’une « consensuelle » entre spectateur et acteur. On va donc, pour se comprendre, utiliser le langage que tout le monde peut percevoir, le langage du cœur, le parler vrai où tout est permis puisque même si des zones d’ombre apparaissent, elles ne sont que la traduction d’une pudeur à se confier trop avant à un public. La sincérité nécessite donc la déviation de la première et probablement seule réelle convention du théâtre qui vient d’engendrer la vérité par le faux.
Toujours balancé entre le désir d’être vrai pour engendrer la vérité et la culpabilisation qu’engendre le laisser-aller à l’instinctif, le théâtre de la sincérité n’assume pas cette convention qu’André Gide décrétait être constitutive de l’art : le mensonge. De l’intéressante question de Pirandello : « acteur ou personnage ? », le théâtre de la sincérité fait « acteur ou être humain », on ne sait plus si l’acteur joue, si le spectateur est au théâtre, s’il peut réagir, plus rien n’est assumé ni assumable puisque toute règle mettrait une barrière entre le spectateur et l’acteur, désignant ainsi le vrai du faux.
Le théâtre n’est plus langage mais médium, l’art n’est plus fiction mais communication, le réel n’est plus multiple mais subjectif. Un petit tour d’horizon aurait permis à Jacques Lacan de rebaptiser le théâtre de la sincérité « théâtre de l’hystérie », puisqu’il repose sur le vieux principe du « désir du désir de l’Autre », c’est-à-dire sur l’abandon systématique des praxis lorsque celles-ci aboutissent à une représentation, sur l’impossibilité de tenir une ligne artistique et théorique, sur le refus de construire un discours sur le théâtre.
Mais le théâtre de la sincérité est plus dangereux qu’il n’en a l’air, dégageant la question du symbolique en art (l’acteur n’est pas signe mais exemple), il refuse le politique pour se réfugier dans la morale. Je dis bien morale car l’éthique comme questionnement de la morale est elle aussi évacuée par les démarches décrétales d’un courant (principalement) esthétique qui ne prône qu’une seule valeur : la projection voire le transfert de l’être à l’Autre comme négation des différences et exaltation des équivalences.
Poussons d’ailleurs plus loin cette manie de la projection et dans le même temps notre comparaison sincérité / hystérie. Le théâtre de la sincérité a l’étrange et exceptionnel don de mimer les pathologies des autres courants, et ce sans complexe puisqu’à l’habitude tout se vaut. Grande aisance donc à s’emparer des esthétiques théâtrales passées (mais en les vidant de leurs propos politiques, de leurs projets théoriques) qui pourraient faire penser au post-modernisme qui décrète la fin de l’Histoire et des idéologies et l’impossibilité d’inventer en art, à cette différence près que le post-modernisme affirme malgré tout une ligne théorique — certes grunge mais qui l’obligera à faire des choix, aussi maigres soient-ils.
Le théâtre de la sincérité n’est même pas là-dedans puisqu’il s’affirme hors de l’art et en l’humain. Il confond l’histoire personnelle, l’empirisme, la sensitivité acquise au cours du temps par ses acteurs et la fiction, l’essai, l’extirpation des viscères. Il est décidé à ce que l’art imite la nature, qu’il la montre dans sa réalité la plus sincère afin que l’homme soit tenu en respect par sa « beauté ». Toute forme esthétique lui paraît donc bonne et utilisable tant qu’elle fait vibrer la petite corde sensible de chacun d’entre nous, tant qu’on peut s’y reconnaître et qu’elle puisse nous aider à construire un avenir meilleur pour nos enfants. L’art propagande du bonheur, de la vie lisse, des images chromos, autant dire l’art devenu leçon de morale destinée à des enfants perdus qui recherchent désespérément le message, le précepte ou la valeur juste qui guidera leur vie déprimée par la lucidité d’une époque où la suspicion est devenue l’écho des échecs passés, tel est le programme de ce nouveau type de théâtre qui risquerait bien d’être le théâtre de demain, si toutefois un excès de sincérité ou de lucidité ne le pousse pas au suicide dans les prochains mois.
Ce texte a paru dans la revue « 1‘acte », publication de l’association « Pour une politique du Jeune Théâtre », Bruxelles, 1994.