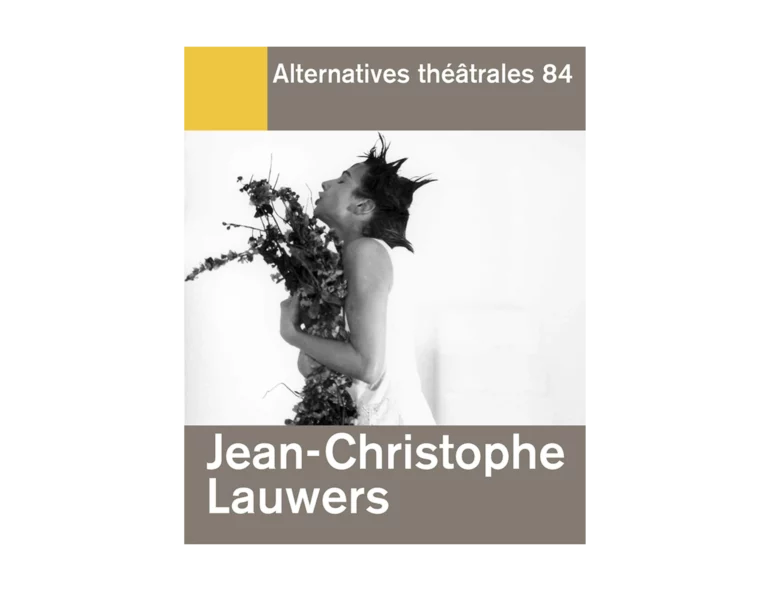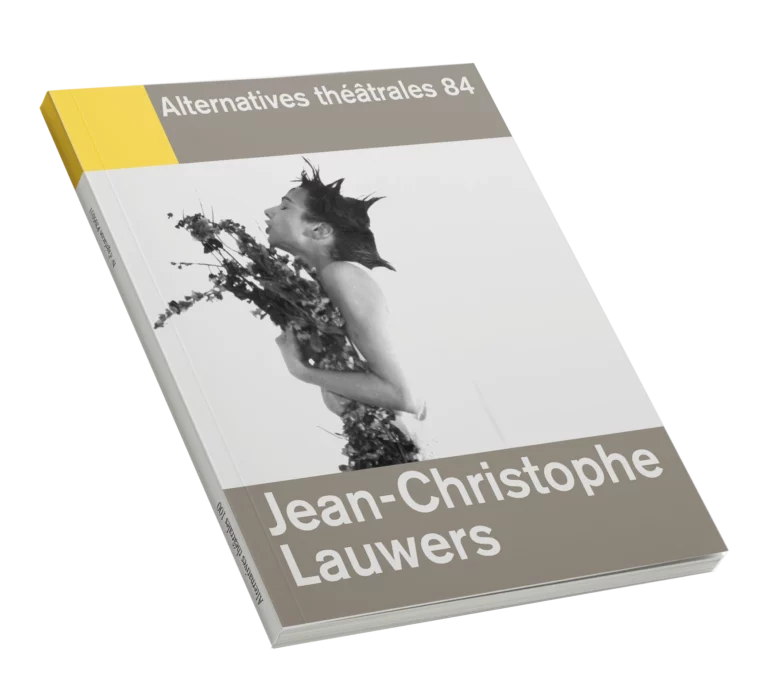IL NE ME PARLERA PLUS : c’est une raison pour le faire entendre. Je ne verrai plus sa longue figure de tige de jonc se balancer au-dessus de moi, se pencher sur moi : c’est une raison pour le désigner au regard. Ces propositions procèdent de l’amitié et du regret. On les déchiffrera comme une volonté de nier la mort en ce qu’elle a de définitivement cruel. Il y a des jours où on aimerait faire tourner à l’envers la roue du temps.
Si douloureuse que soit la perte, elle n’autorise pourtant pas à porter à la connaissance du public ce qui n’aurait de légitimité que dans la sphère privée. Je l’ai connu et fréquenté pendant une dizaine d’années. Nous nous sommes rencontrés à l’INSAS. Mais, ici, quand je parle de Jean-Christophe Lauwers, je parle d’abord d’un écrivain et d’un homme de théâtre, d’un homme d’aujourd’hui.
Encore aux études, il veut créer un théâtre et tout est déjà là : les raisons, la virulence, la prise d’assaut. Le ton est d’emblée donné :
« L’oc (…) fuse
Il détonne
Parce que parmi les porcs
Il dépose sa vitalité
comme un scandale et le scandale comme un fruit mûr
dans ce parc d’âmes laitières — littérature prolixe,
coulis d’ego, troupeau stéatopyge de ceux qui prétendront
toujours nous accointer, nous beurrer dans leur crotte
— et qui paissent en paix à l’abri de leur conscience.
l’oc doit provoquer leur débâcle stomachique !
L’oc est la colle-à-mouche
c’est la cuiller à merde
le touilleur de certitudes
la parole-contre
l’éplucheur de l’oignon métaphysique
l’équarrisseur de la Raison,
et le canon à patates du confort nihiliste. »
(Manifeste pour un oc de l’oc)
La passion éructe. Elle cingle. Il ne s’agit pas, on l’aura compris, d’arriver dans la vie, de se trouver une planque qui flatte l’ego, de faire l’artiste parce que ça distingue. Il ne s’agit même pas de « devenir metteur en scène » avec ce que l’idée peut receler de trajet balisé. La passion réclame son droit à l’existence, c’est tout. L’entrée en théâtre de Jean-Christophe Lauwers est une immersion profonde, une intensité qui se consume au vu et au su de tous dans et par l’écriture. Les mots se mettent en parade, ce sont des feux d’artifice, ils veulent trouer la grisaille par leur insolence. Il faut que le langage fasse déjà percevoir un peu de cette flamboyance qu’on réclame au théâtre. Le geste manifeste est brandi comme un drapeau dans la bataille.
La fonction primordiale du théâtre ? « … provoquer (une haine, un amour, un spasme, une transe, un orgasme, une petite mort, une grande mort, un moyen suicide, un éternuement, un cancer, la peste, la foi, les foies…) ». (Pro-Saignum) Voilà le programme. Tout le monde est averti. On s’embarque dans une affaire de vie ou de mort. Une affaire de survie pour Lauwers, pour le théâtre. Son ambition est aussi ample que cela : sauver le théâtre ! Il y a du romanesque là-dessous. La posture du héros salvateur est indéniablement sollicitée avec ce qu’elle a de bienfaisant pour celui qui s’y coule. On aurait tort pourtant de ricaner sur la démesure de la tâche : je ne suis pas sûr que le théâtre soit en si bonne santé qu’il ne faille pas se préoccuper de sa prochaine disparition. Et s’il ne meurt pas, il ne le devra pas aux seuls effets de la politique culturelle, il le devra aussi aux porteurs de feu qui contre vents et marées veulent l’accomplir. L’accomplir sans justifications, l’accomplir parce qu’ils ne peuvent pas faire autrement ni autre chose. Le théâtre vit quand il s’inscrit dans une nécessité. « Ce qui nous intéresse n’est plus de formuler des mauvaises réponses, mais de reposer convenablement les questions indispensables à notre survie. » (Pro-Saignum)
Le théâtre est l’ennemi du loisir, du passe-temps, de la distraction pendant les temps libres. Le théâtre n’est pas un hobby, un vecteur sympathique de la communication. Sa présence entêtée laisse flotter sur le monde de l’utilitaire et du fonctionnel une rémanence de sacré. Le mot ne doit comporter aucune connotation de sacristie, et s’il y a de la prosternation au programme, c’est seulement devant l’urgence de faire quelque chose de soi-même et du monde. La résonance sacrée sonne dans la partition de Lauwers comme une incitation à engager ses forces, toutes ses forces, ses forces sans restrictions, sans économie, sans prudences, dans la bataille existentielle. Plus clairement encore : « l’engagement artistique touche au sacré quand il devient la seule façon de conférer du sens à cette étrange occupation qu’on appelle vivre. » (Manifeste pour un oc de l’oc) La transcendance n’a pas déserté le monde si un peu d’art le fait encore respirer. La certitude qui meut Lauwers est là. Mais à peine ai-je écrit cela, que je le sens derrière mon dos contester l’utilisation du mot “art”. Il est vrai que le mot “art” est un fourre-tout, une virginité prête à porter qui peut cacher les desseins les plus plats et les plus vils.
Le sacré de Lauwers n’est pas du côté de la culture. Ses colères disent que l’idée, que la culture est plutôt la négation du geste artistique, son embaumement, sa castration. Le sacré de Lauwers rejette le révérencieux, le bon goût, l’ineffable, le joliment céleste. S’il fallait pointer un modèle dans la littérature dramatique, on pourrait dire que c’est le Baal de Brecht dans les premières scènes, quand, poète invité par la bourgeoise, il crache joyeusement dans la soupe. Dans un mélange de timidité, d’effronterie et de maladresses, le sacré de Lauwers veut faire scandale jusqu’à la naïveté. C’est d’abord un appel désespéré pour que les choses, la vie soient un peu moins plates. Et une tentative émerveillée pour rejoindre de grands devanciers, des vénéneux magiciens du langage et de l’art, avec lesquels il puisse faire famille, dont il soit le rejeton légitime.