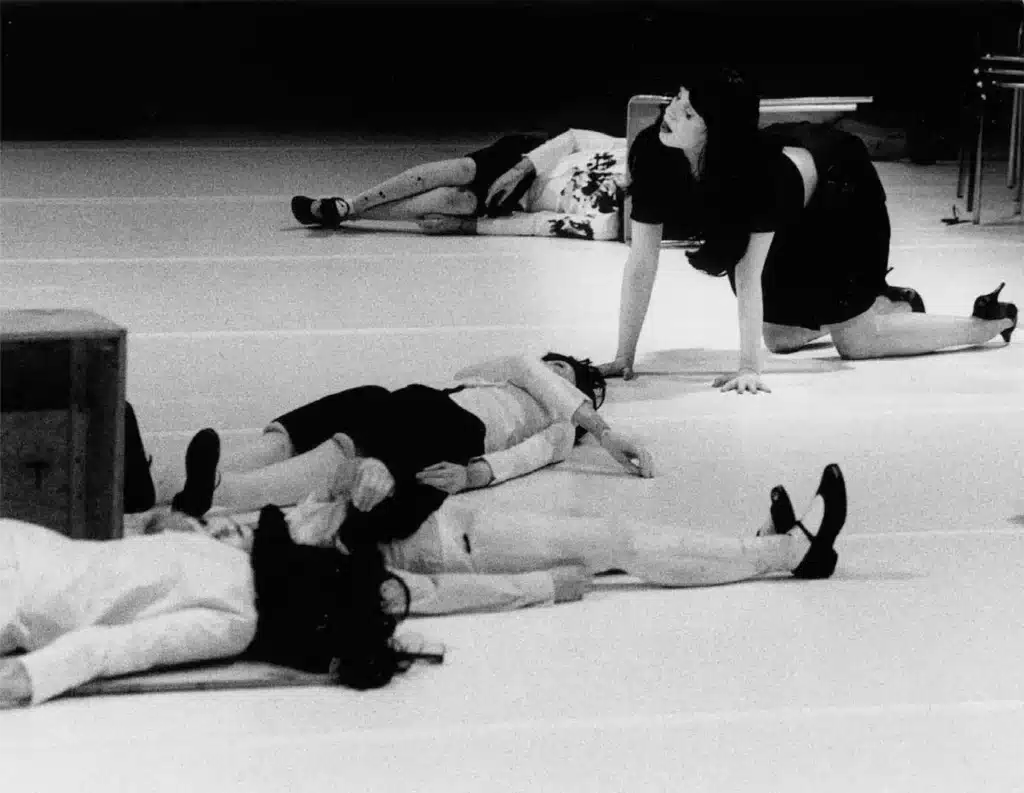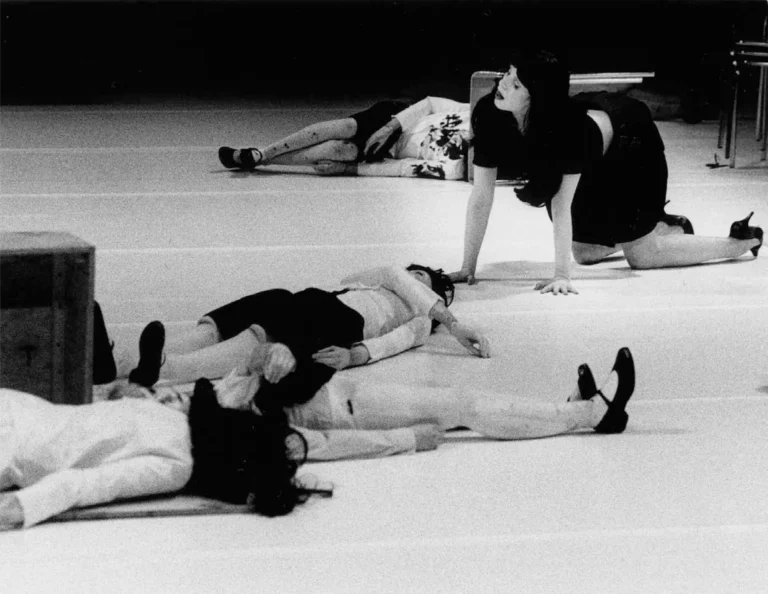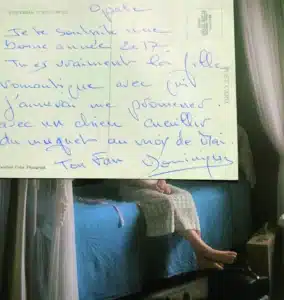SYLVIE MARTIN-LAHMANI : La notion de risque vous semble-t-elle présente ou non sur la scène européenne ?
Gisèle Vienne : Le risque me semble présent sur la scène européenne à condition de comprendre dans la notion de risque celle de l’expérimentation, et cela particulièrement dans le champ chorégraphique.
S. M.-L.: Est-ce que la notion de risque occupe un rôle particulier dans votre pratique ?
G. V.: En assimilant le risque à une action libre, oui. J’ai l’impression de prendre le risque de l’expérience et de la liberté, d’avoir le type de liberté que l’on peut s’accorder dans le travail lui-même, sans doute parce que je considère chaque pièce comme la « dernière ». S’il y a apparemment quelque chose de sombre dans cette posture, elle agit en réalité comme moteur, cela me donne l’impression que je peux tout faire et que je dois tout faire.
S. M.-L. : Est-ce que pour vous la prise de risque s’inscrit d’emblée dans l’élaboration et la production du spectacle ?
G. V.: Bien sûr, le risque de l’entière liberté se joue d’abord là.
S. M.-L.: En prenant des risques, de quoi se libère t‑on : par rapport à soi et son image ? Par rapport au public ? Par rapport à l’institution ?
G. V.: Ma première réaction serait de dire que je ne me préoccupe pas de mon image, ce qui me permet d’exposer ma sensibilité. Je peux tenir compte des lectures faites par les publics – et si vous me posez la question de l’institution, son statut est le même –, mais ces lectures ne conditionnent pas mes choix dans l’élaboration d’un spectacle. Ces lectures permettent le dialogue, mais ne sont pas un audimat, il n’en résulte donc pas forcément une entente. D’ailleurs, c’est bien plus la compréhension qui m’importe. En prenant des risques, j’espère inviter au dialogue et ne pas me soumettre à des désirs préétablis.
S. M.-L.: Par la prise de risque, que voulez-vous briser ? Que voulez-vous atteindre ?
G. V.: Je cherche seulement à vivre et à travailler le plus librement possible. C’est délicat d’éprouver sa liberté, d’exposer ses opinions et sa sensibilité. Prendre des risques sur scène suppose ou entraîne une fragilité d’exposition. Je cherche à interroger ce que nous sommes le plus honnêtement possible, avec la plus grande sincérité, et je crois que c’est ce qui peut caractériser également ce qui me lie à mes collaborateurs artistiques. Si la question est de savoir ce que je veux briser – c’est peut-être ce qui me brise –, la mauvaise foi.
S. M.-L.: Le risque est-il un acte de rupture ?
G. V.: Le risque est un acte de rupture qui s’inscrit néanmoins dans une continuité historique, comme dans l’Histoire du théâtre, de l’art. Peut-on vraiment parler de rupture quand la création a depuis toujours procédé par ruptures successives ?
S. M.-L.: Est-ce que la prise de risque répond à une pulsion ?
G. V.: Dans le travail même, il me semble que la prise de risque répond à une intuition, qui sera ensuite confirmée ou infirmée par la réflexion. Il y a quelque chose de l’ordre de l’expression sensible qui est exposé et qui répond à une pulsion. L’intuition suit une pulsion, et cela m’intéresse de l’exposer si elle me semble intéressante dans la réflexion qui l’accompagne. Dans ce qui motive le travail et le risque qu’il permet, il me semble qu’effectivement la prise de risque est pour moi liée à cette pulsion de mort, comme je le mentionnais en parlant de « dernier spectacle ».
S. M.-L.: La prise de risque s’opère-t-elle de manière différente dans un art collectif ?
G. V.: Dans le cadre d’un travail collectif, c’est l’autre qui vous aide ou vous oblige à définir les frontières de votre liberté que j’assimile à la possibilité de la prise de risque. Mais il n’y a peut-être pas de différence, si l’on considère que les limites de la liberté s’éprouvent de toute façon grâce à l’autre, même dans son absence.
S. M.-L.: Quelle différence faites-vous entre risque et provocation ?
G. V.: Si l’on prend des risques, c’est avant tout pour soi, si l’on cherche la provocation, c’est à l’égard des autres. Dans mon travail, je ne cherche absolument pas à provoquer, au contraire nous avons plutôt le souci de pouvoir inviter le spectateur. Dans notre cas, la provocation pourrait réduire le propos et cacher ce qu’il y a d’essentiel dans le travail. Je crois que l’idée d’invitation dans un sujet délicat peut s’avérer bien plus provocante. J’espère rendre la compréhension possible par l’invitation, et s’il y a provocation dans notre travail, c’est à ce niveau. C’est, par exemple, la compréhension des textes de Dennis Cooper qui est réellement provocante, l’acceptation que l’on peut en avoir, il s’agit alors d’une provocation de soi par rapport à soi. Il semble que les sujets qui heurtent soient souvent liés à l’humain, à son corps, ses désirs et ses aspects les moins acceptables justement. Il m’importe d’inviter le spectateur à essayer de comprendre.
S. M.-L.: Quelle différence faites-vous entre « prendre des risques » et « être en révolte » ?
G. V.: Si « prendre des risques » est une extension ou une expression de la liberté, alors « être en révolte » signifie être en refus par rapport à une norme établie. Les deux sont compatibles, on peut prendre des risques et être en révolte par rapport à des codes ou à des normes. Mais ce n’est pas l’essence de la démarche, et encore moins le but.
S. M.-L.: Le risque est-il forcément visible ?
G. V.: Je ne pense pas. Dans son travail, on peut en effet risquer d’exposer sa propre sensibilité. C’est un risque majeur pour soi, par rapport à soi, et qui peut rester invisible au public. Le risque de la forme, celui que peut repérer le public, n’est certainement pas le plus dangereux.
S. M.-L.: Aujourd’hui, comment un risque peut-il rester un risque ?
G. V.: L’expression de la liberté reste toujours risquée, même si les formes évoluent. Quelles que soient ces formes, c’est l’intégrité des artistes qui est essentielle, et il me semble que c’est cette intégrité qui fait perdurer le risque.