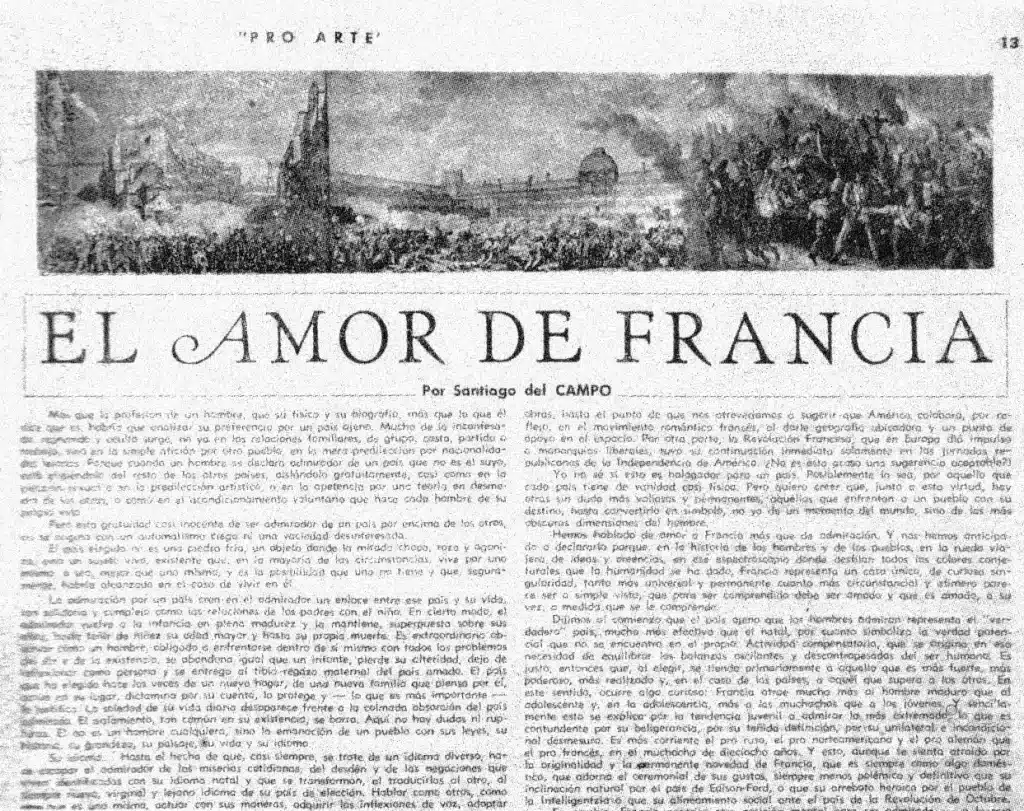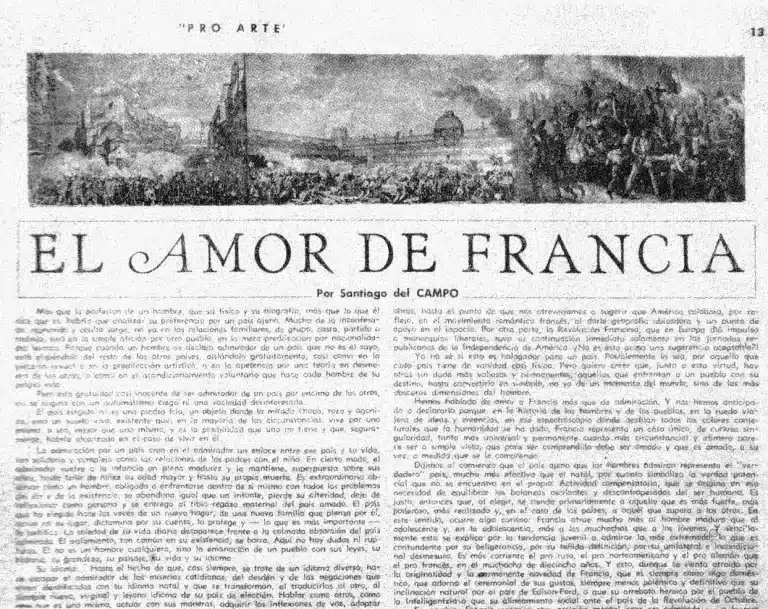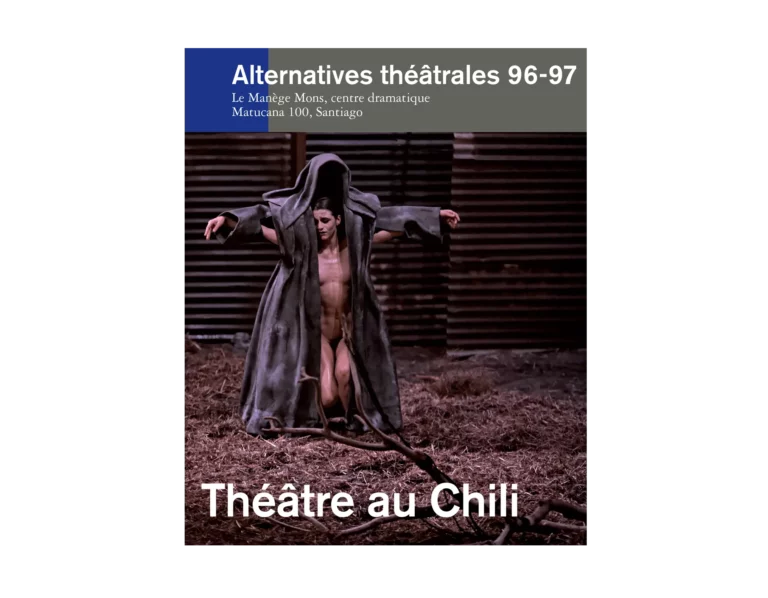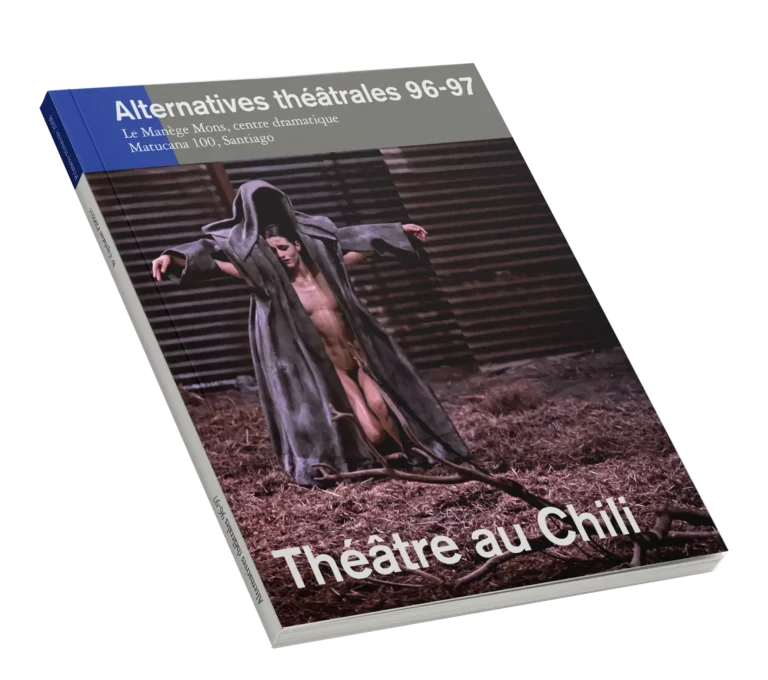DEPUIS LA CRÉATION du Teatro Experimental de l’Université du Chili en 1941 et du Teatro de Ensayo de l’Université Catholique en 1943, en passant par les utopies et le dynamisme ‚politico-social des années 70, la lutte clandestine des années noires de la dictature, jusqu’au nouvel élan d’une jeunesse qui prend le relais avec conviction, le théâtre se hisse au Chili comme un symbole de liberté, un espace dédié à la réflexion et à l’expérimentation, un terrain favorable au croisement culturel. En témoigne la création récente du CNCA, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, ministère dirigé actuellement par la comédienne Paulina Urrutia.
Depuis le retour à la Démocratie en 1990, le Chili connaît une réelle avancée en matière de politique culturelle fortement orientée vers le théâtre : Festival International Santiago a Mil (ex FITAM, 1994), Muestra de Dramaturgia Nacional ( 1995 ), Festival de Dramaturgie Européenne Contemporaine(2001), Dia Nacional del Teatro ( 2007) nouveaux lieux de diffusion comme Matucana 100 (2001) ou le Centra Mori (2005) offrent une palette riche de rencontres et de créations tant sur le plan local qu’international. Le Chili peut désormais s’ouvrir au monde et prétendre à un rôle culturel de premier plan en Amérique latine. Ce dynamisme s’inscrit dans un développement des échanges avec de nombreux pays comme l’Espagne, l’Allemagne, l’Angleterre et la France, tissant ainsi des liens qui, année après année, s’enrichissent et se fortifient.
La France et l’Amérique latine — aux références philosophiques, politiques et culturelles proches — entretiennent une relation ancienne et privilégiée fondée sur une forte confiance. Elles partagent des valeurs communes et la vision d’un monde multipolaire.
Bien que les enjeux de la France y soient considérables ( en matière politique, économique, scientifique et culturelle), certains parlent d’un désengagement et d’un recul de sa présence dans l’ensemble de la région. Il semblerait au contraire qu’au Chili cette présence ne cesse de s’accentuer. Elle va au-delà d’une simple stratégie de diffusion culturelle : il s’agit avant tout d’un engagement pour la promotion et la diversité culturelles, d’un dialogue, voire même d’un « mariage » entre les deux cultures.
Nous pouvions lire dans la revue théâtrale Pro Arte ( 1948 – 19 55) un article intitulé « El amor de Francia ». Un demi-siècle plus tard, cet « amour » presque platonique d’un pays envers l’autre s’est converti en une coopération de longue haleine. L’intensité de cette collaboration reflète l’importance toute particulière du Chili pour la France, en raison de l’ancienneté des liens qui unissent les deux pays comme du développement du Chili au sein de l’Amérique latine. De son côté, la France souhaite s’affirmer de plus en plus auprès du Chili comme la « porte d’entrée » vers l’Union européenne.
Pour reprendre les mots de l’auteur dramatique chilien Benjamin Galemiri, comme dans toute histoire d’amour, cette amitié est en perpétuelle mutation ; elle se « construit, se détruit et se restaure »1 … Portrait d’une coopération artistique en trois mouvements.
Construction : El amor de Francia
Mauvaise surprise pour Sarah Bernhardt lorsqu’elle vint jouer à Valparaiso en 1887 ; elle repartit sitôt dégoûtée du Chili qui, comparé à Buenos Aires, n’était certainement pas à la hauteur : ce n’était alors qu’un passage obligé pour les compagnies qui avaient comme véritable finalité l’Argentine, l’Uruguay ou le Brésil. Mais ces tournées internationales eurent un impact réel sur la scène locale ; il s’agissait d’un air nouveau venu d’Europe en réaction au vieux théâtre espagnol.
Les années 40 furent déterminantes dans la mesure où de nombreuses troupes françaises firent escale à Santiago, ouvrant ainsi la voie aux nouvelles dramaturgies européennes, et de nombreux Chiliens partirent se former en France et en Angleterre, ce qui annonçait les débuts
du Teatro Experimental de l’Université du Chili (actuel Teatro Nacional) et du Teatro de Ensayo de l’Université Catholique (TEUC).
En suivant cette mouvance théâtrale, la revue culturelle Pro Arte fut primordiale à la sauvegarde et à la diffusion du théâtre français. L’artiste, critique et intellectuel français Étienne Frois écrivit de nombreux articles sur le théâtre d’Anouilh, de Sartre, de Claudel, mais se rendit également à Paris où il fit connaître la vie théâtrale chilienne à la Maison de l’Amérique Latine. Avec le fondateur du Teatro Experimental Pedro Orthous, ils sont les premiers à tisser des liens étroits avec la France ; Orthous traduit et met en scène Antigone d’Anouilh, introduit Dullin et Jouvet, crée le Teatro Experimental sous l’influence directe du théâtre français d’après-guerre, dans lequel il puise « une littérature dramatique combative, capable de montrer dans toute sa dureté l’affrontement actuel de l’homme et de la société »2.

Avec la venue triomphale de Louis Jouvet et L’ÉCOLE DES FEMMES en 1942, la présentation au Théâtre Municipal à Santiago de L’ANNONCE FAITE À MARIE de Paul Claudel par le Teatro de Ensayo de l’Université Catholique en 1949, la venue de Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault en 1954 où ils présentèrent un CHRISTOPHE COLOMB de Claudel pluridisciplinaire avec projection cinématographique, orchestre symphonique, ballet et de vraies colombes, la venue de La Comédie- Française en 1948 avec Hurs CLOS et LES FEMMES SAVANTES en 1959, la visite de Camus en 1949 ou celle de Marceau dès 1961, la France s’impose désormais comme un pôle incontournable de la création théâtrale et le Chili comme une escale de plus en plus recherchée.