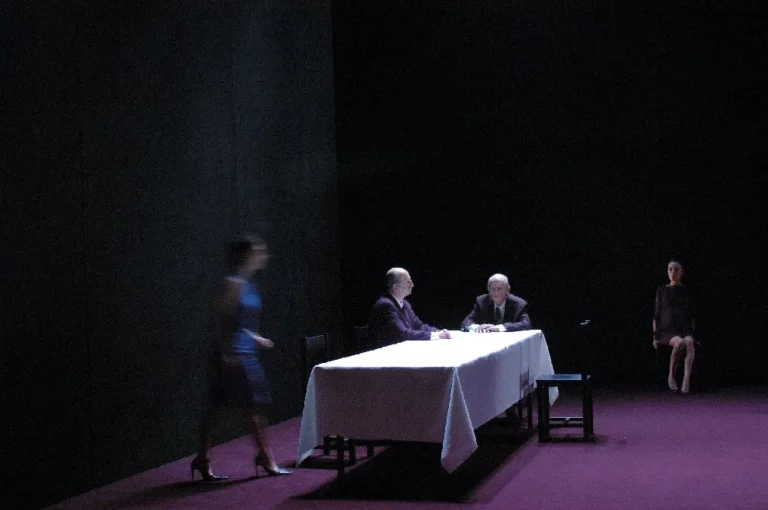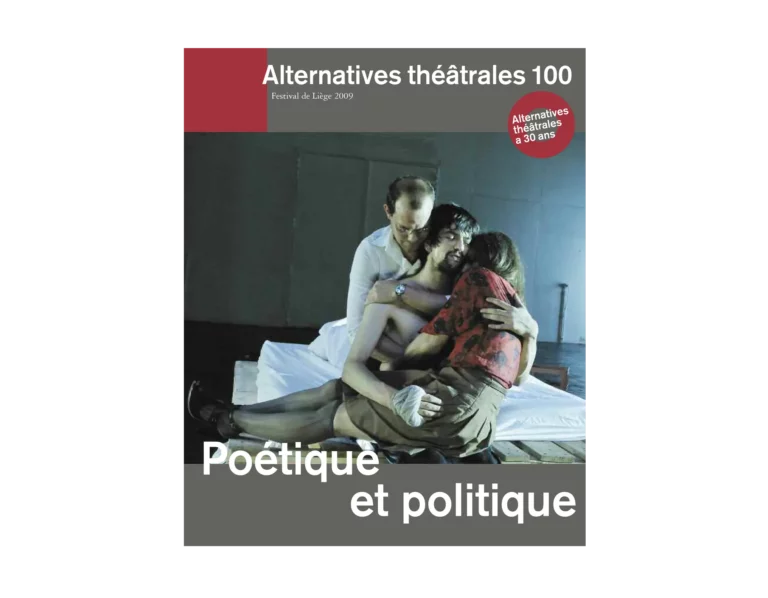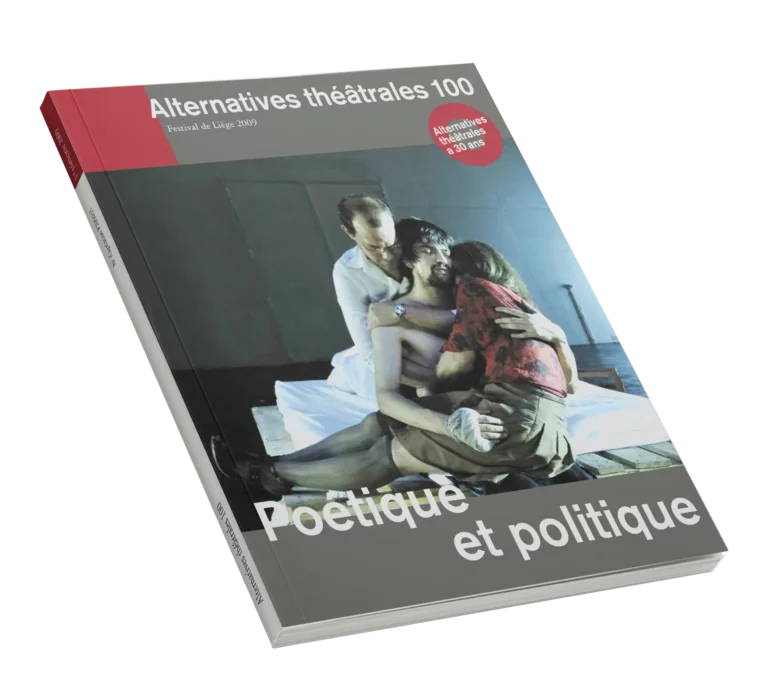JOËL POMMERAT définit sa pratique du théâtre comme une tentative « de capter le réel et de rendre le réel à un haut degré d’intensité et de force »1 ; et de poursuivre : « on dit souvent que mes pièces sont étranges. Mais je passe mon temps, moi, à chercher le réel »2. C’est pourtant bien l’étrangeté de ce théâtre qui marque à première vue, dépassant largement tout ce qui en lui pourrait sembler relever d’un simple « réalisme ». C’est que le « réel » dont son théâtre aspire à rendre compte est un réel complexe, comme il le précise lui-même : « La réalité, le réel, ce n’est pas forcément […] ce qui apparaît, ce qui est le plus visible. Quand je parle de réel, […] je parle du rendu d’une expérience humaine […]. La réalité pour moi est composée à la fois de ce qui se donne directement et de ce qui se crée par l’imaginaire, par notre mental, par nos
représentations…»3. Un réel vécu et perçu, pourrait-on dire, dont la représentation aurait la même densité imaginaire que celle que peut avoir un personnage de roman dans l’esprit de son lecteur, « plusieurs éléments se mêl[ant], se superpos[ant] […] pour composer un être, à la fois vrai et multiforme [ayant] la juste complexité des choses et de la relation que nous entretenons avec le monde qui nous entoure, c’est-à-dire floue, ambiguë »4 . Ce réel ( et donc sa représentation ) mêle ainsi l’objectif et le subjectif, l’imaginaire (qu’il soit individuel ou collectif), il inclut sa saisie par un ou des sujet(s) percevant, et le travail des cadres de perception à travers lesquels il se donne. Et c’est sans doute ce qui conditionne une bonne part de la singularité de l’esthétique scénique de Pommerat : entre « réalisme » et « étrangeté », cette théâtralité met en jeu la question de la, et de sa, perception.
Un cadre de perception ambigu
Séquences oniriques, représentations de phénomènes paranormaux, interrogation par la narration de la véridicité même des scènes représentées sur le plateau, et par le plateau de la crédibilité des faits évoqués par le récit…: c’est bien alors la part de l’imaginaire projeté sur la « réalité » scénique représentée qui est pleinement en jeu ; et c’est autour de l’implication scénique d’une perception singulière, disons subjective, que l’ambiguïté semble se nouer dans ces spectacles, entre la représentation d’une réalité factuelle « objective » et celle d’une réalité perçue à travers le filtre (l’imaginaire) d’une conscience interne à la fiction ( ou de plusieurs ) – c’est-à-dire la restitution, dans et par la représentation, du « rendu d’une expérience humaine » dans sa nature intrinsèquement « ambigu(ë)», pour reprendre les termes de Pommerat cités plus haut. De cela, AU MONDE est particulièrement symptomatique. Il est frappant de voir combien dans cette pièce les personnages projettent constamment sur les autres l’image mentale qu’ils ont d’eux ; c’est en particulier (mais pas seulement) le cas de la « seconde fille », qui se lance fréquemment dans de longs commentaires où elle affirme ses convictions, sa vision du monde et son interprétation de la situation – dans sa manière de miner ainsi le dialogue réaliste par le sur-développement de certains points de vue subjectifs, la pièce est d’ailleurs très proche de son palimpseste tchékhovien, LES TROIS SŒURS. C’est alors au spectateur de confronter (que ce soit selon un principe ironique de contraste ou au contraire dans la contamination d’une croyance, ou dans un jeu permanent entre les deux) ces projections internes à ce qui est montré sur le plateau : le corps vieilli et fragile du père au discours sur sa solidité et sa maîtrise de chef de famille et d’industrie, les errances d’Ory à travers la maison aux espoirs qui sont placés en lui ou au soupçon insidieux qu’il assassinerait des femmes dans les rues la nuit tombée, les passages de la femme embauchée et muette… Cette omniprésence de la projection imaginaire d’un ou plusieurs personnages sur un autre prend une dimension particulièrement extrême avec le personnage de « la plus jeune », adoptée par la famille après le décès d’une troisième sœur, Phèdre : confrontée au regard de ses sœurs qui ne cessent de voir en elle la mémoire de la disparue, de voir en elle comme leur sœur-fantôme5 ( la seconde fille : « tu es venue nous enlever un peu de la souffrance de l’avoir perdue sans l’avoir perdue tout à fait, tellement tu paraissais elle, […] tellement tu étais Phèdre… Nous t’avons vue et nous avons vu notre sœur, nous avons vu notre sœur Phèdre…»)6, face à une telle perception/projection à proprement parler aliénante pour elle, elle ne cesse de se raccrocher à l’affirmation de sa propre identité : « Je suis moi. […] Je lui ressemble, je suis comme elle, mais je ne suis pas elle, c’est ça qui est important » 7.
Cette question est d’ailleurs thématisée dans les pièces de la trilogie constituée par AU MONDE (2001), D’UNE SEULE MAIN (2005) et LES MARCHANDS (2006)8. Elle l’est, même si discrètement, à travers les éléments qui semblent revenir d’une pièce à l’autre : une guerre, ou une série de meurtres de femmes qui pourraient bien être les mêmes, mais apparaissant dans chaque pièce comme considérées selon différents points de vue – tout comme la trilogie, en représentant successivement une famille de la grande bourgeoisie (AU MONDE), des détenteurs du pouvoir politique (D’UNE SEULE MAIN ), puis des personnages du monde ouvrier ( LES MARCHANDS ), balaye également différents points de vue et donc différents imaginaires sociaux. Elle l’est surtout, à l’intérieur de chaque pièce, à travers la présence insistante de certains motifs, comme celui du rêve (AU MONDE) ou celui de l’hallucination (qui est au cœur des MARCHANDS ), symptomatiques de la manière plus globale dont le surplomb de la représentation réaliste se trouve subverti de l’intérieur par
le jeu sur les modes de perception à travers lesquels il se donne. C’est en cela que ce théâtre, par plusieurs aspects, se rapproche (dans la trilogie, mais aussi de manière plus générale chez Pommerat –pensons à JE TREMBLE ) du fantastique, en ce que celui-ci repose justement sur l’ambiguïté du régime selon lequel doit être appréhendée la logique qui régit le monde fictionnel. Car Pommerat se plaît à produire dans ses pièces des glissements du cadre d’appréhension que le spectateur peut se construire de ce qui lui est représenté. AU MONDE, par exemple, est comme troué par des scènes étranges, dans lesquels la « femme embauchée dans la maison », figure qui ne parle que quelques mots d’une langue incompréhensible et qui est perçue de plus en plus par certains des autres personnages comme inquiétante, chante en playback (ou encore cette scène où le fils cadet, Ori, lui tient un long discours où il lui déclare la guerre en laissant entendre qu’elle serait le Diable, tandis qu’elle joue avec ses cheveux comme pour en faire des cornes…); il sera en fin de compte (mais en fin de compte, seulement ) suggéré que ces scènes correspondraient à des rêves de la seconde fille9 . Dans D’UNE SEULE MAIN, c’est toute la fin de la pièce qui bouleverse radicalement le cadre de réception de l’histoire qui pouvait être le nôtre, les toutes dernières séquences faisant réapparaître le père mort, et redonnant sa main au fils mutilé… Quant aux MARCHANDS, la question de la perception s’y trouve au cœur même de la pièce : au cœur de son sujet, tout d’abord, au premier chef avec les visions de son héroïne, cette femme sans travail et endettée qui n’a pas « le sens des réalités », dit-on, qui communique avec les morts qui seuls, selon elle, ont « une existence vraie, une vie réelle », qui retrouve, reconnaît et recueille un fils âgé dont personne n’avait jamais entendu parler et à l’identité duquel personne ne croit vraiment, qui voit lui apparaître ses parents décédés et qui tuera sur leurs conseils son jeune enfant pour éviter la fermeture
de l’usine qui fait vivre une bonne partie de la région ; au cœur des principes de représentation qui sont les siens, puisque Pommerat choisit de montrer sur la scène les phénomènes paranormaux – une scène de spiritisme, avec sa table qui s’élève dans les airs, ou les apparitions des parents, surgissant de la télévision ou apparaissant dans la cave ou sur un meuble… Elle l’est aussi, et peut- être surtout, dans le principe de narration rétrospective qui régit la pièce ( le récit, qu’accompagnent les séquences scéniques, est fait par une amie de l’héroïne qui a été témoin impliquée de son histoire, et qui a cru elle-même alors voir les apparitions survenues à son amie), puisque celui-ci conjugue les incertitudes propres à la remémoration au questionnement incessant de la narratrice sur la réalité ou non de ce qui s’est passé, de ce qu’a vu son amie et de ce qu’elle a elle-même alors cru voir – redoublant ainsi les questions posées par la représentation scénique des apparitions et supposées hallucinations.