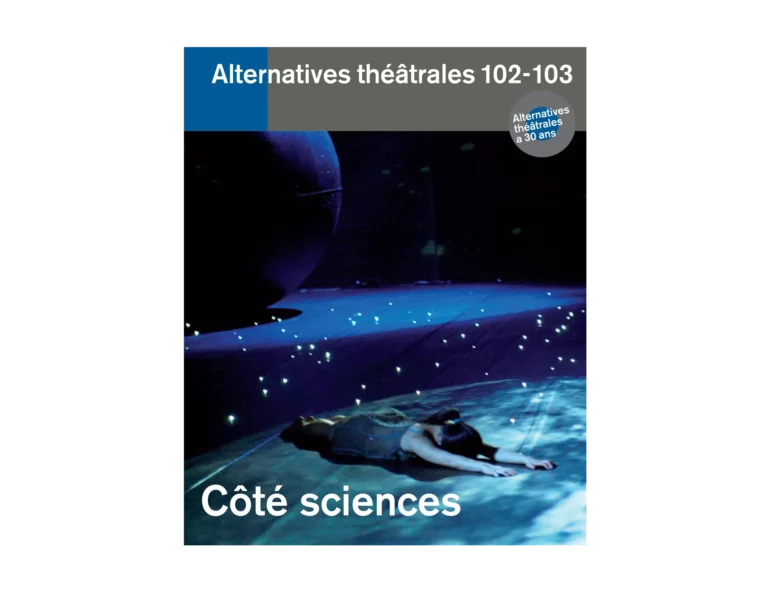LA SCÈNE se passe au café qui fait le coin des Ateliers Berthier après une matinée où l’on a donné TOURNANT AUTOUR DE GALILÉE de Jean-François Peyret.
La première : Non, là je suis très déçue. Il tourne vraiment autour du pot.
Le deuxième : Évidemment, c’est le titre : AUTOUR DE GALILÉE. Qu’est ce que tu voulais qu’il fasse de plus ? Un cours de physique ? Un résumé de Biagioli ? Du Schaffer ? Une énième reprise du Brecht ?
La première : Si c’est pour ne pas parler de Galilée, qu’il le laisse tranquille ! S’il en parle, qu’il rentre dedans au lieu de tourner autour.
Le deuxième : Et c’est quoi, mademoiselle, rentrer dedans ?
La première : Mais nous faire entrer dans le laboratoire, tout simplement. Ça ressemble tellement aux planches. Comment peut-on rater une telle occasion ? Pour moi, c’est incompréhensible.
Le deuxième : J’avoue que le rapport m’échappe.
La première : Mais si ! Au laboratoire aussi, il faut dramatiser, il faut convaincre, il faut rendre les preuves aussi saillantes que possible.
Le deuxième : On ne va pas au théâtre pour être convaincu, on y va pour être diverti !
La première : Tout le laboratoire vise à étonner, rien de plus divertissant. « Plaire et instruire » ! Tu oublies « instruire ».
Le deuxième : Nous étonner de quoi ? Des mouvements des planètes ? Des microbes ? De l’électricité ? Ça sent les bancs de l’école à plein nez.
La première : Quand les objets de science sont tout cuits, tout faits, oui. Mais au laboratoire, ce sont de vrais personnages : il leur arrive des drames affreux ; ils subissent des épreuves atroces ; ils se transforment ; ils n’étaient rien : ils deviennent tout. C’est passionnant. C’est un vrai opéra ce qui leur arrive.
Le deuxième : Mais ce ne sont pas des humains ! Comment veux-tu qu’ils nous intéressent ? Ou alors tu les caricatures, tu en fais des pseudo-humains.
La première : Tu n’as jamais entendu parler du théâtre d’objets ? Les objets, ce sont eux les personnages principaux. Je ne vois pas pourquoi il n’y aurait que les humains qui devraient nous intéresser.
Le deuxième : Mais même dans les marionnettes, ce sont toujours des formes humaines et des situations humaines qui nous séduisent.
La première : C’est tout le contraire. Rappelle-toi le Paradoxe de Diderot, ce ne sont jamais des humains qu’on vient voir au théâtre, mais des types : le Tartuffe et pas un tartuffe. Au laboratoire comme au théâtre, ça n’est jamais des humains qu’on observe, mais des personnages conceptuels soumis à des conditions extrêmes, artificielles.
Le deuxième : Tu veux nous mettre dans un simulateur de vol, faire vibrer nos sièges comme dans la géode… si c’est ça pour toi le théâtre !
La première : En tout cas ce sont des lieux, le théâtre et le laboratoire, des lieux dédiés, délimités, précis, où l’on maîtrise tous ses gestes, qui suivent une chorégraphie soigneusement répétée. La science, ce ne sont pas des idées, ce sont des pratiques.
Le deuxième : Mais tout est pratique ! Les cuisines de restaurant aussi, les salles d’opération, tout, toutes les pratiques professionnelles sont des théâtres à ce compte. J’en ai assez des pratiques. Je veux du drame, des idées peut-être, mais d’abord du drame.
La première : Relis Brecht, le théâtre expérimental, c’est celui qui fait du spectateur un observateur, c’est un outil de connaissance, d’analyse, d’action !
Le deuxième : Le théâtre expérimental ce n’est pas le théâtre de l’expérience. Tu te contentes de simples rapprochements… la paillasse et les planches, ça n’a rien à voir.
La première : Et pourquoi ? Le dispositif de preuve est le même : il faut éclairer, faire saillir, faire voir, faire converger l’attention, intéresser, pointer du doigt, rapprocher, faire sentir, rassembler autour des épreuves en cours. Et tu me parles de cuisine ! La preuve qu’on peut mettre la paillasse sur les planches, c’est Dickinson, un artiste anglais extraordinaire, il a reconstitué sur scène l’expérience de Milgram.
Le deuxième : Milgram ? Pas aussi connu que Galilée.
La première : Mais si, tu sais bien, c’est son expérience qui nous a fait croire qu’on pouvait transformer en bourreau n’importe quelle personne ordinaire en lui faisant lâcher des courants électriques sur un pauvre bougre, pour qu’il apprenne. Et bien, Dickinson l’a mise en scène exactement comme elle a été faite par Milgram, et ça donne une pièce stupéfiante – elle dure une journée.
Le deuxième : Et tu l’as regardée jusqu’au bout ?
La première : Pas tout à fait, c’est vrai.