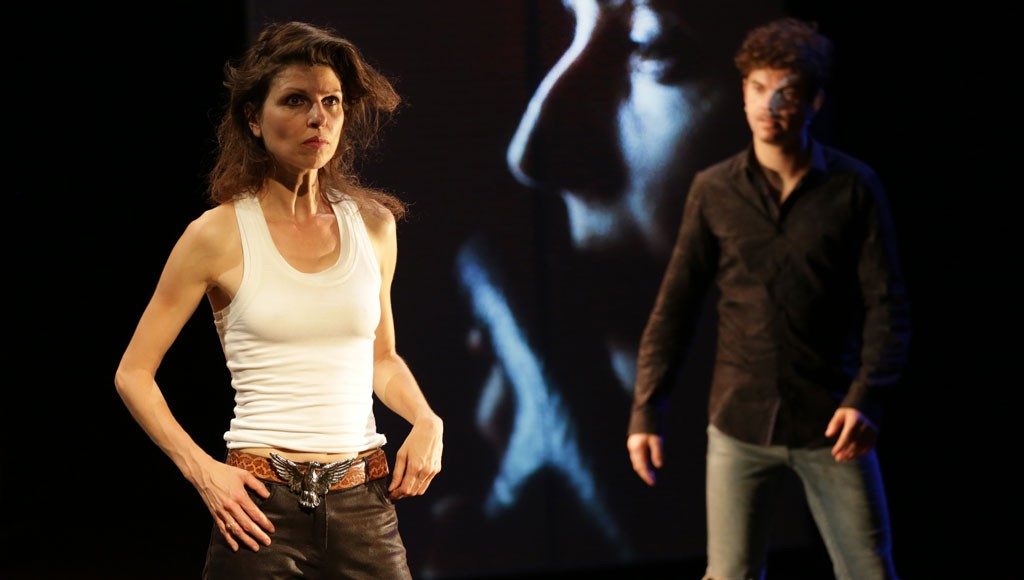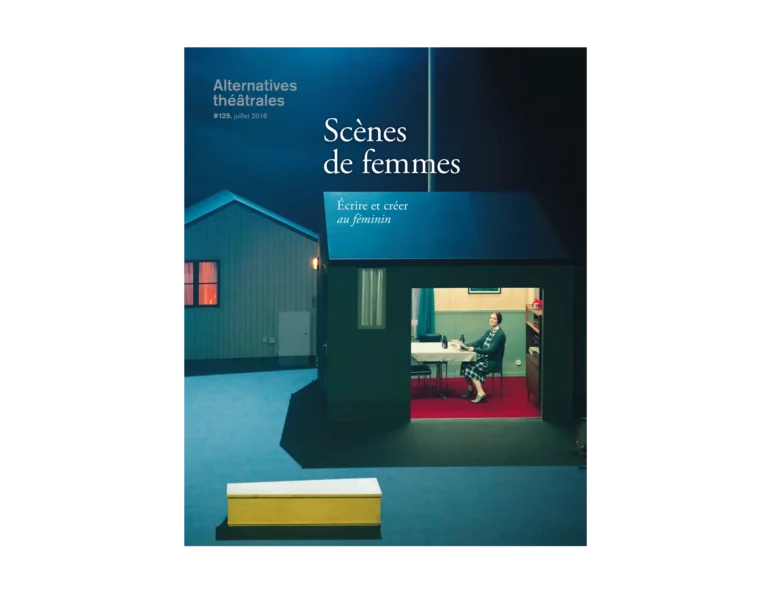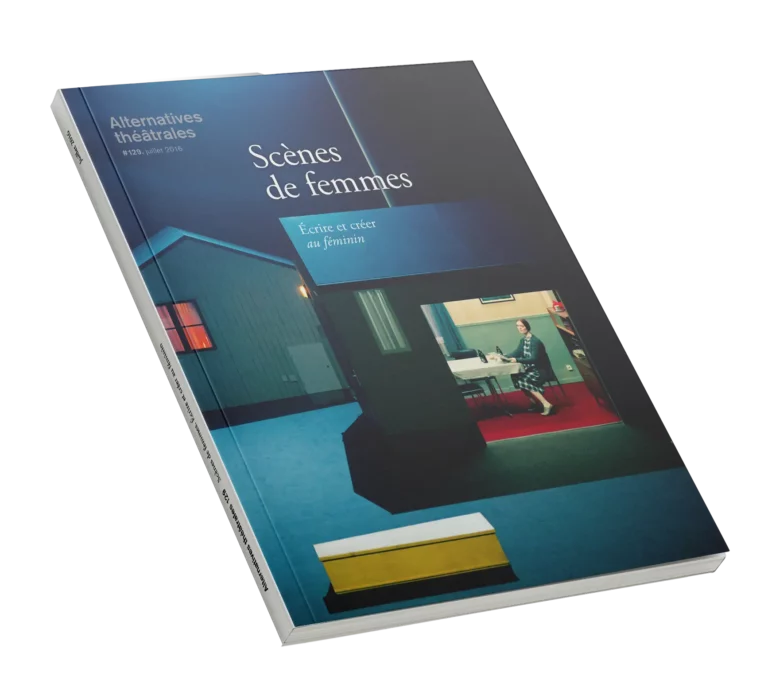Du plus loin que je me souvienne, la question « qu’est ce que tu veux faire plus tard ? » qu’on vous pose enfant m’avait jetée dans un grand désarroi. J’avais cherché confusément la réponse du haut de mes cinq ou six ans dans un des quelques livres qui se trouvaient à l’époque chez mes parents ; c’était un guide des prénoms. Ce guide recelait la grande magie de contenir le mien de prénom, Selma, chose déjà suffisamment rare pour que je confère immédiatement à l’ouvrage une autorité certaine.
Si le livre contenait mon prénom, un prénom que j’entendais peu et qui ne semblait être inscrit nulle part, dans aucune petite ni aucune grande histoire, alors ce livre devait avoir le pouvoir de m’apprendre quelque chose au moins sur mon identité, au mieux sur ma destinée. Dans ce guide, le prénom Selma renvoyait à un seul personnage célèbre : Selma Lagerlöf, auteure du Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède et première femme au monde à reçevoir le Prix Nobel de littérature. Le guide mentionnait aussi « la petite Selma peut être attirée par les métiers d’hommes, notamment celui de pompier ». À l’école primaire, nous sommes allés visiter la caserne des pompiers, et je me rappelle parfaitement le vertige qui m’a saisie à peine quelques échelons gravis, et aussi cette vision d’en bas de l’extrémité de la grande échelle, qui me semblait sans fin, perdue dans les nuages, noyée dans le ciel. Je décidai à cet instant de ne pas devenir pompier. De la prophétie du guide des prénoms, restait alors à mon esprit les termes « métiers d’hommes », et l’image d’un Niels Holgersson volant sur une oie sauvage.
Plus tard, le théâtre est entré dans ma vie. Je n’ai plus aucun souvenir de la porte par laquelle il est entré ; il a été toujours été imbriqué à mon existence, conditionnée sans doute par le goût du drame cher à ma famille.
Le théâtre s’est révélé la suite logique de mon parcours mais ne s’est pas pour autant inscrit dans une simplicité logique de parcours. J’étais une élève brillante. Exprimer le souhait de poursuivre une scolarité plus littéraire que scientifique provoquait déjà un premier deuil pour mes professeurs. Quel gâchis d’être douée pour les études et de s’orienter vers le domaine le moins rationnel et le moins noble… Et en même temps, on comprenait ma décision : j’étais une fille, et les filles se destinent aux carrières dites « sensibles », c’est bien connu.
À cette époque, je me souviens le bonheur d’avoir affirmé mon choix, et pourtant le doute commençait à m’envahir : je ne savais plus si ce choix était l’expression d’une liberté ou au contraire celui d’une aliénation déterminée par mon genre. J’étais une fille, et les filles avaient à cette époque (pas très lointaine) la réputation de fuir la rugosité du scientifique pour laisser s’exprimer leur sensibilité naturelle dans les matières littéraires. Au lycée, une fois assise dans une classe littéraire à composition exclusivement féminine, naquit sans que je le sache le début d’un long conflit entre mon genre et ma pratique professionnelle et artistique. Un conflit qui se poursuit encore aujourd’hui et peut-être ne trouvera jamais de fin.