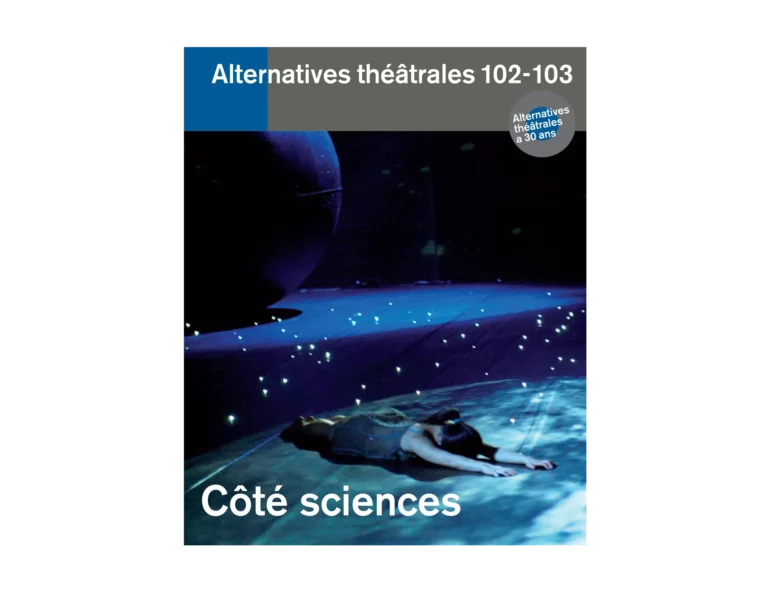MICHEL DEZOTEUX, Marcel Delval et Philippe Sireuil avaient trente ans lorsqu’ils ont fondé le Théâtre Varia. En marge de la parution du numéro hors série de notre revue consacré à l’histoire de ce théâtre 1, une table ronde publique avait lieu le vendredi 2 octobre 2009.
Réunissant une dizaine de jeunes metteurs en scène trentenaires face à plusieurs des fondateurs du lieu, la rencontre avait pour ambition de mettre à jour les préoccupations artistiques et les enjeux institutionnels transmis d’une génération à l’autre.
On trouvera ici un ensemble d’instantanés, formant un aperçu des sujets abordés ce soir-là…
Antoine Laubin : Dans un texte récent 2, notre collaboratrice Nancy Delhalle recensait trois caractéristiques nouvelles des metteurs en scène des années deux mille : une émergence dans un contexte de production où une certaine mécanicité existe, due à des réformes structurelles du secteur ; un souci « thématique » laissant souvent davantage de place à la problématique de la transmission qu’à celle de l’inaugural ; la fin de la relation dialectique entre le texte et la scène comme « enjeu majeur où s’élabore la signature du metteur en scène ». Commençons par le dernier élément cité. Pensez-vous que la relation texte – scène ne constitue plus l’enjeu majeur de votre travail ?
Anne Thuot : À l’intérieur du Groupe Toc, même si les rôles sont définis, tout se décide collectivement. C’est cette expérience commune, la théâtralité que nous mettons en place petit à petit, qui détermine notre désir de travail.
Jeanne Dandoy : Je n’ai jamais monté d’autres textes que les miens. C’est mon désir de parler d’un sujet qui est déterminant et j’utilise l’écriture comme mon outil d’actrice ou de mise en scène. Je pense à un spectacle avant de penser à un texte.
Sabine Durand : Pour ma part, j’ai travaillé sur base des textes d’auteurs. Au bout du travail, il me semblait qu’il s’agissait plus d’un processus de trahison de cet auteur que de vassalisation de son propos. Il s’agissait d’être au plus près d’un auteur pour mieux le trahir, pour qu’il s’agisse d’une belle trahison, ce qui implique un rapport de proximité et de connaissance de cet auteur. En ce sens, il peut y avoir de la « réécriture » même si on ne change pas le texte.
Aurore Fattier : Je partage ce point de vue. J’ai monté jusqu’ici des textes classiques et je vais bientôt changer de problématique puisque je m’attaque à de l’adaptation, notamment romanesque. Je m’aperçois que monter PHÈDRE s’inscrivait dans une logique de formation continue au sortir de l’école. Le cadre classique me servait de filet dans une sorte d’«entraînement ». À l’INSAS (école de théâtre de Bruxelles), on travaille beaucoup sur le texte, on nous apprend à être indépendant vis-à-vis de lui. Si je n’avais pas vécu le choc entre une certaine tradition française et l’enseignement reçu à cette école, je n’aurais pas fait les choses de la même façon. Ma mise en scène de PHÈDRE s’inscrit aussi en réaction à la manière dont d’autres montent PHÈDRE en France, Chéreau par exemple.
Selma Alaoui : Le texte est le matériau qui vient concrétiser un désir de parole. On cherche le texte le plus proche de ce désir et s’il ne convient pas totalement, on le manipule, on le tord. L’enjeu n’est pas de donner une nouvelle version de tel ou tel texte mais de se l’approprier. Ce n’est sans doute pas une nouvelle chose dans l’histoire de la mise en scène. Ce qui change peut-être, c’est la hiérarchisation du travail qui diminue. Les acteurs ou techniciens sont de moins en moins les exécutants des idées du metteur en scène.
Denis Laujol : Mes envies de mise en scène naissent toujours de lectures. Je ressens une urgence et une nécessité à monter un texte quand sa lecture fait écho à une préoccupation intime pour moi et qu’elle fait sens pour aujourd’hui. C’est aussi bête que ça. Étant d’abord comédien, je suis habité en premier lieu par l’envie de transmettre une parole.
Antoine Laubin : On peut relever que les metteurs en scène présents aujourd’hui sont pour la plupart également des acteurs. Ce « cumul » était nettement plus rare il y a trente ans.
Denis Laujol : C’est certainement un phénomène générationnel. Le rapport de travail décrit par Selma provoque la fin de la sacralisation du metteur en scène.
Combats…
Yannic Mancel : On retrouve dans les propos tenus ici ce carburant qu’est le meurtre du père. Pour tuer le père, il faut le fantasmer. Quand j’entends parler de trahison, j’entends donc aussi le fantasme de la fidélité, qui n’existait déjà plus dans les précédentes générations. Tout acte de mise en scène est d’un certain point de vue sacrilège. Il serait intéressant de vous entendre à propos de ce qui a lieu sur les scènes institutionnelles aujourd’hui, sachant que ceux qui les occupent ont été eux-mêmes les meurtriers de la génération d’avant. Quel est l’enjeu du combat, réel ou fantasmatique, entre la génération d’aujourd’hui et celle des pères, qui sont aussi des parrains puisqu’ils vous invitent dans leurs lieux ou ont été vos professeurs (ce qui, bien entendu, complique la donne)?