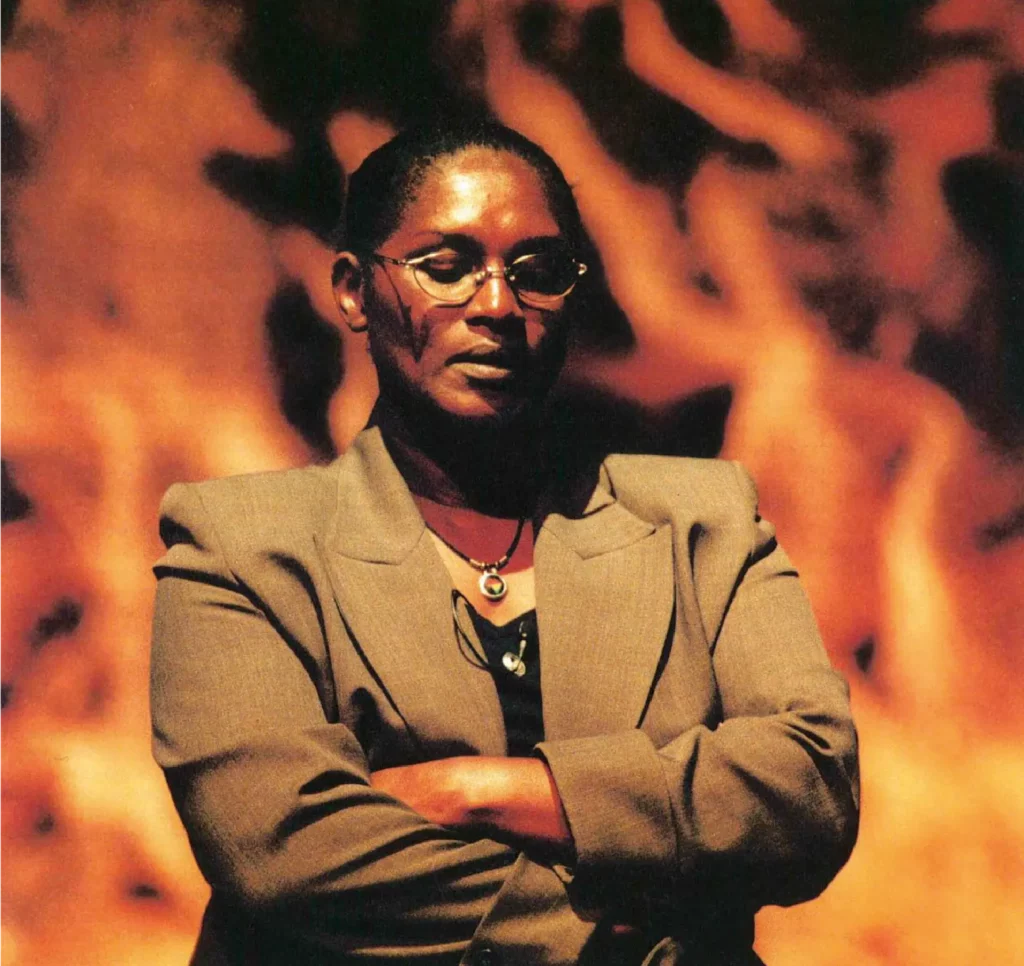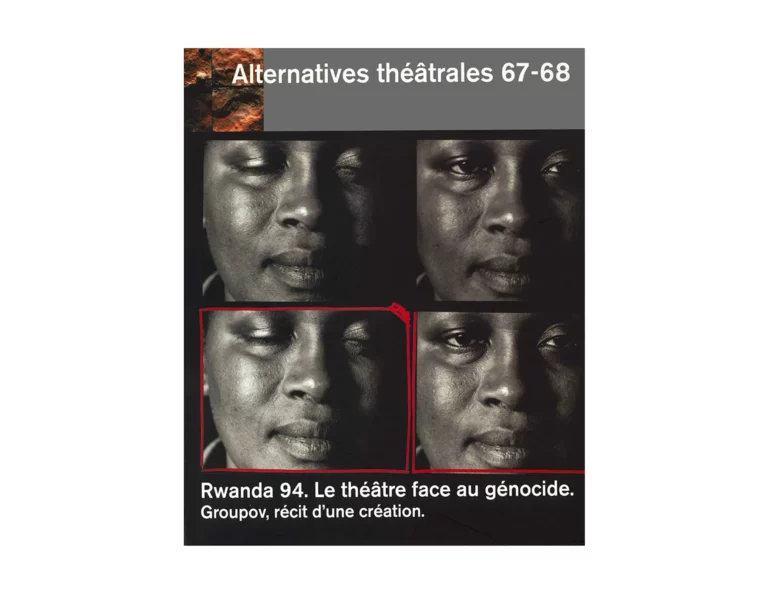Claire Ruffin : Il s’agit pour le Groupov de nous faire ouvrir les yeux sur le génocide qui a eu lieu au Rwanda, en 1994. Pensez-vous que le théâtre soit à même de parler du monde contemporain ?
Patrick Le Mauff : Mais il ne devrait faire que cela !
Le théâtre – je veux parler de ses praticiens en général – est souvent complexé par d’autres formes d’art auxquelles il prête des qualités plus grandes, plus pertinentes, pour parler du monde contemporain.
Que ce soit le roman, le journalisme, le cinéma, ou la photographie, pour ne citer que les plus visibles. Cette soirée nous en offrait un singulier démenti.
La notion de contemporain se résume souvent, pour moi, en tant que spectateur, à quelques questions simples : qu’est ce que je fais là, qu’est-ce que j’écoute, et pourquoi est-ce que je reste ? Qu’est-ce qui légitime ma présence ? Là j’avais une belle réponse.
Le théâtre était à une place où on ne le voit que trop peu souvent. Et cette légitimité ne se résume pas au sujet, le génocide, mais à la pratique théâtrale qui était mise en œuvre.
C. R. : Cette pratique est troublante, car pour évoquer le monde, le Groupov laisse entrer témoignages et documents réels sur la scène. Doit-on parler pour autant d’« intrusion de la réalité » au théâtre ?
P. L. M. : En apparence oui, puisque nous avons des documents d’archives, une personne qui raconte sa véritable histoire. Tout cela donne l’apparence du réel, du vécu.
Mais j’ai envie de dire par provocation qu’il n’y a aucune intrusion de la réalité, puisque nous n’en avons que des représentations.
Notre temps appelle tellement à l’effondrement de la frontière entre la réalité et ses représentations que nous avons tendance à ne plus faire la distinction entre le réel et ses miroirs.
C. R. : Est-ce le cas de Yolande quand elle nous livre sur scène le récit de sa propre vie ?
P. L. M. : Mille choses vous passent par la tête pendant ce premier monologue. Une me revenait sans cesse : voilà comment il faut jouer au théâtre, avec intensité et retenue. Une autre aussi : comment fait-elle pour raconter cela tous les soirs ? J’avais en même temps la réponse, car le metteur en scène ne la laisse pas désarmée. Elle se trouve d’ailleurs confrontée aux mêmes questions que les acteurs ou actrices : comment faire en sorte que son émotion ne passe pas devant le récit, comment retenir l’émotion pour que nous puissions entendre ? Ayant vu le spectacle deux fois j’ai pu constater ces
infimes variations.
C. R. : Pourquoi ce témoignage réel au théâtre n’est-il pas insupportable ?
P. L. M. : Très précisément parce que le frottement entre le réel – c’est son histoire – et le travail théâtral était exposé, mis à nu. Mis en abîme aussi, puisque nous prenons comme une évidence le fait qu’elle dise au début : « je ne suis pas comédienne », et pourtant Jacques Delcuvellerie l’a fait travailler (voir « Sur le travail avec Yolande »). Ce n’est donc qu’une demi-vérité sur son statut pendant la représentation.
Que son témoignage nous retourne et nous vrille, nous déséquilibre, comme toute exposition de douleur, est indéniable. Mais ce n’est pas insupportable car il n’y a pas volonté de tromperie.
C. R. : Aujourd’hui nous entendons sa douleur, mais à l’époque nous n’avons pas entendu les cris d’alarme. Ce spectacle n’a‑t-il pas pour fonction de nous question- ner sur la façon dont nous percevons la réalité dans notre vie quotidienne ?
P. L. M. : Bien sûr, je crois que c’est l’objet même du spectacle et de sa narration. Prenons l’exemple de l’interview par un journaliste, Bruno Masure, de cet homme de la Fédération Internationale des Droits de l’Homme, présent au Rwanda. Celui-ci annonce d’une voix tremblante, un an avant le génocide, qu’il se profile une catastrophe mais qu’il est encore possible de l’éviter. Il arrive difficilement à contenir son émotion.
Je l’ai vu, ou j’ai dû le voir, puisque cela se passait au cours d’un journal télévisé que je regarde assez régulière- ment. Lorsque je l’ai revu, je me suis dit que je ne l’avais jamais entendu, jamais vu. Si j’entends crier quelqu’un dans la rue : « au secours, au feu, on me tue ! », cela risque quand même de provoquer une réaction dont je me souviendrais.
Qu’est-ce qui fait qu’à un moment déterminé, on entend sans que cela ne provoque la moindre réaction ?
Quelles sont nos perceptions ? Le spectacle travaille sur cela.
C. R. : Pourquoi a‑t-on besoin de la fiction pour questionner la réalité ?
P. L. M. : Quand vous prenez une baguette de bois rectiligne et que vous la plongez dans l’eau, elle va vous apparaître coudée, cassée. Vous la ressortez, et elle est à nouveau droite. Si vous voulez la faire apparaître telle qu’elle est dans la « réalité » lorsque vous l’immergez dans l’eau, vous êtes obligés de la couder vous-même, de la briser. C’est peut-être un peu cela la nécessité de la fiction.
C. R. : Peut-on tout transformer en fiction ?
P. L. M. : Je n’ai pas de position de principe là- dessus, cela dépend de l’objectif que l’on se donne. Quand Aristophane interrompait ses comédies pour parler des affaires de la cité – la fameuse parabase –, il devait se dire que la fiction n’était pas suffisante.
Mais la fiction, ce sont aussi les jours passés que nous essayons de décrire. Nous les avons vécus, ils nous ont touchés, et pour les raconter nous sommes malgré tout dans une certaine forme de fiction. Une journée qui se raconte en dix minutes, n’est-ce pas aussi de la fiction ? La question n’est pas entre le vrai et le moins vrai, mais l’enseignement que je tire d’une « interprétation » du réel.
UN PLATEAU QUASIMENT NU, fermé au fond par un mur rougeâtre comme la terre d’Afrique, comme l’argile nommée latérite, modelée…