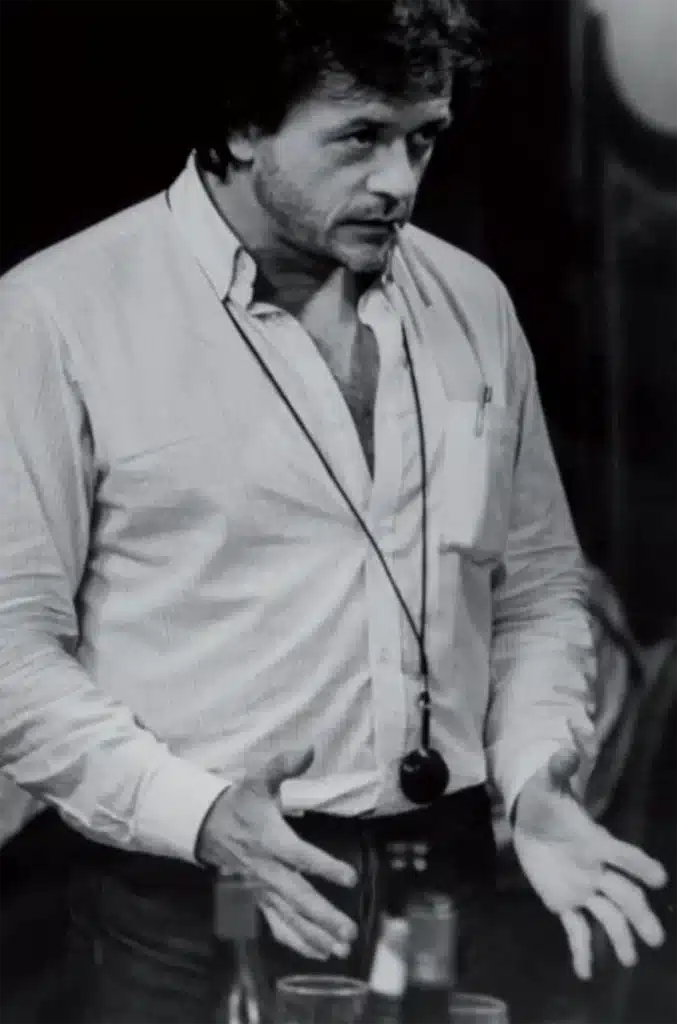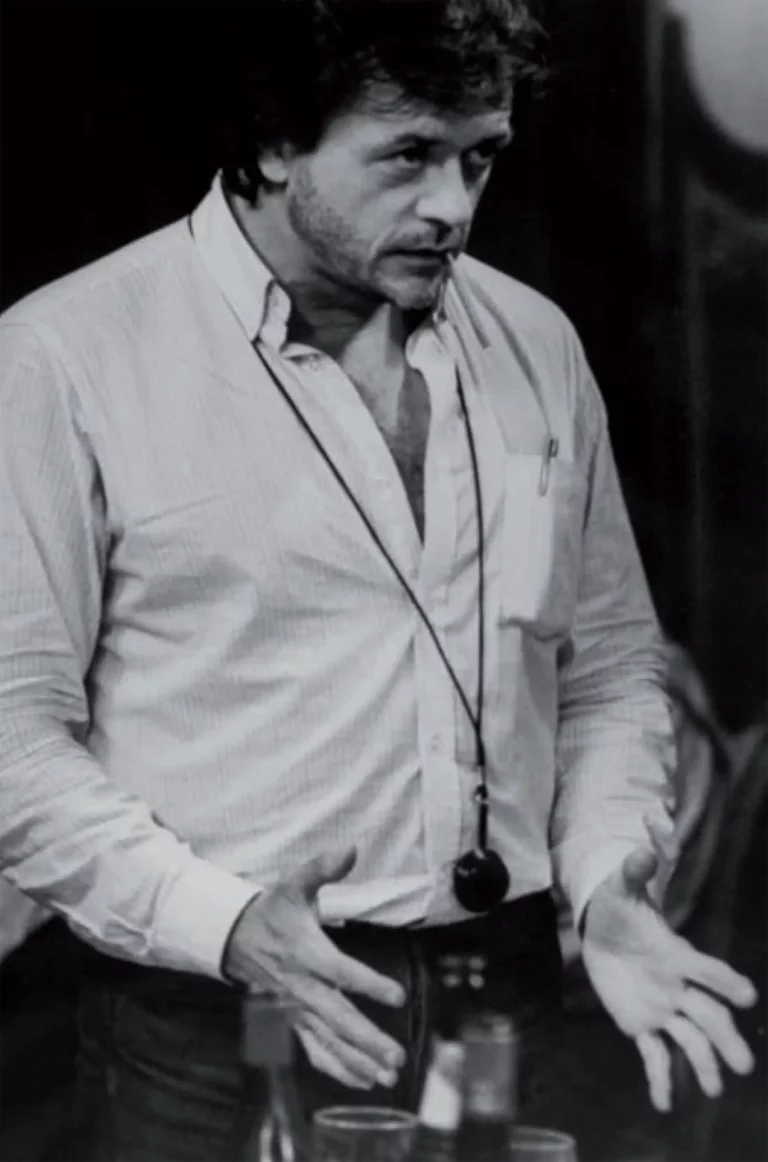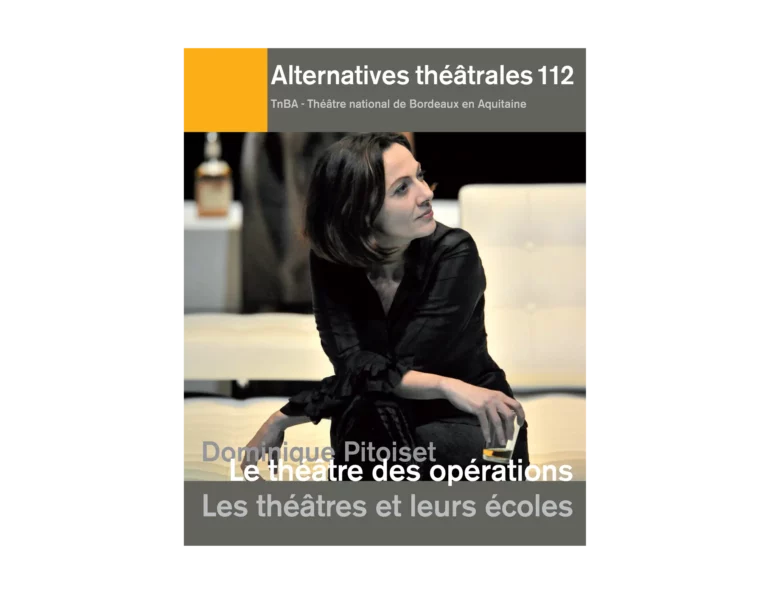LA FRANCE dispose du nombre le plus significatif d’écoles adossées à un théâtre, récentes et anciennes confondues1. En Europe, ces écoles apparaissent surtout dans les pays où la mise en scène s’est imposée avec autorité, dans ce triangle fondateur lié à ses débuts, le triangle Moscou-Berlin-Paris2, comme si un lien secret se constituait entre les deux fonctions, comme si l’apparition de l’une entraînait l’émergence de l’autre. La mise en scène est première, certes, mais la pédagogie lui succède de près et, ensemble, elles dessinent la figure de ce cercle élargi, l’ellipse du renouveau durable de la scène moderne. Car le metteur en scène qui se situe à l’origine d’une école entendra toujours relier, par le biais de cette alliance, quête de renouveau esthétique et inscription dans la durée. Il trouve dans la pédagogie son principal compère. Elle perdure et fournit les appuis indispensables à la succession des spectacles, elle apporte la garantie d’une approche confortée par l’élaboration d’un modèle de jeu, d’un acteur inscrit comme pièce maîtresse dans le projet global de l’artiste animé par le vœu de transformer le théâtre. Les metteurs en scène – il faut le souligner – ne seront à l’origine que des écoles pour comédiens, jamais pour metteurs en scène puisqu’il s’agit, pour eux, non pas de viser la perpétuation d’une profession nouvellement constituée, mais de chercher réponse à un besoin propre, concret et immédiat : l’acteur approprié !
Le besoin pédagogique
Certains metteurs en scène se sont livrés à un travail pédagogique interne comme l’attestent les témoignages réunis dans LES PENSEURS DE L’ENSEIGNEMENT3. Ils ont assimilé élaboration d’un projet scénique et formation d’un comédien propre. Dans ces cas emblématiques, les deux visées sont indissociables dans la mesure où la création même se confond avec la volonté acharnée d’accoucher son propre acteur sans lequel le metteur en scène se sent invalide, inapte à avancer et de parvenir à son utopie. Ce fut le cas de Grotowski et de Barba, du Living Theatre et de Brook, de Mnouchkine et de Stein… Ils n’ont pas créé d’école parce que le travail théâtral lui-même se plaçait constamment dans une perspective pédagogique. On crée et on forme, les deux à la fois. Et cela exige du temps pour élaborer les spectacles, accomplir les projets !
D’autres metteurs en scène dissocient cette activité double et procèdent à une sorte d’alternance : ils développent leur œuvre et, séparément, mènent une constante activité pédagogique dont ils éprouvent la nécessité. Certains, encore plus impliqués dans les processus de formation, considèrent comme indispensable la création de leurs propres écoles, liées à leur théâtre. Non pas écoles héritées, préétablies, mais écoles enfantées, écoles désirées. Jean-Pierre Vincent précise la distinction : « je m’installe sans gros problèmes dans les structures préétablies (pourvu qu’elles ne soient pas perverses…). Le besoin d’une structure propre relève d’une autre pédagogie. Dans ce cas, il faut avoir le sentiment qu’on est détenteur d’un certain corpus de vérités et de pratiques à transmettre… et que ces pratiques s’inscrivent en faux contre toutes les structures existantes »4. Il s’agit donc d’une différence qui provient de la relation que le metteur en scène entretient avec les pratiques de son temps et avec ce qu’il considère comme étant l’inédit irréductible de sa pratique. Cela a conduit à la création des studios et des ateliers inscrits au cœur même de l’institution théâtrale comme des plateformes de recherche personnalisée : Stanislavski en a ouvert trois au sein du Théâtre d’Art, comme Meyerhold ; Barba créa une école nomade – l’ISTA (International School of Theatre Anthropology) – et Robert Wilson a dressé ce « phalanstère » utopique qu’est WatterMill. La structure, dans ces cas, se montre dépourvue de la moindre autonomie. Fortement identifiable, elle vient confirmer le souhait du metteur en scène de se ménager des espaces de liberté afin d’entretenir l’esprit de recherche qui lui est propre et dont il ne veut pas se départir. Le studio ou l’atelier portent l’empreinte explicite de l’artiste qui l’a produit. Indissociables, ils se confondent. Ce modèle ressemble à l’ancien modèle de la Renaissance lorsqu’on parlait de Scuola del Tiziano, del Tintoretto ! Ce sont des écoles placées sous l’emprise d’un artiste. Certains élèves se sont accomplis dans ce contexte fortement prédéterminé ; d’autres l’ont fui comme Brancusi qui s’éloigne de l’atelier de Rodin en légitimant son départ par un vieil adage populaire qu’il cita au maître étonné : « À l’ombre d’un grand arbre, rien ne peut pousser longtemps ».
La troisième hypothèse – c’est elle qui fait l’objet de ce dossier – concerne les écoles adossées au théâtre suite à l’intervention d’un metteur en scène, sans qu’elles restent pour autant entièrement liées à lui. L’école perdure comme telle tout en assumant le rapport avec l’artiste qui l’a accouchée et l’organisme qui actuellement la parraine. De même que chez les « faux jumeaux » chez qui la gémellité n’est pas complète, il y a ici la co-présence de deux institutions fortement rattachées mais jamais entièrement fusionnées. Dans les années vingt, le Max Reinhardt Seminar à Vienne aura eu ce statut comme l’école de Tairov à Moscou ou, plus tard, à partir de 1943, l’école du Théâtre d’Art créée par Némirovitch Dantchenko. Plus récemment, dans les années 1980, Antoine Vitez – au nom de son « éros pédagogique » – a créé l’Écolede Chaillot qui lui a permis d’œuvrer alternativement, au cours d’une même journée, sur la scène et dans la salle de cours. Son cas reste exemplaire et ses traces sur la scène française sont profondes ! Il a créé l’école parce qu’enseigner était pour lui, pour paraphraser la célèbre formule « trotskiste » de la « pédagogie permanente », un travail jamais interrompu qui nourrit l’artiste autant que son théâtre, comédiens et élèves réunis.
Patrice Chéreau, à la même époque, inscrira dans son projet d’une maison de théâtre à Nanterre une école d’acteurs sous la responsabilité institutionnelle de Pierre Romans. L’école participe de cette vision globale qui allie théâtre et cinéma, création et pédagogie. Complexe, la structure imaginée par Chéreau à Nanterre fonctionnera comme un organisme vivant arborescent. Mais le désir d’enseigner aura pour Chéreau une courte durée. Il se limite au temps de son passage à Nanterre et l’école du théâtre ne fera pas partie du legs transmis à Jean-Pierre Vincent. Il a préféré l’arrêt brutal à la décomposition lente de l’École de Chaillot qui, elle, a fini par succomber au terme d’une agonie indigne de ses débuts. Ni l’une ni l’autre de ces deux écoles, de Vitez ou de Chéreau, n’a survécu à leur passage. Mais ces écoles à identité personnelle forte ont engendré une filiation confirmée par les élèves de Chaillot et de Nanterre qui rappellent tous la portée de cette expérience de formation.