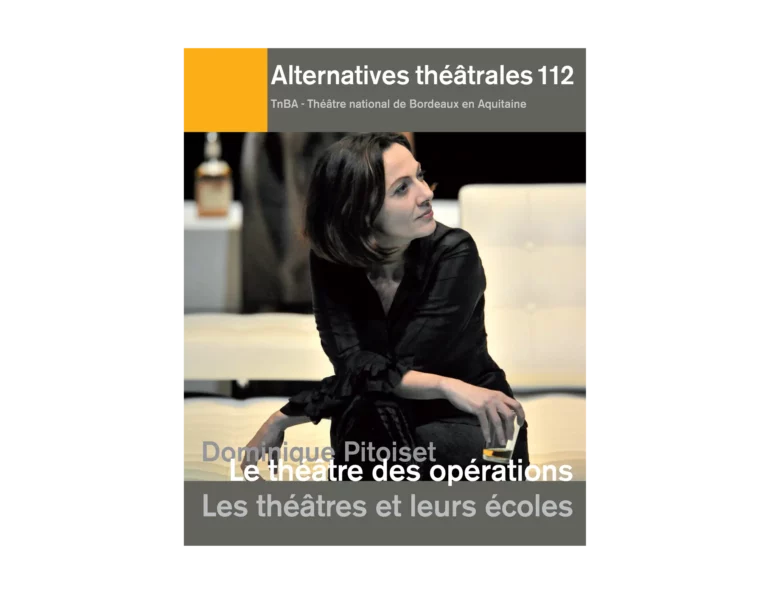Yannic Mancel : Quel état des lieux avez-vous constaté à Strasbourg en 1974, lorsque vous avez hérité de la direction du TNS et de son École, si fortement marqués par la griffe de ses deux grands précédents directeurs, Michel Saint-Denis – le fondateur – et Hubert Gignoux, son successeur ? Et comment avez-vous le sentiment rétrospectivement d’avoir fait évoluer les choses ?
Jean-Pierre Vincent : Nous connaissions de loin l’activité de ce théâtre et de cette école. Patrice Chéreau avec qui j’avais débuté au lycée Louis Le Grand connaissait assez bien Hubert Gignoux et avait engagé dans sa compagnie d’anciens élèves de l’école. Je sortais quant à moi d’une aventure de compagnie avec Jean Jourdheuil et le Théâtre de l’Espérance. Totalement amateurs, nous étions issus d’une sorte d’autoformation sauvage et spontanée : nous détestions tout ce qui était français et plus particulièrement l’académisme franchouillard du Conservatoire de Paris. Nous lisions des livres, tout ce qui pouvait être traduit de Meyerhold, par exemple. On allait voir les spectacles du Berliner Ensemble et ceux du Piccolo Teatro de Milan. Et nous avions ce phare lointain qu’était l’École de la Comédie de l’Est, avec son mythe et son auréole. Or il se trouve que j’ai été nommé là très jeune, dans une conjoncture où le mythe de l’école était encore très actif alors que l’activité du théâtre lui-même, deux ans après le départ d’Hubert Gignoux, était, elle, en régression. Tout aurait pu alors se déliter, mais il m’a semblé que le meilleur moyen de relancer et d’actualiser la pédagogie traditionnelle du TNS était de la violenter un peu, dans le respect des acquis. Nous éprouvions un grand respect éthique et esthétique pour ce qu’avait accompli la génération précédente, celle des Gignoux et des Dasté, mais nous ignorions tout des fondements de leur art et de leur pédagogie : Stanislavski, Copeau, Dullin, Jouvet… Nous avions donc l’ambition de ranimer tout cela avec notre culture à nous, celle de la troupe, assez bigarrée. J’avais pour ma part une culture assez philosophiquement théâtrale alors que des gens comme André Engel, Dominique Muller, Michel Deutsch et les comédiens avaient tous des centres d’intérêt et des itinéraires de formation très variés. Tout ce melting-pot constitué du collectif dramaturgique et de la troupe ainsi rassemblés s’est ainsi mêlé à l’école. Notre démarche était totalement empirique, sans aucune ambition théorique : notre génération se méfiait farouchement des mots en «-isme ». Nous ne nous sommes appuyés pour investir cette école que sur les quelques mots d’ordre artistiques qu’à l’époque nous nous étions donnés, en replaçant au centre la question du « pourquoi » – pourquoi on fait du théâtre – sans trop se préoccuper du « comment ».
Y. M.: Comment l’école à son tour – ses élèves d’alors puis très vite ses anciens élèves – a‑t-elle influé sur la vie du théâtre ?
J.-P. V.: C’est un foyer dont la vivacité perdure par-delà les années. Je viens de travailler avec des élèves d’aujourd’hui et je l’ai une fois de plus vérifié. C’est une école qui se respecte et qui respecte son histoire. Même après la rénovation architecturale et la redistribution des espaces, quelque chose de l’histoire du lieu, certains fantômes, continuent de traîner dans les couloirs. Il est curieux de remarquer que l’ordonnancement des cours et des pratiques – les disciplines du matin dans leur diversité, les ateliers de l’après-midi et du soir avec objectif de présentation finale – soit resté le même depuis sa fondation, et qu’il ait même essaimé dans d’autres écoles plus récemment créées sur l’ensemble du territoire français.
Ce qui a le plus progressé, me semble-t-il, depuis les années 70, c’est l’importance croissante accordée à la pluridisciplinarité et aux autres arts : la scénographie, la lumière, le son, et la régie en tant qu’art… Aujourd’hui, chaque promotion – chaque « groupe » – ressemble plus à une compagnie au complet, qu’à une école de comédiens avec des plasticiens et des techniciens à côté. C’est cette pluridisciplinarité qui m’attire le plus aujourd’hui au TNS ou à l’ENSATT (L’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre à Lyon). Je constate par exemple qu’en termes de culture générale et de conscience politique, les élèves-scénographes ou techniciens sont souvent plus mûrs que les élèves acteurs dont la vocation prématurée, à l’adolescence, est souvent plus légère.