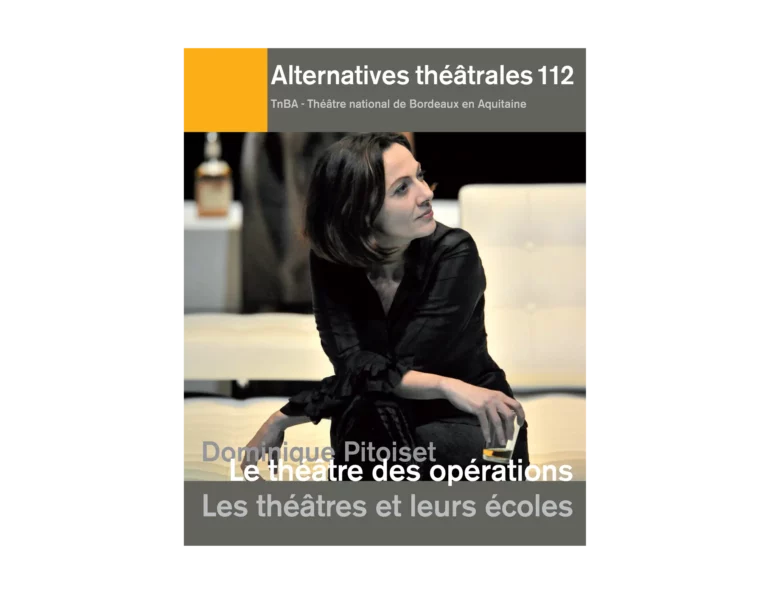Daniel Loayza : Comment est née l’école du théâtre national de Bordeaux ?
Dominique Pitoiset : J’ai été nommé à la direction du Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine en 2004, nous y avons créé l’École Supérieure de Théâtre de Bordeaux en Aquitaine en 2007. La première promotion est sortie en juin 2010. La deuxième est actuellement en cours de seconde année. Cette école est financée par l’État, la région Aquitaine et la ville de Bordeaux. Un dispositif d’aide à l’insertion professionnelle financé par la Région Aquitaine a été mis en place et accompagne actuellement l’emploi de la promotion sortante. L’école est située au cœur du TnBA. J’en ai la responsabilité et cette charge fait partie intégrante de mon contrat de directeur de ce théâtre.
D. L.: Que lles sont pour toi les raisons qu’il y a de créer une école au cœur d’un théâtre ?
D. P.: Je suis moi-même issu de l’école du Théâtre National de Strasbourg. J’ai suivi ma formation à l’époque où Jean-Pierre Vincent dirigeait la maison. Le directeur pédagogique était Claude Petitpierre. Nous sommes nombreux à lui devoir beaucoup. C’était un très grand pédagogue. La période était faste pour le TNS. Le collectif artistique était composé de bons acteurs, il y avait plusieurs metteurs en scène fixes, des auteurs et dramaturges associés. Une école au cœur d’un théâtre, c’est d’abord la possibilité pour des jeunes en formation de côtoyer tous les jours des professionnels en activité, de grandir à leur contact, en les écoutant discuter et en suivant quelquefois leurs répétitions. C’est aussi l’opportunité de pouvoir assister à toutes les représentations des spectacles de la programmation. Quand cette programmation est exigeante, la motivation s’en trouve renforcée et les objectifs pédagogiques en deviennent plus clairs. Et puis Strasbourg, c’était, pour notre génération, le contraire de Paris. Pour nous, les provinciaux, cette école répondait encore aux vœux de ses créateurs : former des artistes qui retourneraient irriguer leur région d’origine, ou qui trouveraient place dans des aventures partagées de la décentralisation théâtrale. Je ne suis pas un dinosaure, c’était les années quatre-vingt… Depuis, les choses ont changé, le terrain de jeu s’est ouvert plus franchement à l’Europe. L’école au centre d’un théâtre est donc naturellement un lieu de confrontations, de débats permanents et de rencontres. Ces rencontres favorisent les complicités et les effets de reconnaissance et fondent les bases d’une bonne insertion dans le métier.
D. L.: Tu parles souvent d’une pédagogie des fondamentaux. Que cela signifie-t-il pour toi ?
D. P.: C es fondamentaux se sont formulés au fil des évolutions et de l’histoire de notre art. De grands metteurs en scène, de grands pédagogues et de grands théoriciens du jeu ont apporté leurs réflexions et leurs expériences. Je n’ai jamais été favorable à l’école d’un maître. Il est préférable que les apprentis comédiens voyagent d’une technique à une autre. L’exercice des différences leur permettra d’assouplir leur instrument, et quelquefois aussi de se déterminer par la négative. « J’apprends aussi en réalisant ce que je ne ferai pas », m’a dit un jour un élève. Je ne parle pas ici de style, bien évidemment, mais de l’approche méthodologique de l’acquisition d’un métier. D’un autre côté, il faudrait prendre le temps de faire le tri.
D. L.: B eaucoup pensent que le talent ne s’apprend pas…
D. P.: On le dit souvent. Mais que recouvre la notion de talent ? On ne demande pas à un apprenti boulanger d’être d’abord un génie du goût, mais d’être un bon artisan qui maîtrise sa technique. De même pour le comédien. Apprendre à jouer, c’est devenir progres- sivement un menteur crédible, réactif et vigilant. C’est aussi savoir reproduire le même objet à volonté. Certains ont plus de facilité que d’autres, c’est sûr, mais le processus de révélation des capacités de chacun est le même pour tous. À force de travail, quelques-uns sortiront du lot. Et l’école est aussi un lieu de question- nements. Un acteur qu’on aide à problématiser sa pratique théâtrale, à réfléchir aux signes qu’il produit, devient responsable du sens qu’il incarne. Nous circulons toujours entre l’artisanat et la recherche fondamentale.
D. L.: S elon toi, l’école existe-t-elle pour fabriquer les outils de l’art du metteur en scène ?
D. P.: Un metteur en scène est en permanence en recherche et ne manque aucune occasion d’y voir un peu plus clair sur ses propres intentions. Et puis on apprend toujours de tout et de tout le monde. Mais nous ne proposons pas de carte blanche préparatoire à une mise en scène future. À Bordeaux, nous choisissons, Gérard Laurent, qui est responsable pédagogique, et moi, des artistes en activité qui excellent dans un domaine précis. Chaque « atelier pratique » associe une écriture et un type de jeu : Shakespeare et le théâtre épique, Tchekhov et Stanislavski, Brecht et le théâtre concret, le théâtre nord- américain et l’Actors’ Studio, les classiques français et l’alexandrin… Chacun de ces ateliers est précédé d’un séminaire dramaturgique d’une semaine qui a pour but de définir le contexte artistique, historique et économique de l’œuvre. Cette approche non linéaire de l’histoire de notre art insiste sur le caractère toujours politique, ancré dans une réalité donnée, de l’acte théâtral. Mais peut-être ai-je mal compris ta question ? Si elle concerne la possibilité qu’un metteur en scène se révèle parmi les élèves grâce au travail d’interprétation, alors oui : le travail de l’acteur reste une très bonne école préparatoire à la mise en scène.
D. L.: Q uand on dirige une école, a‑t-on une mission précise ?
D. P.: O ui. Celle de la transmission d’une mémoire et d’une pratique en perpétuelle mutation. Accompagner des jeunes afin qu’ils acquièrent toute leur autonomie de création reste notre mission première. Cela implique un certain nombre de passages obligés. Le parcours dans l’école commence comme un séminaire, se prolonge comme une Académie et se termine comme une compagnie de création ouverte sur la réalité des enjeux publics. En troisième année, à Bordeaux, les cours techniques et théoriques changent de nature, ils sont au service des projets de réalisation.
D. L.: C e serait quoi, pour toi, une école de formation de comédiens aujourd’hui ?
D. P.: Notre responsabilité est de préparer les futurs acteurs à affronter les défis qui leur seront proposés. Nous devons à la fois entretenir la mémoire des exercices du passé et rester attentifs aux mouvements de la recherche théâtrale d’aujourd’hui. L’époque est à l’éclatement, à l’explosion des formes et des esthétiques. Les référents sont multiples et divers. Nous demandons de plus en plus à nos acteurs d’être rapides, disponibles et performants, voire pulsionnels. Ce qui exige une préparation rigoureuse, y compris athlétique. C’est pourquoi les cours techniques sont nombreux et obligatoires. Il faut pouvoir être efficace et crédible dans l’instant, savoir jeter une proposition entière et changer soudain de direction. Mais la vitesse, la virtuosité ont besoin de fondements. Il faut donc aborder les problèmes dans l’ordre, commencer par le début. Qu’est-ce que lire activement un texte, comment enquêter sur sa partition, comment nommer les cibles, quels processus mettre en œuvre pour engager une physique du sens… Tout cela demande du temps, des moyens et des compétences, car nos métiers n’ont pas grand-chose à voir avec les formations généralistes. Il s’agit plutôt d’une formation d’artisanat d’art. Or nos écoles sont fragiles, voire en danger. Sans un soutien de nos responsables politiques, sans une réelle conviction de leur nécessité, leurs spécificités et leurs qualités reconnues depuis longtemps vont disparaître. Il en va donc de l’avenir du théâtre français, rien de moins. Il est urgent que la profession tout entière se mobilise sur cette question.