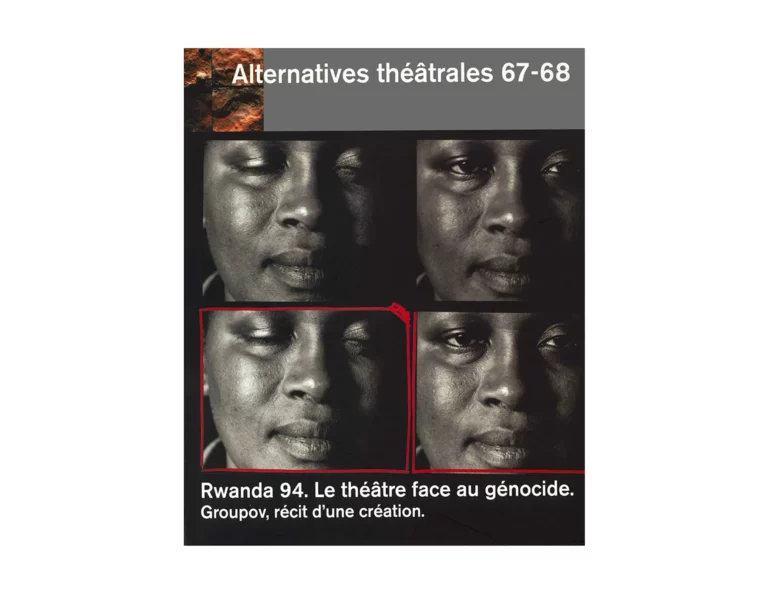Avril 1997
C’ÉTAIT LE 7 avril 1997. Nous étions lundi. Depuis trois jours, je participais à la commémoration du génocide rwandais. J’avais le samedi assisté à une journée organisée par Solidarité Internationale intitulée « Experts à la barre — L’autre tribunal ».
Nous avions devant nous un panel de personnalités belges, du monde universitaire, politique ou culturel, qui questionnait toute la journée des « experts » du Rwanda : Jean-Pierre Chrétien, Luc de Heusch, Michel Chevalier, Ludo Martens, Pierre Olivier Richard ( remplaçant Colette Braeckman), Pierre Galand, Frère Jean-Damascène Ndayambaje.
Aux informations déjà connues sont venues s’en ajouter d’autres, certaines non encore publiées :
– L’enquête extrêmement précise de Pierre Galand sur le financement des armes des génocidaires, ses propos virulents demandant la levée de la dette extérieure réclamée au nouveau gouvernement, la déclarant illégitime et contraire à l’éthique du droit international : 70 % du montant de cette dette accumulée entre 1990 et 1994 ont servi à armer et équiper les génocidaires, militaires, miliciens et même la population, puisque l’on retrouve aussi des factures pour trois cent mille kilos de machettes. Cela, même en 1994, lorsqu’un gouvernement intérimaire a été nommé et qu’il signait des chèques
à partir de Goma.
– Le silence et les tergiversations de l’ONU, les non-dits de la politique belge et française, cette certitude : la préparation du génocide était connue non pas depuis le 6 avril 1994 mais déjà en octobre, novembre 1993.
– Le lobbying des uns ou des autres, d’abord pour le retrait des troupes en plein génocide, avec, en corollaire, cette autre affirmation : si la Minuar était intervenue tout de suite, il n’y aurait pas eu de génocide ; pour l’envoi par après d’une mission dite « humanitaire » alors qu’il y a déjà des centaines de milliers de morts, mission qui signifiait : la protection de fait des assassins et leur retrait rendu possible au Zaïre, avec comme bouclier, les réfugiés.
– L’implication de l’Église et de la Cour Royale Belge, l’échec de la christianisation du Rwanda : 80 % de chrétiens ont tués, la théocratie de l’Église, son refus actuel de reconnaître une part de responsabilité (ce n’est que l’année dernière qu’elle a reconnu le génocide)1.
J’ai rendez-vous avec Frère Damascène avant de me rendre à la Marche aux flambeaux et à la veillée de commémoration organisée par « Ibuka – Souviens-toi ».
Frère Jean-Damascène Ndayambaje est professeur de psychologie à l’Université de Butare. Son intervention samedi portait sur la responsabilité de l’église : « Église, que dis-tu de toi-même ? ». Il reconnaît comme plausible l’hypothèse avancée par Luc de Heusch, selon laquelle le refoulement symbolique et la culpabilité induits par le christianisme, ont eu pour conséquence l’annulation des structures de l’imaginaire élaborées par la culture traditionnelle autour, entre autres, du culte de Ryangombe.
« Mais comment expliquer l’horreur des tueries « précédées d’actes de tortures et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants », les bourreaux allant parfois « jusqu’à couper successivement les doigts, la main, les bras, les jambes avant de trancher la tête ou de fendre le crâne » (Le Monde, 1994). Il y a dans ces lignes un terrible aveu de l’échec de la christianisation au nom de laquelle s’était effectuée ce que d’aucuns appellent parfois « la révolution sociale » hutu.
Après avoir fait s’écrouler le système traditionnel des interdits, l’Église s’est évertuée en vain à y substituer la notion occidentale de péché, parfaitement étrangère à la culture rwandaise. Elle s’est en outre attaquée à la religion traditionnelle et en particulier au culte du Kubandwa qui permettait à une certaine violence latente de s’exprimer symboliquement. (…)
Le drame du Rwanda aujourd’hui ne serait-ce pas en fin de compte, que des miliciens hutu, manipulés par le pouvoir politique et projetés dans un univers hors normes, où toutes les barrières éthiques traditionnelles se sont effondrées, jouent avec des armes fournies par la Belgique et la France, les « Binego » ivres d’une vaine fureur ? »2
Binego est le fils de Ryangombe, il a le privilège de toutes les transgressions, y compris celle du meurtre. Le culte de Ryangombe était célébré en mai-juin, lors de la récolte du Sorgho, surtout par la petite paysannerie hutu. Culte d’initiés, formant une société secrète – le roi3 ne peut y participer, mais bien la reine-mère – le kubandwa s’apparente aux « religions à mystères ». Lors de séances de possession, les initiés incarnaient les « imandwa », la société libre qui entourait Ryangombe : il y avait abolition des différences sociales, tout le monde était égal et toute chose changeait de nom, y compris les gens. Certains interdits étaient levés, comme celui de l’inceste. ( On peut, jusqu’à un certain point, comparer la fonction de ce culte à celle de notre carnaval, anciennement.)
Par ailleurs, dans l’ancien Rwanda, tout était mis en cérémonie – y compris l’apprentissage de la sexualité chez les adolescentes – et ces traditions étaient partagées par tout le monde. La vie sociale était basée sur des cycles : mort/deuil, naissance, mariage, relation entre les morts et les vivants. Le culte des ancêtres était très important et de petites huttes votives leur étaient consacrées dans l’enceinte des maisons. On croyait que les misères qui survenaient résultaient d’un manque d’honneurs qui devaient leur être rendus. Des devins étaient consultés ainsi que des cérémonies organisées en vue d’éviter ces misères, car les ancêtres ne parlaient jamais directement aux descendants, le devin était indispensable à l’interprétation de la symbolique de leur langage.
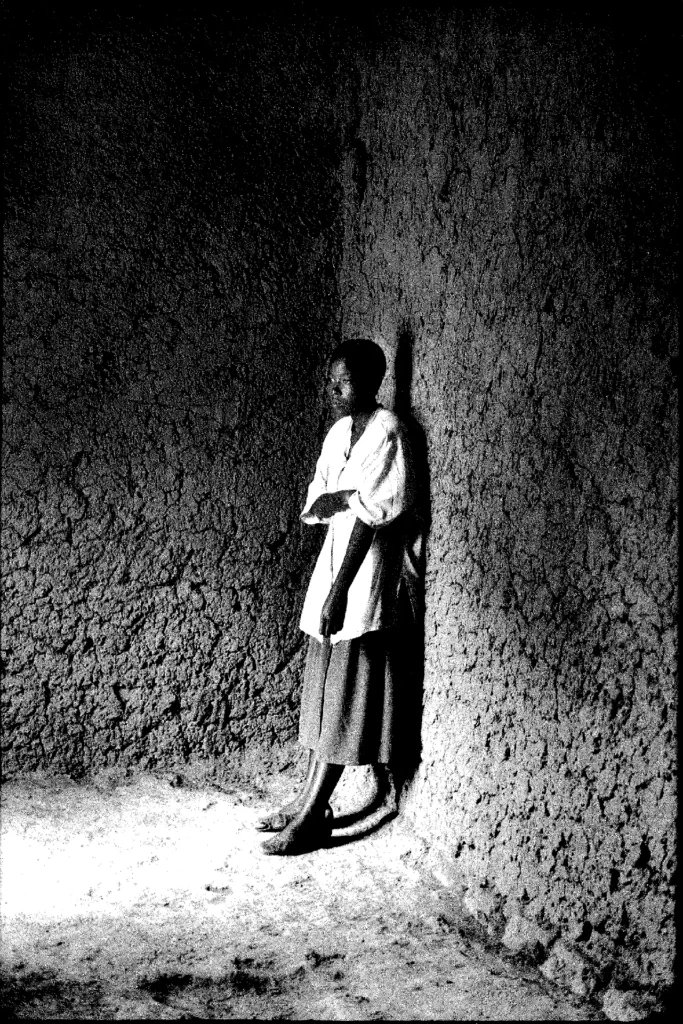
J’entends pour la première fois parler de l’importance des clans au Rwanda, de la référence identitaire que cela constituait, précédant les différences hutu — tutsi — twa. Ainsi, de mémoire, certaines personnes âgées peuvent encore remonter jusqu’à 12 générations propres à leur clan.
Les apparitions de Kibeho, pour lui, sont une manipulation politique, une manœuvre d’Habyarimana. Le message émis par la vierge était un message fataliste. La famille du président était très présente lors des apparitions.
Il aborde les difficultés actuelles, celles entre autres de ce qu’on appelle la réconciliation, passant par une justice nécessaire, mais aussi par un travail très long visant à enrayer l’ethnisme dont les mentalités sont imprégnées. Ainsi, il raconte que, lors d’une entrevue dans le cadre d’une mission d’encadrement des détenus dans la prison de Butare, une femme accusée qui, au départ ne comprenait pas de quoi elle était coupable, a fini par lui dire : « Mais je n’en ai tué que dix. »
Enfin, après avoir mis en question l’Église en tant qu’institution, il évoque aussi des responsabilités individuelles. Le Père Naveau, liégeois d’origine, qui en 1959, prêchait pour la victoire du Parmehutu et l’élimination des Tutsi. En 1973, il demandait à ce qu’une nouvelle révolution se fasse « comme en 1959 ». Un autre Père a traduit MEIN KAMPF en kinyarwanda4 et utilisait cette traduction dans ses sermons. La présence de l’Église en sous-main de la révolution de 1959 : les écrits de Mgr Perraudin contre l’Unar, traitant ce parti de « communiste et islamisant » ( ! ) ; certains prêtres bénissaient les armes, d’autres ont participé parfois activement, certains ont même été traduits en justice au Rwanda (Pères Duchamps, De Vinck), mais ont été renvoyés en Belgique. Cela l’amène à évoquer sa propre histoire, qui couvre celle des deux républiques. Il explique alors son parcours, ce dont il a été témoin et victime, comment il a vu depuis 1959 les massacres commencer et comment il a, par deux fois, échappé à la mort, en 1973 et en 1994. Le récit qui suit est repris de son témoignage écrit paru dans « C’est ma taille qui m’a sauvée », complété par ses propos oraux.
« En 1959, j’étais directeur de deux écoles, primaire et secondaire, à Kabgayi. La situation se détériorait de jour en jour. En date du premier novembre, à la Toussaint, nous avons appris par une rumeur qui circulait que Mnonyumutwa, un des fondateurs du parti Parmehutu, avait été violemment attaqué par des éléments tutsi qui n’avaient pourtant pas été identifiés.
C’était une mise en scène inventée de toutes pièces. Le lendemain matin, j’ai été choqué d’apprendre que la maison du chef Haguma avait été incendiée.
Il dirigeait une des chefferies du territoire de Gitarama, le Marangara. C’est dans ces circonstances que les troubles ont débuté. Sous peu, les maisons ont été incendiées. Les blessés étaient dépêchés dans les hôpitaux ; parmi eux, il y avait Nkusi, un sous-chef grièvement blessé. D’autres sous-chefs ont été tués : Matsiko, Ruhinguka, Rwamumingi… Les tueries ont partout fait rage. Les plantations de bananes ont été rasées. Les Batutsi ont été massacrés et cette vague a déferlé sur les collines, pareille à un feu de brousse. Kayibanda, président du Parmehutu, orchestrait ces massacres. Il rassemblait tous les tueurs et tenait conseil avec eux. Il s’était transféré à Kabgayi chez Monseigneur Perraudin et là, l’administration belge lui avait donné des militaires qui veillaient sur sa sécurité.
Kayibanda venait de démissionner de son poste d’employé du journal Kyniamateka à Kabgayi pour diriger son parti. Il était donc le commandant suprême des hordes de tueurs qu’il envoyait dans les zones à forte concentration de Tutsi comme le Mayaga.
Il travaillait avec certains blancs comme l’administrateur Patheyn et son collègue agronome dont il ne se séparait jamais. Les deux hommes n’abandonnaient jamais leurs fusils. Ils étaient toujours accompagnés d’un médecin qui avait l’habitude de dire aux gens « aujourd’hui comme je ne n’ai pas suffisamment trouvé de cadavres ni de blessés, je me suis mis à tirer moi-même, là, j’ai, au moins, pu faire quelques blessés…»
« Les prêtres de Kanyanza tel que le Père suisse Notti disait que c’était une guerre sainte : « Battez-vous », encourageait-il les Hutu, « ainsi Dieu le veut ».
Notti le suisse, je le voyais souvent de mes propres yeux. Il venait à Kabgayi en compagnie du Père Jules Gysens et tous les deux incitaient les Hutu à tuer. Le Père Notti bénissait les Hutu hors de l’Église au moment où ceux-ci se préparaient à lancer une attaque. Ils arrivaient très tôt le matin à l’Église, armés de lances, d’arcs et de flèches, ainsi que de gourdins. Ils les déposaient dans l’église, assistaient à la Sainte Messe, puis à la sortie, ils reprenaient leurs armes et le prêtre les bénissait en les envoyant massacrer les Tutsi. Les pères Notti et Gysens leur indiquaient comment ils devaient se battre et quelles cibles frapper. Puis, le soir, quand les tueurs rentraient chargés de butin dont les mortiers utilisés pour piler le manioc, des pommes de terre, de la volaille, des chèvres etc., le Père Gysens accueillait les héros avec une profusion de félicitations « Merveilleux travail ! » leur disait-il. Je peux le répéter devant lui, je n’invente rien. Monseigneur Perraudin, bien qu’il ait été là lorsque les massacres se perpétraient, ne les a jamais condamnés.
- Voir rapport « Experts à la barre — L’autre tribunal ». Ligue anti-impérialiste. ↩︎
- Luc de Heusch, ANTHROPOLOGIE D’UN GÉNOCIDE. LE RWANDA, Les Temps Modernes, décembre 1994. ↩︎
- À l’inverse, un prince initié au Kubandwa ne pourra devenir roi. Le Kubandwa proposait donc à la population une sorte de contre-ordre royal. ↩︎
- Il s’agit d’un Père allemand, le Père Johan Pristill. Voir à ce sujet le numéro spécial de la revue chrétienne Golias no 48 – 49, été 1996 « L’honneur perdu des missionnaires ». ↩︎
- C’est ma taille qui m’a sauvée. Rwanda : de la tragédie à la reconctruction, Éditions Cooperazione Italiana, Ministère rwandais de l’Enseigne- ment supérieur, de la Recherche scientifique et de la Culture, Unicef, décembre 1996. ↩︎
- Dorcy Rugamba était l’acteur qui jouait le personnage de l’ancêtre et qui avait dit le poème en kinyarwanda. Il nous rejoindra deux ans plus tard. ↩︎
- Bazungu, au singulier muzungu : ce mot désigne le blanc, l’européen, mais ce n’est pas une couleur – une tasse blanche ne sera pas « musungu » mais un homme noir riche, oui… ↩︎