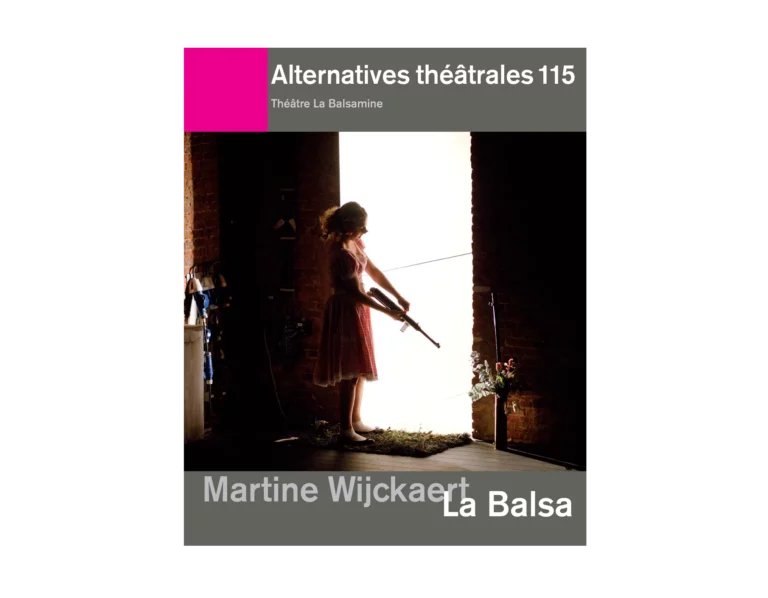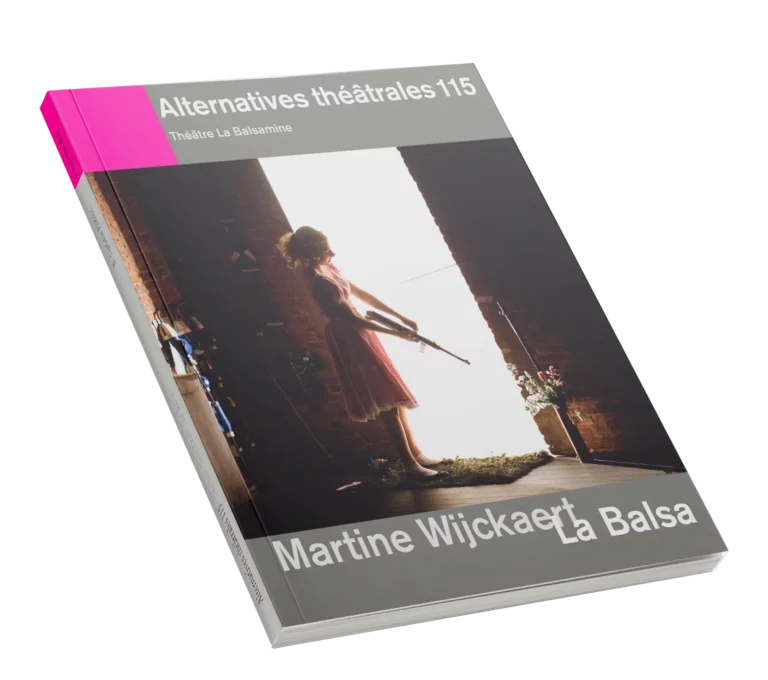C’ÉTAIT EN 1995. Dix-sept ans déjà ! Je me rendais quotidiennement à La Libre Belgique, mon journal. J’y chroniquais le théâtre et la danse. Cela voulait dire quelque deux cents spectacles à voir par an, autant de visions éphémères qui couraient du cerveau à la plume pour en partager le vécu avec les lecteurs d’un jour. La première de NATURE MORTE eut lieu un mardi 16 mai, dans l’ancien auditoire militaire de la Caserne Dailly, encore brute et précairement occupée par la fondatrice de la Balsamine depuis 1981.
Ma première rencontre avec Martine Wijckaert date d’avril 1985. Une longue interview à la faveur de mon mémoire de fin d’études intitulé : L’ILLUSION DU JEUNE THÉÂTRE – DIX CRÉATEURS EN QUÊTE D’IDENTITÉ. Je me souviens de la véhémente à qui de nombreux sujets – dont le cloisonnement croissant entre Flamands et Francophones – faisaient « monter les ovaires dans le chignon » : La Belgique, cette fiction géniale sortie d’un esprit dément est en train de se foutre en l’air ! De foutre en l’air la richesse merveilleuse de ce bordel de deux cultures ! Quand elle évoquait l’étincelle qui, en elle, allumait le désir de créer, se ciselait déjà une forme d’orfèvrerie du temps : Une lumière, un lieu… Je regarde les faits de vie autour de moi. Un détail me fait extrapoler, une ambiance… Parfois, je ne fais rien pendant toute une après-midi devant ma fenêtre et je donne, pendant ce temps-là, l’impression d’être le modèle même de l’inaction ! Je cogite… Il m’arrive parfois ensuite de prendre des notes effrénées pendant toute la journée… Quand elle évoquait l’acteur : Essentiel. Un imaginaire. Souvent, il préexiste au projet. Il me propose une discussion entre son imaginaire et le mien. Un grand acteur est celui qui, par un minimum de gestes, un minimum de signes, fait surgir un morceau d’humanité… Quand elle évoquait le théâtre : Un libre jeu d’espaces différents pour créer un espace global qui raconte une histoire. L’acteur est un espace ; le plateau est un espace ; la couleur, la lumière, le mur, la fenêtre : des espaces…
Bain de jouvence…
Des pensées qui, dix ans après, en 1995, semblaient sous-tendre à la lettre la création de NATURE MORTE. Martine, l’ultra-cohérente. Cette Première, un mardi de mai, fut un choc. À bien des égards. J’en garde un souvenir ébloui. « Le plus simple est le plus riche pour qui se soustrait au tohu-bohu du monde…», commençais-je à écrire, le lendemain matin, seule devant mon clavier, encore grisée par la rêverie silencieuse qui avait, pendant près de deux heures, absorbé mes sens et mon imaginaire. Une artiste m’avait offert un cadeau, un voyage, ce « véritable voyage » dont parle Proust au fil des pages de À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU, ce « bain de jouvence » qui n’est pas dans le fait de « voir de nouveaux paysages » mais « de voir l’univers avec d’autres yeux, avec les yeux d’un autre, de cent autres, de voir les cent univers que chacun d’eux voit, que chacun d’eux est…»
NATURE MORTE, c’était cela. Une chavirante introspection scénique qui dépaysait, par la scénographie, la lumière, le son et le jeu, la perception tout entière. Guidé par « d’autres yeux », notre regard voyageait en terre familière, soudain territoire inexploré, altéré par la course du jour, le cycle de la nature, la fuite du temps… Le banal quotidien s’y déployait telle une sensorielle aventure. Dans la boîte noire du théâtre, les objets familiers, la lumière, le silence se mettaient à bruisser, à respirer et à expirer… Tout en scène y concourait. Du sol aux cintres, des fils reliaient des ressorts à de métalliques bidons-résonateurs et un musicien (Pierre Berthet) donnaient ainsi son, souffle et rythme à la méditation. La lumière (Stéphanie Daniel) réinventait les rayons du soleil se levant puis déclinant de l’orient à l’occident, en perpétuel dessin d’ombres sur la terre. Lignes, volumes et cadres de la scénographie (Valérie Yung) subissaient d’étranges métamorphoses et basculements de plans. Était-on dedans ? Était-on dehors ? Au cœur d’un souvenir ou d’un devenir ?
NATURE MORTE aurait pu s’appeler « cose naturali » (choses naturelles) ou « Stilleven » (Vie silencieuse) tels les noms en vogue avant le XVIIe siècle en Italie et en Flandre pour désigner la peinture qui mettait en scène les objets inanimés du quotidien. Morts dès que figés sur toile ? Mais pour qui prend le temps de s’abîmer dans leur contemplation, vie et mort inséparables y frémissent. Nature morte. Vie silencieuse. Et vanité de cette vie, promise comme toute chose naturelle à la disparition…