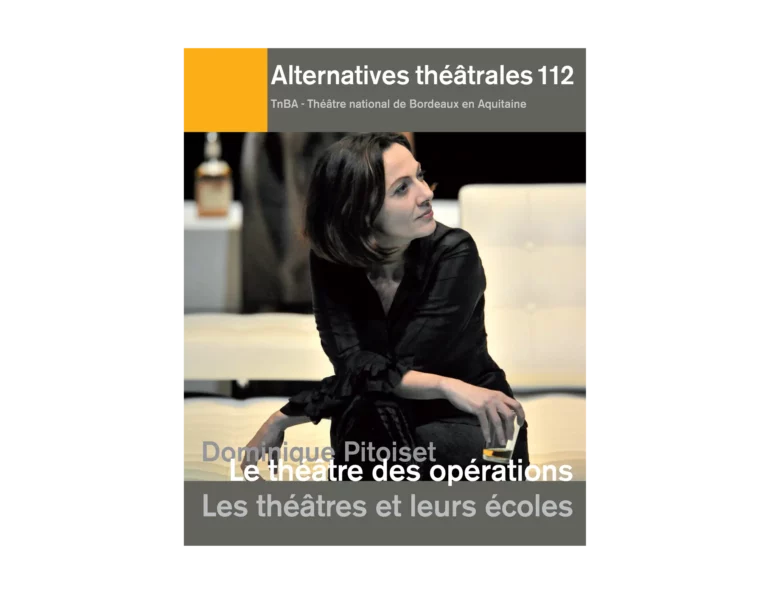APRÈS son spectacle GROW OR GO qui scrutait le milieu des consultants en entreprise, Françoise Bloch vient de créer UNE SOCIÉTÉ DE SERVICES, creusant le sillon d’un théâtre documentaire dans une société où le capitalisme est désormais totalement débridé. Ce spectacle plonge dans le monde du télémar- keting où les travailleurs doivent vendre à tout prix. Construit sur des documents et des entretiens, il pénètre dans l’univers d’un des plus importants opérateurs de téléphonie belge et donne la parole à des employés.
Mais Françoise Bloch est également pédagogue. Après ses études à l’INSAS, elle enseigne dans cette école pendant une dizaine d’années avant de rejoindre l’équipe pédagogique du Conservatoire de Liège par l’intermé- diaire d’Arlette Dupont. Les liens entre le travail dans l’école et celui de la création du spectacle sont au cœur de cet entretien.
Françoise Bloch : À l’époque, j’ai senti que le fonctionnement collectif de Liège, l’espace de réflexion et de discussion ainsi que la façon dont le travail était questionné me feraient beaucoup avancer. Progressivement, je me suis donc totalement recentrée sur l’école de Liège. Cela faisait dix ans que j’avais terminé mes études et j’y retrouvais des questions tant sur la pédagogie que sur les liens entre le théâtre et « le monde », des questions plus politiques qui m’enrichissaient. Lorsque j’ai commencé à donner cours au Conservatoire de Liège, j’y ai été confrontée à un projet pédagogique dont une partie fixe, très définie sur le plan théorique, est la base d’un processus pédagogique. L’enjeu était donc de voir comment ce que je faisais pouvait s’inscrire et dialoguer avec un tel projet reposant notamment sur des « passages obligés ». Dans les débuts, je me suis beaucoup investie dans le point de passage obligé « jeu farcesque ». J’ai dès lors pu confronter ma propre expérience de ce jeu extraverti et satirique avec ce que l’école avait défini comme objectifs pour les élèves. Ce faisant, j’ai ajouté, retiré, modifié ou fondé différemment des consignes de jeu.
Nancy Delhalle : La fondation de ta compagnie le Zoo théâtre en 1997 répond-elle à un désir de travail collectif ou à un besoin d’accéder à une autre position institutionnelle ?
F. B.: Je ne me sentais plus bien dans des projets à production propre des institutions. J’avais besoin d’un espace de liberté, d’une plus grande autonomie, notamment dans la préparation des spectacles, dans l’organisation du temps de création. Plus la part d’écriture est importante dans un projet, plus elle nécessite l’organisation de moment de plateau en amont des répétitions proprement dites, c’est compliqué à organiser quand la compagnie n’a aucune force de production. Une continuité m’est nécessaire qui devenait difficile à trouver. J’émargeais à la Commission d’aide aux projets ce qui limitait cet impératif de continuité. Très vite, j’ai donc essayé d’avoir une convention. En fait, la convention change vraiment la donne. En sortant du projet ponctuel à remettre à une certaine échéance, on sort aussi de l’événement. On réfléchit à long terme sur des questions comme celles du sujet et du langage. Et à cet égard, le travail devient donc continu avec les collaborateurs. En outre, le fait de devoir formuler par avance ce qui va se faire – dans des dossiers remis à la Commission d’aide aux projets – diminuait le désir car en un sens, l’objet était préconstruit, comme s’il suffisait d’appliquer ce qui était écrit. Cela réduisait le champ exploratoire et expurgeait le projet d’une dramaturgie pouvant s’inventer dans la répétition. La convention a changé fortement ma pratique.
N. D.: Mais comment procéder avec les copro- ducteurs car le mode de fonctionnement que tu décris implique nécessairement la rencontre, le dialogue et la relation interpersonnelle avec de potentiels coproducteurs ?
F. B.: Po ur l’instant, cela repose sur une grande confiance. J’expose un état du projet et mes copro- ducteurs habituels me font confiance. C’est une sorte de carte blanche. Cette confiance qu’il ne faut pas trahir est un moteur pour moi dans le travail. Mais c’est problématique lorsque les coproducteurs ne me connaissent pas : je n’ai pas encore trouvé la façon de bien parler de quelque chose que je ne connais pas encore. Même si c’est risqué, je trouve plus intéressant de montrer un état de travail de façon à ce qu’un dialogue puisse s’engager sur cet objet « intermédiaire » même si, parfois, il a peu à voir avec le résultat final.
N. D.: C omment ta pratique s’est-elle transformée à partir de l’obtention de la convention ?
F. B.: C ’est à partir de la convention que j’ai commencé à travailler sur base de films documentaires. Le premier espace exploratoire des projets est resté l’école, mais j’ai pu prolonger cet espace dans la compagnie via un système d’ateliers de recherche. Concrètement, je commence à travailler au sein du conservatoire sur des idées ou projets de spectacle dont je transporte des parties dans ma compagnie. Par ailleurs, mon but étant d’utiliser chaque projet pour élargir le champ des compétences de chacun, l’enjeu pédagogique s’est également inscrit dans la compagnie.
Pour mon prochain projet, nous essayons de « préprofessionnaliser » la documentation. Nous avons formé un petit groupe de réflexion autour de la question de la préparation d’un spectacle à partir des manques que nous avions relevés dans les précédents et dans le cadre de notre budget. Derrière cette question, il s’en profile d’autres. Comment salarier la préparation sur une longue période ? Comment organiser les agendas car nous sommes tous engagés dans des contrats à courte durée ? Par ailleurs, nous bougeons énormément en fonction des tournées et des autres engagements : comment garder la concentration et la continuité ? Doit-on annuler une réunion si une personne ne peut y être ? Comment assurer la transmission des informations ?
N. D.: Selon toi, s’agit-il de questions nouvelles sous-tendues par une comptabilisation de plus en plus forte dans notre société ?
F. B.: Sans doute les questions économiques sont- elles devenues plus importantes. L’allocation de chômage, qui représente un « filet », permet beaucoup moins qu’avant de se loger et de se nourrir. Les jeunes acteurs sont dans des situations plus précaires. Or, m’est indispensable le caractère aléatoire, dilettante, de la préparation au sens où chaque heure ne doit pas être d’une rentabilité mesurable mais où il est possible de flâner dans la documentation. La recherche est faite d’obsession mais aussi de dilettantisme. Comment tenir compte de cela sans évidemment remettre en question la salarisation ?
- Tremplin, pépites & co, festival de théâtre au théâtre de l’Ancre à Charleroi dédié aux jeunes talents. ↩︎