La dimension plastique de l’opéra
Les réformes et querelles autour de l’esthétique lyrique, depuis la création de l’opéra, engagent la musique et le livret. Etrangement, le troisième paramètre de l’opéra, sa dimension visuelle et sa représentation ne sont pas évoquées : l’opéra est l’art du spectaculaire, avec des scénographies impressionnantes et une vocalité puissante. S’il est question de réalisme ou d’abstraction sur la scène au début du xxe siècle, ou de cohérence et d’unité dramaturgique, il est une dimension qui reste quasi intouchable – le monumental. La dimension plastique de l’opéra, c’est sa monumentalité d’où surgit la puissance des représentations musicale et scénique. De même, forme extrêmement malléable et ouverte à toutes les interprétations, l’opéra a une capacité presque illimitée d’intégrer tout médium, langage et narrativité étrangers à son corpus.
Le mythe romantique des origines de l’opéra
Assumons cette évidence historique : la Camerata Bardi florentine n’est pas à l’origine de l’opéra, et la nostalgie pour la tragédie antique est un mythe romantique teinté d’une mélancolie naïve. C’est grâce aux avancées musicales des compositeurs – fruit d’un siècle d’expérimenta- tions – que l’idéal d’une union entre le drame et la musique a pu se concrétiser. Du madrigal à la monodie accompagnée, de laprimapratticaà la secundaprattica, une voix solo a émergé des méandres d’un texte fragmenté et de voix entrela- cées. L’origine de l’opéra, serait plutôt à chercher du côté de savisibilité, dans un monumental qui relève presque d’une ontologie du lyrique. Les cor- tèges mythologiques de la Renaissance et les inter- mèdes, miroirs d’un pouvoir absolutiste, servent la propagande politique et glorifient le règne du sou- verain. Avec le faste des costumes et la complexité de la scénographie, le chant polyphonique et un texte inspiré des antiques, ces immenses tableaux pantomimiques, peuplés de figures mythologiques et leurs attributs symboliques, suscitent à la fois la fascination et l’adhésion d’un public élitiste.
Venise ou l’opéra sauvé des eaux
En tant qu’autocélébration du pouvoir princier, reflet trompeur d’une féodalité moribonde, l’opéra, face aux bouleversements socio-économiques du XVIIe siècle, était une forme condamnée d’avance. C’est la politique capitaliste de Venise qui sauve l’opéra : en pleine décadence économique, en perte de prestige politique et diplomatique, les doges de Venise misent sur le rayonnement culturel et son carnaval. Or l’opéra, avec la noblesse de ses origines et sa dimension spectaculaire, son exubérance visuelle et sa vocalité envoûtante, est la forme idéale pour attirer un public payant, qu’il soit local ou internationale.
New York, l’enchantement nocturne de Chagall au Metropolitan Opera
À la tombée de la nuit, dans le grand hall vitré du Metropolitan Opera, sous les yeux des New-yorkais, se déroule indéfiniment le même rituel : le rideau s’ouvre lentement sur un immense diptyque de Marc Chagall, Le Triomphe de la Musique et Les sources de la Musique, commande du Lincoln Center en 1966. Protégées de la lumière durant la journée, ses couleurs chatoient sous les paillettes de l’électricité et illuminent le regard fasciné des passants : l’œuvre monumentale de Chagall souligne l’aura du Met Opera et le prestige de son mécénat financier.
La démesure dans l’art contemporain
Bruxelles ou la barbarie à peau nue
Il arrive que la démesure s’érige non pas dans la verticalité mais dans l’horizontalité. Incarnant un archaïsme barbare, sur un plateau envahi de peaux de bêtes, champ illimité de ruines ani- males, la Penthesileade Pascal Dusapin, est la reine des Amazones et une guerrière délirante. Touchée par la folie dionysiaque, elle tue l’homme qu’elle aime, Achille le héros de la guerre de Troie, et le dévore avec ses chiens. Ici, Pierre Audi s’asso- cie à Berlinde De Bruyckere qui signe la scénographie. Face à ces décombres d’un monde en guerre, les peaux de bêtes, objets tridimensionnels faits de cire illustrent la musique inquiète de Dusapin. Sur un plateau noir comme la fin du monde, noir comme l’âge des ténèbres, des hommes à la face sombre, rampent sur le sol comme des bêtes. Réduit à une bestialité primaire, le langage est dénaturé, la vocalité est déstructurée, les chan- teurs hurlent, grognent, bégaient.
Munich et La Femme sans Ombre de R. Strauss
— Vous n’applaudissez pas ?
— Pardon ? Non, je suis en train de prendre quelques notes.
— Mais il faut applaudir. Il s’agit de Richard Strauss, notrecompositeur !
— Votre compositeur ?
— Vous avez bien entendu.
— Excusez-moi, mais j’écris, voyez-vous ?
Cette scène se déroule à la fin d’une représentation, celle de La Femme sans ombre de R. Strauss, mise en scène par Krysztof Warlikowski, au Bayesrische Staastoper en 2012.
Ce qui m’était imposé d’applaudir, n’était pas la monumentalité du plateau, – l’immensité des projections de films, d’art vidéo et d’images de synthèses – mais la puissance de la musique de Strauss. Le monumental ici, est symbole d’une puissance culturelle, celle de l’Allemagne et de son histoire. À l’issue de la Seconde Guerre Mondiale, le bâtiment de l’opéra est totalement détruit. En 1963, pour l’inauguration du nouveau Bayesrische Staatsoper, c’est La Femmes ans ombre de R. Strauss qui est choisie. Il s’agit alors de réhabiliter un compositeur reconnu coupable de collaboration avec le régime nazi. Allemagne année zéro… Il y avait une divergence de temporalités ce soir-là, et les démons de la monumentalité, face troublée d’une médaille brillante, hantaient la salle de l’opéra.
La financiarisation de l’art contemporain, la logique boursière du marché de l’art actuel, fait du monumental une norme esthétique, un gigantisme convenu à l’image de ses spéculateurs. Il suffit de penser aux fondations privées et l’immensité de leur espace, celles de Prada à Milan, Pinault à Venise, Jumex à Mexico, Louis Vuitton à Boulogne, ou la section Art Unlimited de la foire de Bâle. Cette surenchère de la démesure contamine également les institutions d’art. Chaque année, l’évènement Monumenta au Grand Palais invite un artiste à défier l’immensité de sa nef de 13500 m² : Passés maîtres du monumental, les plasticiens Anselfm Kiefer, Anish Kapour, Christian Boltanski, Daniel Buren, et les Kabakov y ont été invités. Ces mêmes plasticiens investissent la scène lyrique ! Les Kabakov et le Saint-François d’Assise de Messiaen à la Rurthriennale ; Anselfm Kiefer et Elektra au théâtre San Carlo ; le trio Boltanski / Kalman / Krawczyk et La Pleine Nuit ou déambulation nocturne dans l’Opéra- Comique ; Anish Kapour et Pelléas et Mélisande à la Monnaie ; Daniel Buren et Daphnis et Chloé au Palais Garnier…


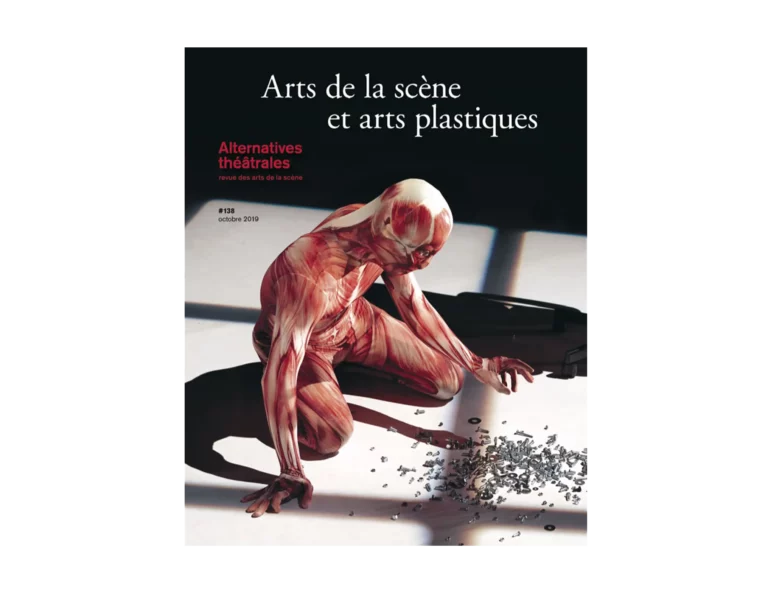
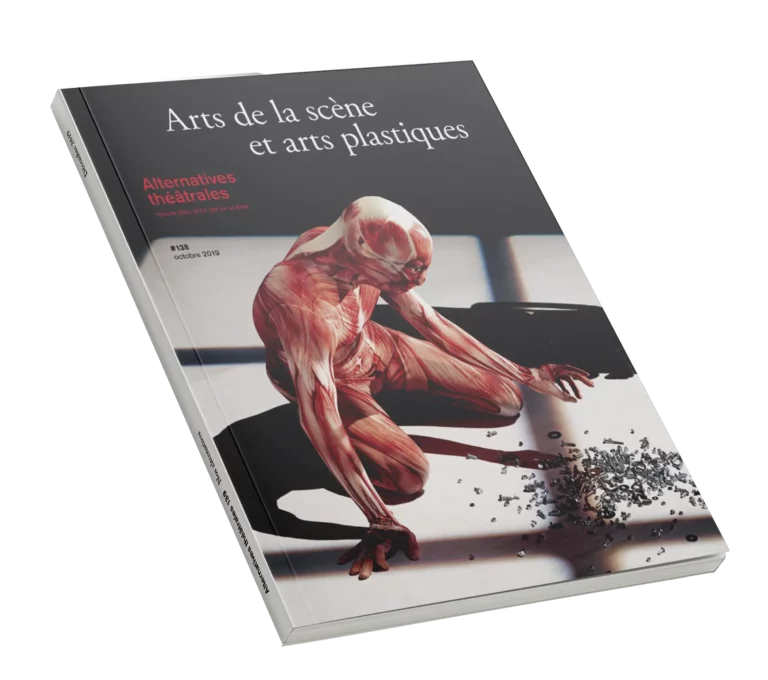


![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)

