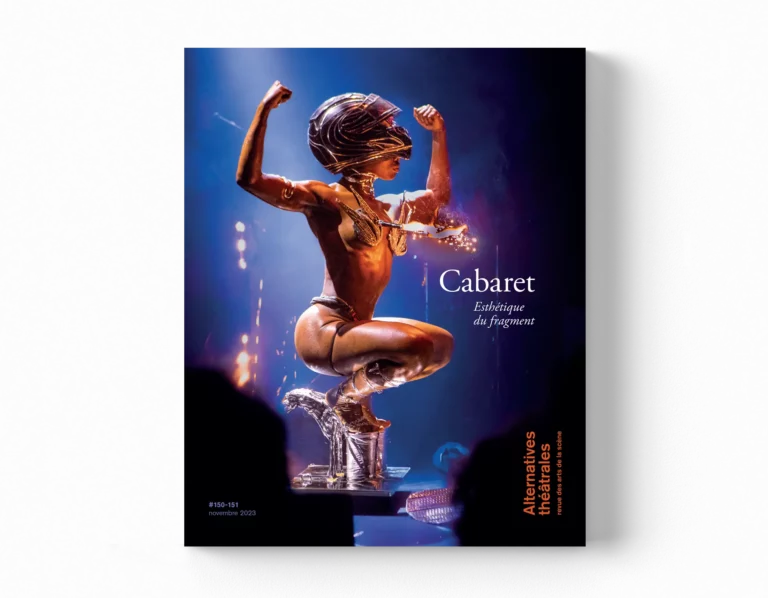Je pensais depuis longtemps, comme une évidence mais sans jamais l’avoir lu ou appris, que les drag-queens et kings étaient apparu·es dans les années 1960 à San Francisco ou New York, et avaient ensuite été émulé·es en Europe, peut-être à partir des années 1970… Tout cela était confus et non documenté, comme une fable partagée par beaucoup sans qu’il y ait vraiment besoin de la raconter. Pour la vérifier, je me suis tournée vers Camille Khoury, spécialiste de l’histoire du travestissement au théâtre, avec cette question : « Comment les drag-queens et kings sont- iels arrivé·es en Europe ? – Alors, me répond-elle, pas du tout de la manière dont tu pourrais le croire. »
L’histoire commence en France dans les années 1870, avec la naissance du café-concert puis du music-hall, qui viennent tous deux du vaudeville. Un des genres du vaudeville est celui la revue, et il y était fréquent qu’un. e comédien·ne joue plusieurs personnages, et donc change de costume, ce qu’on appelait « rôles à travestissements ». Autre type de rôle, très présent dans le vaudeville, ce qu’on appelait les « rôles travestis », c’est-à-dire le fait pour des femmes notamment de jouer des rôles de jeunes hommes. Progressivement, le texte disparaît au profit de l’image scénique et du spectaculaire, et ces rôles vont se transformer en numéros de transformisme, où un comédien va changer de costume de nombreuses fois en imitant des stéréotypes sociaux ou des personnalités connues. C’est une discipline qui redevient plutôt masculine, et qui connaît aussi l’influence du cirque, fréquent dans les music- halls. Au xixe siècle, le cirque utilise déjà beaucoup le travestissement. Par exemple, des hommes trapézistes se travestissent en femmes et exécutent des numéros étonnamment spectaculaires, ce qui plaît au public… et augmente les recettes.