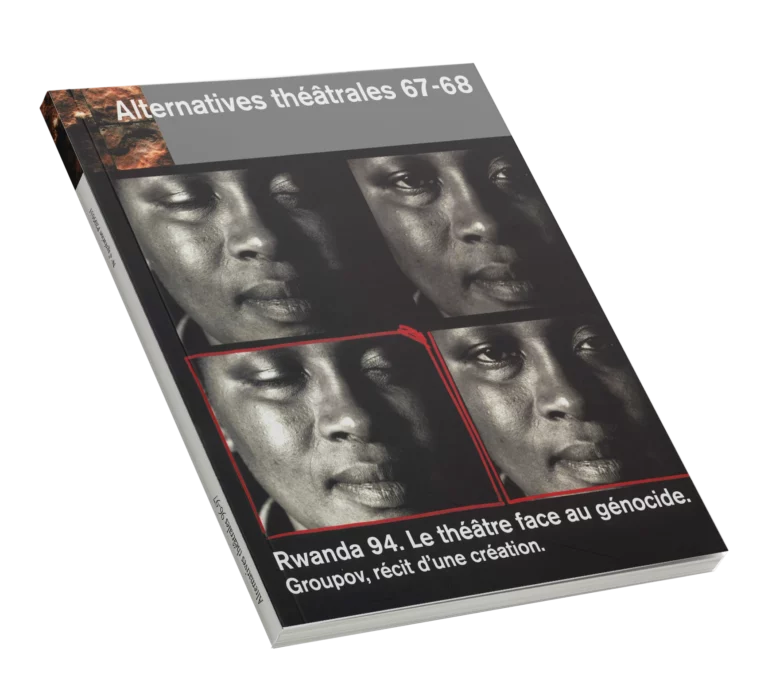Dans les semaines qui précèdent la création, son maître d’œuvre, Jacques Delcuvellerie communiquera aux participants du projet, par l’intermédiaire du journal « Igicaniro », la vision dramaturgique de l’œuvre aboutie. Donnée en fragments dans les sept livraisons du journal, elle est ici rassemblée en un texte unique.
Chers amis,
4 février 2000
APRÈS QUATRE ANNÉES de travail dans tous les domaines, la création de RWANDA 94 est désormais extrêmement proche, nous voici engagés dans les répétitions finales. Je voudrais insister : c’est pour cela (la création d’une œuvre d’art), que tout le reste fut entrepris. Certes, bonne ou mauvaise, ce n’est pas une œuvre ordinaire. Elle s’est toujours fixé des objectifs, elle vise un but. Il se peut cependant que bien des choses s’y entendent que nous ne distinguons pas nous-mêmes, en dépit de tous nos efforts vers la clarté. C’est une des caractéristiques des œuvres d’art : elles échappent toujours quelque peu à leurs auteurs ; même chez Brecht. Je rappelle ceci, à cet instant, parce que c’est bien à chacun, en tant qu’artiste, que cette lettre s’adresse. C’est-à-dire à ses capacités artisanales, à ses talents expressifs, à ses ressources imaginatives, à sa sensibilité personnelle spécifique, dans l’intelligence générale du projet. Pas autre chose. Nous n’avons pas lu tant de livres, ni écouté tant de témoins ou de spécialistes, ni voyagé au Rwanda, pour devenir politiquement plus compétents sur l’Afrique Centrale ou plus riches d’expériences humaines. Ça, ce sont des « bénéfices collatéraux ». Nous l’avons fait pour créer RWANDA 94.
Autrement dit, plus sinistrement, si l’œuvre présentée au public dans quelques semaines s’avérait ennuyeuse, confuse, laide, ou simplement inégale, nous serions dans l’échec de toute l’entreprise. Ce qui se décide ces jours-ci, en voilà l’enjeu. Il nous faut bien intégrer cela, tous. Si l’on coupe tel passage, si l’on développe tel autre, si l’on change une solution scénique, si l’on attribue ou retire quelque chose à quelqu’un, l’œuvre finale seule nous y contraint. Son sens, sa beauté, sa sensuelle évidence.
Créer un véritable « divertissement de l’ère scientifique » impliquait d’associer de bons ouvriers du divertissement, et nous croyons les avoir réunis.
L’ère « scientifique » postulait, d’une part, une approche analytique concrète, nous nous y sommes efforcés et d’autre part, l’emploi de formes susceptibles d’être entendues du public. Nous avons mis quelques chances de notre côté à cet effet. Les diverses présentations de nos états de travail peuvent nous encourager à une certaine confiance, disons – de base. En aucun cas à la suffisance ou à la présomption. Depuis le Festival d’Avignon, bien des changements ont été introduits qui constituent autant de paris nouveaux extrêmement risqués (scène des visions par exemple). De plus, la contrainte de réduire la durée du spectacle pèse lourdement sur chaque proposition. Le résultat final demeure donc incertain.
Nous devons avoir chacun une conception-sentation de l’ensemble de cette œuvre, afin précisément d’y insérer notre effort personnel au plus juste.
Le projet s’était donné une ambition claire, la seule à laquelle peut oser prétendre un spectacle, celle de devenir le lieu d’une réparation symbolique. Claire, peut-être, mais non pas simple. De définir ainsi l’objet de RWANDA 94, suppose que nous nous sentions dans le devoir de réparer… Envers qui ? Envers les morts d’abord. L’œuvre nous est commandée par des morts, un million de morts. Voilà notre sentiment de base. D’où l’on comprend, au fur et à mesure des « états de travail », la présence toujours plus visible du Chœur, par exemple.
Si notre devoir nous semblait de tenter une « réparation » envers les Morts, la nécessité de l’entreprendre procédait bien du souci des vivants. En œuvrant à la « réparation », nous avons la conviction de contribuer à ce que les vivants puissent s’interroger sur les étranges rapports qui les conduisent périodiquement à exterminer une partie de l’humanité dans l’indifférence, la passivité, en partie avec la complicité d’une grande majorité. D’où, bien sûr, il résultait que pareille « réparation » ne pouvait résulter de déplorations, de regrets, d’excuses et que les larmes et les promesses n’y suffiraient nullement. Au contraire. Ce devoir de réparation avec les morts par souci des vivants, ne pouvait esquiver la question du « Pourquoi ? », ni donc celle des responsabilités.
RWANDA 94, commandé par les Morts, commence donc par leur rendre un visage, une individualité, un statut d’être humain (celui qui leur a été dénié). Point de statistiques ni de masses anonymes. Qui est mort ? Qui ?
Donner la parole à Yolande Mukagasana, largement, c’est le premier stade de la réparation. Une quasi morte se tient devant nous, celle qui aurait dû mourir, celle qui a survécu, selon ses propres mots, seulement parce que « la mort ne veut pas de moi ». Et la parole de cette morte vivante, à elle seule pour qui sait entendre, anéantit déjà ces images toutes faites de l’Africain qui subsistent toujours au fond des cervelles d’Occidentaux les mieux récurées.
Cependant, déjà, dans ce récit fait de ses propres mots dans une langue qui n’est pas la sienne, dans ce moment où elle assume un rôle d’elle-même, un pas en deçà de cette frontière trouble entre réel et représenté qui constitue l’essence même de l’acte théâtral, elle livre comme incidemment bien des informations et autant de questions sur la nature et l’origine des faits. Quand le prix qu’elle paie pour nous offrir cette interminable agonie différée, la mort des siens, a été acquitté, alors elle se lève, elle a tous les droits, et elle qui s’était introduite « comme un être humain de la planète Terre », achève en s’adressant directement à l’humanité entière et situe la hauteur de la « réparation » dans son enjeu exact : qui ne veut pas savoir est complice, qui ne veut pas comprendre recommencera.
Il n’est plus possible de rien dire. Mais peut-être le chant… La voix incroyablement pure de Muyango fait entendre « Mutunge ». Premier contact avec cette langue et cet art si raffinés. Issu de la première de ces dévastations qui conduiront au génocide. Le chant tisse un premier lien – encore incompréhensible mais perceptible aux spectateurs – avec les décennies précédentes, avec la culture ancestrale.
Entrent dans la salle les Morts, le Chœur des Morts, en même temps que des voix résonnent dans les haut- parleurs, mélangées au chant de Muyango et à l’orchestre. Deux choses adviennent simultanément. Toutes ces voix, tous ces fragments de récit disent : ce que Yolande Mukagasana vous a longuement conté, cela est advenu
un million de fois ; en même temps, ces personnes noires, africaines, si immédiatement différentes (leur peau, leur langue, leurs mouvements) sont cependant nos frères humains, oui, c’est comme ça et personne n’osera dire honnêtement au moment où ce Chœur des Morts descend dans la salle : ils sont exactement pareils à
nous et cependant ce qu’ils disent et signifient – pudeur, désespoir, souffrance, amour des siens – nous est exactement commun. De ce choc naît le début, sensible et non rationnel, des bases d’une véritable attitude antiraciste ; non feindre que nous sommes identiques, mais que les différences jouent seulement au sein d’une même famille. Et cela, le Chœur, dans la salle, s’adressant à de petits groupes, cependant que le chant, les témoignages enregistrés, l’orchestre nous envahissent, cela, ces individus particuliers, à nouveau le manifestent. Et enfin, quand Dorcy Rugamba a fini le récit de la mort de son frère, vue par les yeux du défunt, voici les morts sur scène, encadrant la survivante. « Narapfuye, baranyishe. Sindaruhuka, sindagara amahoro. Je suis mort, ils m’ont tué. Je ne dors pas, je ne suis pas en paix. »
Ce que le lent diminuendo du chant et de l’orchestre nous laisse, c’est leur présence si paisible qui affirme pourtant : je ne suis pas en paix.
Noir.
« Itsembabwoko »… génocide… Comment a‑t-il été présent dans les ors, les dorures, ou le béton d’une salle de spectacle ? Par une parole ? Oui d’abord, mais dans des corps. Des corps. Et ces corps sont les nôtres et pas les nôtres, et dans cette différence, nos frères. Et ça, c’est le « Théâtre » qui le communique dans cette partie, pas le discours.
11 février 2000
Après cette brève césure, rien, silence, le mur de terre rouge s’ouvre et, sur le grand écran, des images du monde vont défiler. Pas n’importe quelles images du monde, pas n’importe comment. Ces images telles que l’écran bleu nous les apporte, nous les cadre, nous les découpe.

Une part variée de l’activité humaine : sport, religion, art, politique sur plusieurs continents. On entend de l’arabe, du français, de l’américain, du chinois. Le premier moyen d’information du monde actuel, le premier loisir, pour toute une génération déjà : la première baby-sitter. C’est elle, au-delà même du langage, nos sens la reconnaissent. Après le génocide, la deuxième instance du spectacle, la télévision, fait son entrée en scène.
Le génocide, pendant 45 minutes, c’était des voix, des visages, des corps d’Afrique, et de la musique.
Avec l’intelligence d’une vie (Yolande), avec la mémoire des victimes, c’était la sollicitation des émotions et des sens dans un autre vécu du temps. Nous prenions le temps.
La télévision, d’emblée, c’est un son agressif, un rythme heurté, une fragmentation du récit. Et c’est dans ce discours que font irruption les visages des « fantômes électroniques ». Les voici eux-mêmes, les morts, qui viennent réclamer leur dû. « Réparation symbolique », suite. Nous sommes dans la rétro-science-fiction, puisque l’émission « Mwaramutse » se situe en 1995 et que, nous le savons trop bien hélas, l’univers des ondes, jamais ne fut secoué de quelque apparition venue de l’au-delà.
Une dette se crée : « cela aurait dû arriver » (Yolande Mukagasana). Ce passé imaginaire en lui-même est comme une première tentative réparatrice. Ils ne font pas seulement entendre une autre langue et un message, ils troublent l’ordre même du discours télévisuel.
Ils dérangent. Mais ces espèces d’« aliens » sont aussi autant d’énigmes, notre cerveau spécule sur ces paroles incompréhensibles. Avec de telles expressions sur les visages, que disent-ils ? Et quand nous obtenons la traduction, si nécessairement décalée de nos réponses imaginaires, nous devons affronter à la fois ce que peut signifier cet écart et ce que les Morts ont vraiment dit.
Que ces morts ne s’expriment pas clairement n’est pas seulement goût africain pour la métaphore. Tout comme au Rwanda, en Europe, jadis, les dieux, les morts, les ancêtres, s’adressaient aux vivants par énigmes.
Un rêve à déchiffrer, un oracle à interpréter. Pourquoi ? Parce qu’en cherchant le sens du message les vivants travaillent, doivent penser, réfléchir, se questionner, et le plus souvent : se remettre en cause.
Et c’est bien aussi pourquoi le professeur Kamali ne répond presque jamais directement à Bee Bee Bee.
À la fin, il se dérobe complètement à sa question et la renvoie à l’expert suivant. Tout au long de son intervention, il lui a donné des indices, a provoqué des chocs émotionnels (l’enfant), et, en fait, a substitué d’autres questions à ses questions initiales. Il a agi comme un parfait devin. Elle venait pour comprendre rapidement et clairement les messages des morts et repart avec une interrogation sur elle et sur nous tous.
L’intérêt dramatique de cet affrontement, c’est que Kamali opère ce travail à l’intérieur du dispositif de l’ennemi, en feignant de jouer ses règles. Les fantômes électroniques étaient totalement incongrus, étrangers au système. Leur représentant vivant (Kamali dit « mes morts ») semble intégré aux conventions occidentales.
Il accentue les caractéristiques du rôle que la télévision lui attribue : le « spécialiste » ; il parle aussi un français plus sophistiqué que ses interlocuteurs ; il crée sans cesse les conditions d’être indispensable, irrécusable, pour mieux transgresser le cadre étroit où la vedette du petit écran voudrait le confiner. Cette confrontation implique donc davantage que le choc de deux cultures : le devin des oracles fait son œuvre. Après le passage de Kamali, Bee Bee Bee ne sera plus jamais pareille.
Cette profonde secousse intérieure, Colette Bagimont et le Chœur des Morts vont en faire un séisme. Comme personne ne peut souffrir longtemps un tel état affectif et mental, il lui faudra chercher à l’apaiser en lui trouvant un sens, des causes, une solution. Dans sa profession et avec son profil psychologique, l’issue lui paraîtra claire : prendre la tête d’une croisade télévisuelle pour la vérité et la justice.
C’est ici, qu’il convient de préciser le délicat problème de sens que pose le personnage. Rien ne serait plus faux que d’en faire (et pas seulement l’actrice, mais nous tous) une héroïne ayant fonction d’exemple. Pour rester dans le monde brechtien, ce n’est pas une Pélagie Vlassova mais bien une Sainte Jeanne des Abattoirs.
Le problème dramaturgique de Bee Bee Bee n’est donc pas nouveau, mais convenons qu’il est rarement bien résolu. Voici un personnage que, tout comme « Sainte Jeanne », le spectateur trouve un tantinet ridicule voire un peu odieux au départ, dans un cas une salutiste dans l’autre une star des médias. Pas d’identification du public avec elle. Mais au fur et à mesure, le chemin d’expérience et de connaissance qu’elle parcourt, c’est bien celui que le spectateur est invité à suivre… et, à vrai dire, c’est celui des auteurs même du spectacle : choc émotionnel, tempête de questions, désir et quête de savoir, engagement dans le travail, menaces et persécutions, etc. Ce qu’elle apprend, le spectateur l’apprend avec elle. Notre but, idéal, serait qu’il ne l’apprenne pas comme elle.
Tout comme Sainte Jeanne, le monde conceptuel, politique, moral de Bee Bee Bee, ne permet pas de mener à bien, c’est-à-dire réellement, dans les faits, la lutte pour que « plus jamais » le génocide ne ravage l’humanité. Elle vit, du début à la fin, dans une aventure idéaliste et individualiste que sa grande générosité nous rend sympathique, mais dont nous devrions aider le spectateur à discerner les limites.
Or, ceci n’est pas simple. Brecht n’a jamais rejeté globalement l’emploi de l’« identification », il a écrit sur son emploi pondéré. SAINTE JEANNE DES ABATTOIRS
ou MÈRE COURAGE n’auraient aucune valeur didactique si l’identification et le détachement n’y jouaient tour à tour. Il devrait en aller ainsi avec Bee Bee Bee.
Et cela éclaire aussi le sens d’autres personnages. Dos Santos ? Un Bee Bee Bee aussi doué, moins brillant, plus « gentil » (il ne veut pas seulement contenter tout le monde, mais encore plaire), plus équilibré, plus soumis, plus « moderne », etc. Bagimont ? Une Bee Bee Bee qui serait matérialiste, émotive sans hystérie, généreuse sans aveuglement, convaincue sans emphase, patiente et résolue avec presque férocité. Et nous parlerons de Jacob plus tard. Bagimont, Jacob et le Chœur des Morts deviendront en quelque sorte les « anges » de Bee Bee Bee. Ils prolongeront ce que cet ange qui l’a blessée, Kamali, avait entrepris.
À ce stade du spectacle, le génocide après avoir été perçu par le public à travers des voix, des récits, des visages, des corps, est devenu une question. Celui qui porte cette question sur scène, Bee Bee Bee, est un être qui commence à l’intéresser, mais avec lequel l’identification ne joue pas encore.
On peut retenir aussi pour notre réconfort, que le début d’une rupture avec son mode d’être conforme, advient à Bee Bee Bee par une émotion inattendue. Son cœur n’était donc pas parfaitement contrôlé, l’adaptation au système presque parfaite, mais pas totale. Il est bon de se dire qu’un certain déséquilibre, un défaut, une blessure, un vice (mais oui), une faiblesse, peuvent devenir l’occasion d’un bouleversement capable de conduire vers le plus grand et le plus énergique engagement.
Si Bee Bee Bee n’est pas la Pélagie Vlassova des médias, elle offre un potentiel d’une grande valeur. Davantage de Bee Bee Bee ouvrirait davantage de chances à des bouleversements fondamentaux d’advenir. Qu’elle ne rencontre personne capable de l’armer dans ce sens n’est pas « sa faute » mais une circonstance historique – celle où nous vivons.
18 février 2000
L’arrivée saisissante du dernier « fantôme électronique », la jeune fille qui perturbe en direct l’émission de Bee Bee Bee, la traduction et l’interprétation de son message par Colette Bagimont, sont les derniers éléments nécessaires au basculement de l’héroïne comme du spectateur dans la nouvelle dimension de la pièce : l’enquête.
Au passage, une retraite possible a été fermée. L’irruption de la jeune fille, selon Colette Bagimont, est d’abord une protestation sémantique. Le refus de désigner les événements de 1994 au Rwanda comme une « tragédie », le devoir de les nommer comme il se doit : un génocide. Entre les deux termes, exclusion du fatum et donc questionnement des causes et des responsabilités. Par là même, les Morts ont aussi fermé les yeux à un spectacle de déploration, de bons sentiments, voire même de témoignage et de constat objectif. Le message interprété par Bagimont proscrit d’avance cette issue et prescrit un autre chemin : « pourquoi ? ».
À la différence de janvier 1999 et même d’Avignon, cette conclusion est mise en valeur, l’engagement de Bee Bee Bee prend même un tour assez solennel. Autrefois, on avait l’impression que Bee Bee Bee sautait le « pourquoi » mis en évidence par Bagimont pour en finir avec une émission dont le contrôle lui avait largement échappé, et sa promesse ne semblait pas sérieuse – Impression renforcée par l’indicatif électronique discordant qui la coupait en plein dans sa tirade – Tout finissait en queue de poisson – Il était difficile après cela de croire à son engagement résolu, tel qu’il se manifeste dès le début de la troisième partie.
À présent, non seulement elle tire avec force les conclusions de l’émission et prête quasiment une sorte de serment devant les téléspectateurs, mais nous en soulignons l’importance en lui donnant pour la première fois tout l’écran. Le public voit Bee Bee Bee « humaine » et Bee Bee Bee télévisuelle, géante, affirmer clairement qu’elle accepte en notre nom à tous sa dette envers les Morts, et qu’elle veut mettre « toute la puissance dont (elle) dispose » au service de cette cause.1
Et les Morts la prennent au mot – Ils viennent la chercher par la main, gentiment mais fermement, pour la soumettre à la « Litanie des Questions » – Pendant trente minutes un feu roulant de questions rwandaises va l’envelopper, et la musique va contribuer fortement à accentuer cet aspect obsessionnel – cela s’appelle d’ailleurs musicalement un « ostinato ».
Le développement de l’orchestration, l’adjonction du tambour de Muyango puis des voix, toute cette progression enivrante rappelle un peu la sensation du « Boléro » de Ravel où, à la fin, l’auditeur finit par être noyé dans le thème. Bee Bee Bee est quelque peu noyée dans les questions.
À la différence du Boléro, ce grand mouvement est régulièrement interrompu pour repartir de plus belle, il y a des pauses. Ces pauses, le refrain chanté, ont pour effet de ramener chaque fois tout ce que nous venons” “d’entendre, tout ce paquet de questions, à son objet : « ces appareils qui diffusent l’information… »
Car à travers Bee Bee Bee, ce sont ici les médias qui sont mis littéralement « à la question ». Trois choses sont adressées simultanément aux spectateurs pendant la « Litanie ».

D’abord, une grande quantité d’informations. Beaucoup de celles-ci leur échappent, d’autres sont très claires, mais de l’ensemble ils retiennent bien sûr le sentiment de leur ignorance et de la complexité d’un problème que, sans doute, comme la plupart, ils avaient étiqueté facilement : conflits ethniques. Le texte est construit de manière à ce qu’on sente bien que seuls des fragments d’une énorme histoire sont communiqués.
Ensuite, la stigmatisation du rôle des médias et presque la disqualification de leur usage, quelles que soient les bonnes intentions proclamées : « une hyène rusée… » etc. ; le Chœur dit aussi : « ils infectent les cœurs et souillent les esprits ». Deux différences avec Avignon : on ne les présente plus comme « la source du mal », ce qui était erroné, mais comme ceux qui ont propagé l’épidémie ; ensuite on adopte le temps présent : « ils infectent… » car le Chœur ne les met pas en cause seulement pour la période du génocide, mais jusqu’à aujourd’hui même. Il ne s’agit pas seulement de RTLM, véhicule de mort, mais de toute l’information dans les pays occidentaux, et ceci reste d’actualité.
Enfin, la mise au défi de Bee Bee Bee et de cette « puissance » dont elle dit disposer. « Diront-ils…? Parleront-ils de…? Qu’ils n’oublient pas de dire… » etc. Le Chœur prend Bee Bee Bee au mot de son serment, mais il lui donne aussi la mesure de ce qui devrait être osé.
Le tout a déjà l’allure d’un dossier d’instruction : des noms, des dates, des faits s’accumulent. Un procès reste à instruire. Est-ce que la TV peut être ce lieu de vérité et de justice ? Les refrains semblent induire que non.
Face à nous, pétrifiée sur sa chaise, tout le Chœur rassemblé dans son dos, Bee Bee Bee encaisse. Désormais, la musique prévoit une réaction récurrente : parfois, dans le flot de la litanie, Bee Bee Bee poussera quelques notes sur un simple son « Ha ! », comme si elle était suffoquée et que son cœur débordait. Et ce devait être son cas, et le nôtre. Fin de la deuxième partie. Entracte. Finalement Bee Bee Bee restera immobile, muette, seulement elle pourra, vers la fin de la « Litanie », se cacher le visage dans les mains.
Il faut remarquer qu’au début comme à la fin de ce premier grand pan de la pièce, l’humanité comme genre et famille constitue notre véritable interlocuteur dans notre travail.
Yolande commence son témoignage par « je suis un être humain de la planète Terre » et elle conclut debout, main levée paume vers nous : « moi, Yolande Mukagasana, je proclame à la face de l’humanité… » ; de même, le Chœur termine la « Litanie des Questions » en disant : « À travers nous, l’humanité vous regarde tristement » ; etc.
Ce type d’adresse, jugée par certains trop solennelle, emphatique, est pourtant la seule mesure juste de la question posée par 1994. Les gens massacrés avaient été exclus de l’humanité. « Si c’est un homme ». Cette question est entre les mains de tous, elle restera vaine tant qu’un génocide sera regardé comme un « dommage collatéral » de l’évolution. Celui qui pense comme cela est déjà prêt à accepter, un pas plus loin à justifier, un pas plus loin à participer à l’horreur.
Il nous paraît aussi heureux que tout ceci s’achève dans un grand mouvement musical où les deux cultures, occidentale et rwandaise, coexistent avec bonheur,
sans s’exploiter, sans concessions. Il y a dans cet acte même comme la promesse d’un dépassement possible des questions posées. En tout cas, dans cette direction : pouvoir œuvrer ensemble dans le respect des différences.