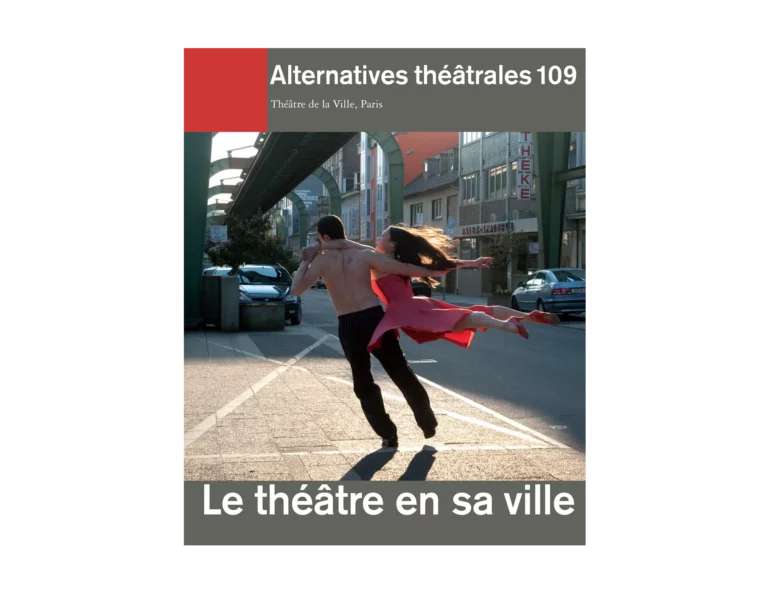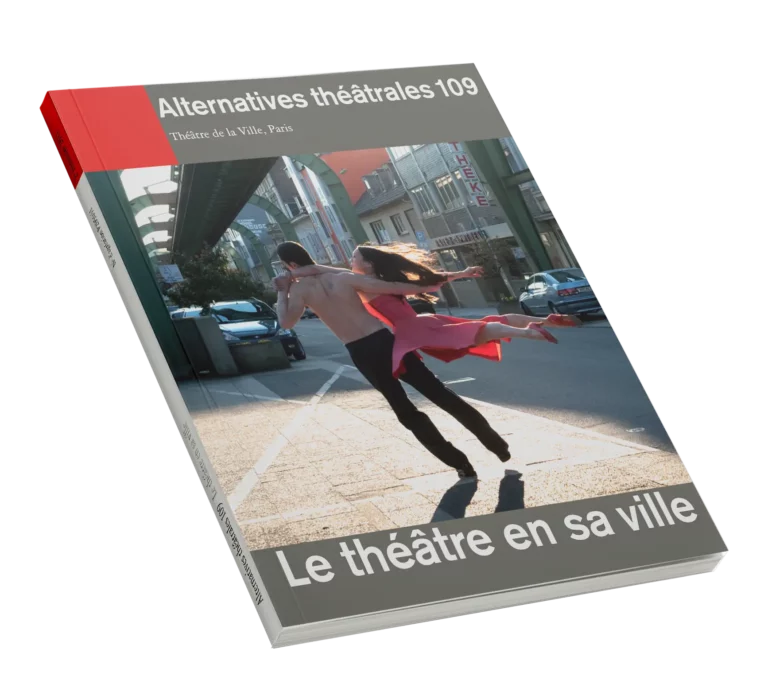IL S’AGIT ici non pas d’une étude – bien légitime, par ailleurs – mais d’un raccourci qui signale le lien rare autant que significatif qui se noue entre ce que l’on peut appeler « villes mineures » et des pratiques théâtrales ayant une identité forte, exemplaire, qui se rattachent à des communautés ignorées, peu fréquentées, parfois presqu’anonymes. Cette relation intéresse ici et elle fera l’objet des notes proposées aussi bien que des exemples évoqués.
Le hasard et les décideurs
Avant de remonter dans l’histoire plus éloignée, citons quelques exemples pour interroger justement ce cas bien particulier. Et essayer également d’analyser… Wupperthal, ville du bassin de la Ruhr, mais ville inconnue à l’échelle de l’Europe avant que Pina Bausch ne s’y installe et l’érige en territoire d’appartenance. Holstebro, communauté à peine connue même au Danemark, doit sa notoriété à l’affiliation de l’Odinteatretet d’Eugenio Barba qui l’ont retenue pour en faire leur foyer de travail. Pontedera, bourgade anonyme entre Pise et Florence, doit sa réputation à l’ouverture par Roberto Bacci, animateur et metteur en scène local, qui y convie Grotowski, artiste exilé en quête d’une ville d’attache… Et les exemples peuvent se multiplier ! Mais ces cas emblématiques fournissent déjà matière à réflexion.
De Wupperthal à Holstebro ou Pontedera, s’opère un même travail d’affirmation territoriale forte grâce à un artiste dont la présence fournit un label identitaire. Les deux termes entretiennent une relation de fidélité au nom de la réciprocité qui s’instaure. La ville, d’un côté, profite de la renommée du groupe ou du créateur qui l’a retenue comme lieu pour leur pratique et, de l’autre côté, les artistes bénéficient des rapports d’une longévité sécurisante avec une communauté bien précise. Cela s’impose comme conséquence d’une décision non programmée institutionnellement, mais issue d’une stratégie et d’un engagement bien personnalisés. La marque individuelle est déposée et c’est grâce à elle que l’alliance se scelle.
Il y a d’abord un artiste – à ses débuts ou au faîte de son parcours – qui entend s’éloigner des grands centres urbains pour s’abriter dans une « ville mineure ». Les motivations varient, mais elles concernent une quête de rattachement bien ancré – ce fut le cas pour le groupe nomade d’Eugenio Barba, dans les années soixante ou un refuge pour mieux se concentrer, à l’écart des capitales et de leur effervescence qui disperse, de leur extension qui affaiblit l’insertion territoriale, de leurs tentations décuplées. Barba fortifie son noyau initial dans le contexte d’une ville danoise ignorée, Grotowski s’installe pour se livrer à ses dernières expériences quelque part dans un coin peu réputé de l’Italie, Pina Bausch forge son esthétique à Wuppertal, dont le nom sera désormais à jamais assimilé à la danseuse de génie. Il y a du hasard qui intervient dans ces choix exemplaires. Et, bien qu’aujourd’hui fortement institutionnalisé, il est légitime de rappeler cette « ville mineure », Villeurbanne où Roger Planchon, réfractaire à Lyon, décida de s’installer et où il a bénéficié des aides lui ayant permis de mettre en place, d’imposer, d’affirmer un des parcours les plus représentatifs du théâtre français. Sans Planchon, le statut de Villeurbanne serait autre ! Et la ville sans ce qu’il a apporté, mais, également, sans son soutien l’aventure de l’artiste n’aurait pas jouit d’une même sécurité. Entraide indispensable, dialogue de la ville et d’un créateur !
De pareils échanges dépendent d’une décision politique puisque l’accueil de ces artistes, souvent fort exigeants, s’opère suite à des combats locaux non dépourvus d’acrimonie et de rejets marqués par une vision étroite de la politique culturelle. Il faut qu’il y ait un maire ou un animateur qui amorce corps et âme le processus pour que l’union s’accomplisse. Chacune des parties s’engage et chacune prend des risques ! L’artiste et le politique sont nécessaires l’un à l’autre ! Et de leur entente surgit cette cohabitation entre des villes mineures et des pratiques exemplaires. Dialectique à toujours prendre en considération, à ne pas oublier car c’est elle qui fonde et garantit le bon fonctionnement du pacte réciproquement consenti.
Le hasard l’emporte parfois car si c’est Barba qui a choisi Holstebro, Grotowski, lui, atterrit, au début des années soixante, dans la petite ville d’Opole suite à la nomination de son ami Ludwik Flaszen qui le convie à partager avec lui la direction. Et ainsi le Théâtre des 13 Rangs s’est constitué en emblème identitaire d’une ville désormais liée pour toujours aux débuts de Grotowski. Qui sait où elle se trouve sur la carte de la Pologne ? Et, deux décennies plus tard, Luca Ronconi accompagné de l’équipe de la ville, a imaginé et animé une des plus dynamiques aventures du théâtre italien au Fabricone de Prato. Laboratoire de recherche, siège pour de grands spectacles, lieu de débats, il se constitua, quelques années durant, en foyer effervescent de la scène italienne. Prato, grâce au Fabricone, s’est constituée en référence. Sans bénéficier d’une égale notoriété et sans avoir un même impact, comment ne pas rappeler le travail effectué par Olivier Perrier, Jean Paul Wenzel et Jean-Louis Hourdin à Hérisson, en France, à la fin du siècle dernier. Là-bas vont poursuivre leur recherche les membres du réputé groupe Footsbarn : le théâtre a arraché à l’anonymat une ville sans histoire qui, aujourd’hui, peut se flatter d’avoir accueilli une des aventures les plus originales du théâtre français. Opole, Hérisson… Plus récemment, une « ville mineure », en Allemagne, Gissen, a acquis une notoriété réelle – surprise agréable ! – grâce à l’école de théâtre qui, sous la direction d’Andrzej Wirth, a réuniles enseignants les plus réputés et a formé la nouvelle génération d’artistes. Conséquence qui fait sens, un de ces anciens étudiants, Hans Goebbels, vient de s’installer dans cet endroit désormais connu pour son aura universitaire et crée un théâtre hors-normes qui suscite un intérêt particulier.

ainsi qu’Olivier Perrier et Jean-PaulWenzel. Photo D. R.