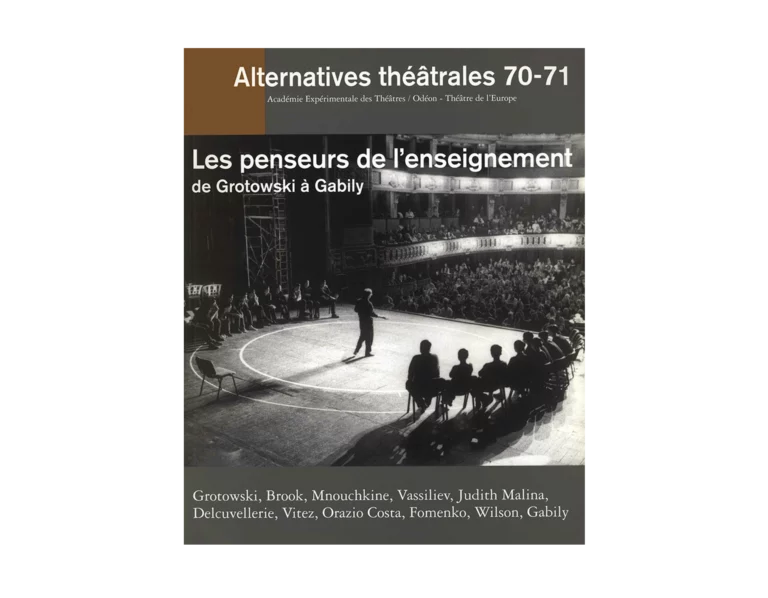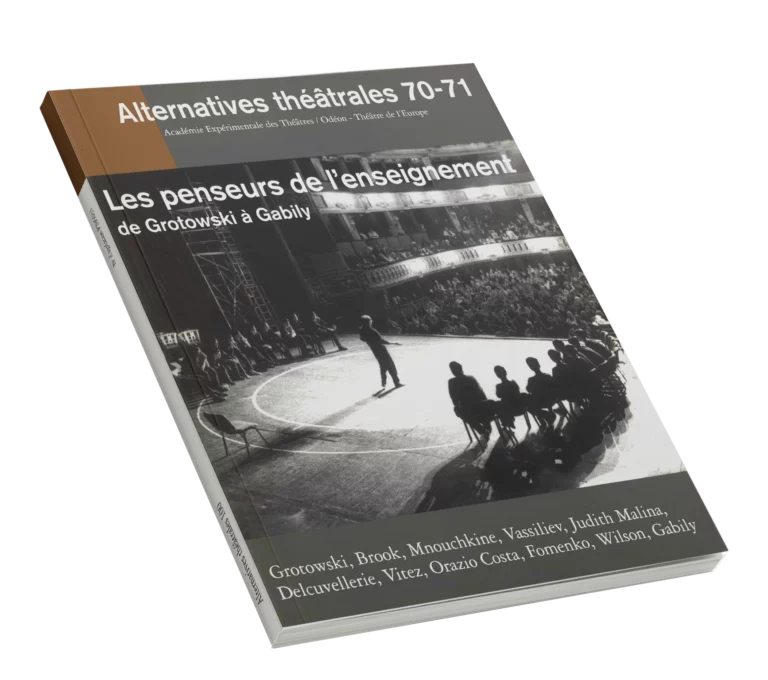« JE VOUDRAIS QU’ICI (dans cette école), où on étudie la maîtrise de l’art théâtral on oublie toutes ces discussions à propos du talent. Il est bien entendu que le talent est absolument nécessaire, cela va de soi. Quand on aborde la question de la maîtrise en tant que telle, on doit se dire que le talent c’est le talent, mais que, pour l’apprentissage, on doit encore faire appel à quelque chose de différent : à des techniques bien précises et aux moyens pour accéder à cette maîtrise. »
V. Meyerhold 1
- Nécessité d’une école pour le théâtre, pour l’art du théâtre ?
Au début du siècle, songeant au Théâtre de l’Avenir, Edward Gordon Craig écrit : « L’un des défauts du Théâtre d’Occident est de négliger les principes essentiels de l’Art ; d’inventer et de copier à la hâte de soi-disants changements qui attirent le public mais ne servent point l’Art. ( … ) La hâte, telle est la caractéristique du théâtre contemporain : réformes hâtives, hâtive préparation, hâtives idées appliquées à la hâte. » Et il continue : « La scène a besoin d’une école, de beaucoup d’écoles, d’écoles pratiques et techniques, écoles pour la théorie et l’étude expérimentale de l’Art du théâtre », ajoutant : « Mais où est donc l’école ? Je voudrais rester assis pour étudier semaine après semaine, tandis que quelqu’un qui sait tout du langage théâtral me communiquerait une partie de son savoir. » 2 - Pourtant l’opinion générale, et parfois celle des « professionels », des artistes eux-mêmes, demeure souvent pleine de suspicion à l’égard de l’enseignement du théâtre. On entend dire que l’on ne forme pas un acteur, qu’un acteur a une nature, un talent, une évidence et que, comme l’affirmait Rachel : « Celui qui n’a pas de talent, le Conservatoire en fait un acteur convenable, mais il tue tout talent en le forçant à jouer à sa façon. » Le Conservatoire évoqué par l’actrice a bien changé, c’est évident, mais cette conviction perdure. L’acteur n’a-t-il vraiment rien à apprendre ? Est-il normal qu’il s’agisse là d’une des rares professions artistiques où règne l’autoproclamation ? N ‘y a‑t-il pas un certain nombre de disciplines dont il doit se rendre maître ? N ‘a‑t-il pas à passer par tout un apprentissage de la scène ? Lorsqu’un Bernard Tapie monte sur le plateau et suscite les applaudissements nourris du public dans une scène où on lui applique des électrochocs en bord de plateau, on peut évidemment se demander ce qu’on entend par acteur, et il n’est évidemment pas question d’art ici. Quant au metteur en scène, on ne s’occupe que depuis peu en France de sa formation. Ceux qui participent activement et depuis longtemps à la formation de l’acteur sont souvent méfiants à propos de celle du metteur en scène, qui est pourtant « la spécialisation la plus large du monde » comme le disait Vsevolod Meyerhold 3, et ils les veulent bricoleurs, autodidactes, formés sur le tas. D’ailleurs, le futur metteur en scène ne doit-il pas, avant de s’intéresser à sa profession, aller d’abord à l’école de l’acteur, puisque — citons encore Meyerhold — « le théâtre du metteur en scène, c’est le théâtre de l’acteur, plus l’art de la composition d’ensemble. »4
- La pédagogie du théâtre entretient des rapports avec les institutions culturelles et l’état du théâtre. Les institutions culturelles : ainsi en France, l’État s’est d’abord préoccupé de décentralisation, de tisser un réseau de théâtres nationaux, plus que d’organiser systématiquement l’enseignement et la formation. L’état du théâtre : ainsi, l’école théâtrale soviétique qui, entièrement prise en charge par l’État, était paradoxalement à son sommet quand, pendant la période de stag nation, la scène était au centre des activités culturelles, périclite de manière inquiétante sous la pression du capitalisme sauvage, sauf dans quelques rares lieux. Mais la pédagogie théâtrale entretient également des relations étroites avec le niveau de savoir des praticiens, la place qu’ils occupent dans l’histoire récente du théâtre ainsi qu’avec le désir de savoir des jeunes générations, dont la culture et l’expérience diffèrent profondément de la génération précédente, particulièrement aujourd’hui.
- Qui va enseigner ?
Le pédagogue de théâtre n’est pas un instituteur, aimait à dire Antoine Vitez. Il est celui qui est « le moins professeur » écrit Jacques Lassalle. Doit-il être metteur en scène ? Comédien ? Au Conservatoire de Paris, c’est l’un ou l’autre ; dans les écoles de l’ex-Est, le plus souvent c’est un metteur en scène assisté d’anciens élèves et d’une équipe de spécialistes-techniciens des différentes disciplines répertoriées qui constituent la préparation à l’art du comédien. Meyerhold regrettait que les grands acteurs ne forment pas leurs successeurs, et il donnait l’exemple d’Igor Ilinski qui , selon lui, aurait pu se préoccuper personnellement de la transmission de son art à un jeune apprenti. Et encore : l’élève-comédien doit-il avoir un seul maître, à forte identité, pendant son séjour à l’école, ou doit-il faire l’expérience de plusieurs enseignements et conceptions du théâtre différents ?
- « Enseigner, c’est déjà mettre en scène, et mettre en scène, c’est encore enseigner » dit J. Lassalle. E. G. Craig constate en 1910 que le Théâtre d’Art de Moscou, oeuvre de Constantin Stanislavski et de Vladimir Nemirovitch-Dantchenko, « est une école »5. Dans la tradition des grands metteurs en scène pédagogues réformateurs du théâtre russe du XXe siècle, Piotr Fomenko va plus loin encore, et déclare en toute radicalité : « Si enseignement et mise en scène sont liés, le théâtre vit ; s’ils sont séparés le théâtre meurt. la mise en scène n’est pas une profession, c’est un mode de vie. Un travail incompréhensible, né au XXe siècle. Après avoir beaucoup aimé le théâtre du metteur en scène, je suis arrivé à la conclusion que la grande mise en scène se consacre à la formation d’une pléiade de grands acteurs. »
- Où enseigner ? le pédagogue (enseignant, professeur, maître — le terme est à discuter, et Antoine Vitez préfère le dernier, plus modeste à son goût que celui de professeur) forme-t-il des acteurs pour son propre théâtre ou également pour celui des autres ? Il arrive que d’un cours de théâtre éclose une troupe de théâtre, que d’une promotion naisse un nouveau théâtre. Cela a été le cas en Russie, pour le Théâtre Vakhrangov issu du Troisième Studio du Théâtre d’Art dirigé par Evgueni Vakhrangov, pour le Théâtre de la Taganka issu du cours de Iouri lioubimov à l’Institut Chrchoukine, ou, plus près de nous, pour l’Atelier de Piotr Fomenko dont le noyau d’acteurs est constitué par les élèves d’une de ses promotions au GITIS de Moscou. On connaît, d’un autre côté, la difficulté qu’ont parfois certains ac teurs formés par un metteur en scène à la forte personnalité pour s’intégrer dans une autre équipe. Enfin, il y a le cas des écoles comme celle du Théâtre National de Chaillot avec Virez qui posait le principe déjà ancien : « chaque théâtre aurait en son sein une école »6 ou celle du TNS à Strasbourg, qui aujourd’hui a la possibilité de recruter régulièrement des élèves issus de son école, ainsi totalement intégrée à la vie du théâtre. Meyerhold se pose la question en ces termes : une école dans un théâtre « se borne à préparer un groupe de remplaçants, de candidats pour les places vacantes. ( … ) Ce sont ces écoles qui sont responsables de l’absence de talents véritables et neufs sur nos scènes. Une école en dehors du théâtre doit produire des acteurs qui soient incapables de travailler dans un théâtre autre qui celui qu’ils fonderont eux-mêmes. Sera nouvelle l’école qui engendrera un théâtre nouveau. »7
- L’organisation de l’enseignement dans les écoles des pays de l’ex-Est a été polie par les recherches des grands metteurs en scène-acteurs et par l’approfondissement des diverses disciplines techniques. Chaque promotion se forme sous la houlette d’un professeur principal, metteur en scène-pédagogue responsable de l’ensemble des enseig nements pendant cinq ans. Antoine Virez a critiqué cette sytématisation 8, cette formation cloisonnée en facultés avec une initiation progressive — enseignement issu selon lui du vieux rationalisme du XIXe siècle. Pour lui, « l’enseignement du théâtre n’est pas constitué de l’addition de matières différentes, il n’est pas polytechnique, il veut être une ascèse de l’imagination »9 : une école de théâtre, c’est essentiellement un groupe de personnes autour d’un maître ; c’est le cercle où sont mêlés élèves débutants et élèves aguerris, parmi lesquels le maître est assis, et au centre duquel on s’exerce à jouer. le rôle du maître n’est pas de dire comment il faut jouer, mais d’entraîner le cercle à déchiffrer les signes donnés par le centre. l ‘école est-elle lieu d’un enseignement par disciplines, ou bien, sans programme pédagogique et progressif, un lieu de liberté er d’invention ? Est-elle d’abord « le plus beau théâtre du monde » comme le conçoit Virez, lieu où les élèves font le théâtre du maître, se confrontent à ses préoccupations ? Mais dans un cas comme dans l’autre, l’école apparaît bien comme une « usine de rêves », telle que l’imaginait Virez, toujours lui, ou comme à l’aube du siècle dernier, dans le Deuxième dialogue « De l’art du théâtre », la décrivait Craig de façon utopique — lieu de multiples possibles en dépit d’un fonctionnement rigoureux10 …
- Aujourd’hui où les frontières entre les arts deviennent comme dans les années vingt de plus en plus poreuses, on note partout, jusque dans les pays de tradition textocentrisre comme la France, une recherche de la pluridisciplinarité : le théâtre d’aujourd’hui a besoin d’un acteur polyvalent, doté d’un instrument complet, total — ainsi, pour la nouvelle génération d’acte urs fran çais, les comédiens russes de Lev Dodine sont emblématiques d’un tel interprète. N’y a‑t-il pas aujourd’hui possibilité de concevoir, de mettre en forme des disciplines spécifiques — comme celle que l’on pourrait nommer, à la suite de Meyerhold dans les années dix, « mouvement scénique », touchant à la fois au théâtre et à la danse 11, qui travaillerait sur les impulsions que le mouvement du corps peur donner aux mots prononcés. la question fondamentale qui se pose ne serait-elle pas de connecter entre elles les différentes disciplines et enseignements techniques (geste, voix, musique, rythmoplasrigue, acrobatie, etc.), de façon à ne pas séparer le travail de la voix de celui de l’ensemble du corps, et à reverser ces savoirs dans la classe d’interprétation, celle où l’on s’entraîne à jouer.
- Y a‑t-il une spécificité de la pédagogie théâtrale ? Comme dans toute école artistique, il n’y a pas d’enseignement neutre, il s’agit d’un enseig nement appliqué où le pédagogue a la charge de transmettre à la fois un savoir général sur les textes, les types de jeu, les techniques, les auteurs et un savoir personnel, lié à sa pratique, à l’aventure artistique qui est la sienne. Certains pédagogues se distinguent par la façon qu’ils ont de faire parcourir à leurs élèves plusieurs pans de l’histoire du théâtre, de leur faire travailler des dramaturgies et des styles différents, de tenter de leur faire voir tout le théâtre et pas seulement une branche de cet arbre touffu qu’est le théâtre. Le pédagogue doit aussi éveiller en l’élève une attitude créatrice, le goût de la recherche. Marqué au sceau de la transmission, la pédagogie théâtrale se caractérise donc par l’investigation, l’expérimentation. Le cours est un laboratoire, la pédagogie y est expérimentale : c’est « le temps de l’essai » comme écrivait Bernard Dort dans le n°5 des Cahiers de la Comédie-Française. Les paradoxes de Piotr Fomenko sont remplis d’une étrange sagesse : « Le théâtre reste vivant tant que les artistes ont besoin d’apprendre. Enseigner, c’est apprendre de ses élèves ». Au théâtre, n’enseigne-t-on rien mieux que ce que l’on découvre avec l’élève ? Il n’y a aucune recette, puisqu’à chaque fois il faut procéder à une élaboration spécifique des idées et des techniques qui doivent être adaptées aux spécificités physiques et psychiques de chacun et du groupe formé. Laboratoire, la classe de théâtre est aussi un lieu d’affects puissants (davantage encore que dans le cas d’autres arts), puisque « tout » de l’artiste en herbe est en jeu au présent. Comment faire coïncider ces affects inévitables et nécessaires et la rigueur d’une discipline, c’est une question que les grands réformateurs du théâtre n’ont cessé de se poser.
- Si la classe de musique ou de danse s’appuie sur des éléments incontestables : une partition, des notes, des mesures, des rythmes et des nuances indiqués, si elle est école de rigueur exigeant de l’instrumentiste un entraînement quotidien nécessaire de son corps et de son instrument (gammes, exercices à la barre), la classe de théâtre est d’abord lieu de partage et d’échanges : celui où, comme le dit Fomenko, « seul l’avenir dira qui est le maître et qui est l’élève », celui où, comme l’écrit Vakhtangov, « le metteur en scène et l’enseignant doivent tous deux faire passer ce qu’ils savent et ne jamais faire semblant de savoir quand ils ne savent pas. ( … ) dire en face, fermement et avec conviction : « je ne sais pas », et dire pourquoi. »12. Malgré ces différences remarquables, la présence d’un enseignement musical avancé paraît nécessaire dans une école de théâtre. Car la connaissance de la musique et de ses règles conduit le plus sûrement peut-être à la maîtrise du temps et de l’espace, capitale sur un plateau. Voir Meyerhold qui considérait la musique et tout particulièrement l’étude du rythme comme une discipline essentielle pour l’élève-acteur comme pour le metteur en scène.
- Lieu de partage et d’échanges, le cours de théâtre — d’interprétation comme de techniques — est un lieu de transmission de certaines règles (Meyerhold a parlé de « scénologie »), de certaines lois. Il n’y a pas dans le théâtre occidental de traditions codifiées comme dans les théâtres d’Asie, mais le théâtre n’existe pas sans mémoire, et l’étude du passé, des traditions orientales et occidentales, la recherche de ce qu’elles ont en commun, semble indispensable et enrichissante aujourd’hui. « L’étude des expériences passées rend l’acteur capable de trouver les bons moyens d’expression pour aujourd’hui. Si elle n’a pas lieu, cela pourra faire obstacle à son évolution artistique et même le conduire à faire fausse route » écrivait le comédien chinois Mei Lanfang. C’est aussi valable pour l’acteur occidental. La connaissance de ces règles, qui invite à mettre ses pas dans ceux des artistes qui vous ont précédés, n’implique d’ailleurs pas forcément leur respect, elle peut amener à les transgresser consciemment dans le but d’une efficacité d’un autre ordre. Pour casser les effets de théâtre attendus, il faut en comprendre la base, la structure : saisir ce qu’il y a à briser, avant de casser.
- Des règles ? Des lois ? On voit les sourcils du lecteur se froncer … Sans aller jusqu’à cette radicalité craiguienne — « Il faut découvrir et publier ces lois »13 — d’ailleurs partagée par nombre d’artistes du XXe siecle, on sera d’accord au moins pour constater que souvent l’acteur est un être fragile, le plus double, le plus exposé qui soit, et qu’il faut le doter d’une boussole. J. Lassalle avoue : « Les gens qui m’ont le plus apporté sont ceux dont le savoir n’avait d’égal que l’humilité, dont l’inlassable curiosité se doublait de bienveillance et dont la qualité de connaissances se doublait d’une pratique permanente du doute. Ceux qui brandissent des dogmes, des certitudes m’effraient. » L’acteur n’a sans doute pas besoin de gourou, pas plus que d’une pensée dogmatique, mais il a certainement besoin de repères fixes, pour affronter les dangers qu’ils l’attendent — peut-être s’agirait-il davantage d’une table d’orientation que de tables de la loi ?
- « Dieu sait ce qu’on fabrique dans les cours de théâtre » écrit Vakhtangov en 1918. « La principale erreur est de vouloir enseigner alors qu’il faut éduquer. »14 Et il précise : « L’éducation de l’acteur doit consister à enrichir son inconscient des capacités les plus diverses : être libre, concentré, sérieux, scénique, artistique, efficace, expressif, observateur, prompt à s’adapter, etc. Le nombre de ces capacités est infini. »15 Pédagogue inné, Vakhtangov réfléchissait à la formation de l’acteur comme à celle d’un être entier, à la fois artiste, homme et citoyen, à l’intérieur d’un groupe, individu dans un collectif qui seul est la mesure de sa créativité.
Cette formation, cette éducation implique-t-elle un en-dehors de l’école : que l’on sorte de l’école pour se former plus largement alors pourtant qu’on est encore à l’école ? La question est ouverte : Meyerhold affirmait qu’à l’enseignement de l’école devaient se combiner étroitement la lecture, la visite des musées, l’assistance aux concerts et les voyages. Vakhtangov, dans une lettre très touchante adressée à ses élèves, insiste sur l’importance de la période d’études pour les élèves-acteurs, dans leur école :
« À mes élèves.
Mes bien chers ! Si vous saviez comme vous êtes riches. Si vous saviez quel bonheur est le vôtre en cette vie. Et si vous saviez comme vous en êtes prodigues ! C’est toujours pareil : on ne comprend la valeur des choses qu’au moment de les perdre. Et si vous saviez comme c’est triste de penser que vous aussi vous comprendrez trop tard. Ce qu’on met des années à acquérir, ce pour quoi des vies se perdent, vous l’avez : vous avez un coin à vous. »16
- V. Meyerhold, 1918, LEKCII (Leçons), OGI, Moscou, 2000, p. 47 ↩︎
- E. G. Craig, « De certaines tendances fâcheuses du théâtre moderne », in « De l’art du théâtre. Deuxième dialogue » (1911 ), Circé, 1999, p.108, p.113. ↩︎
- « Meyerhold parle », in ÉCRITS SUR LE THÉÂTRE, traduction, préface et notes de B. Picon-Vallin, tome 4, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1982, p. 334. ↩︎
- Idem, p. 344. ↩︎
- E. G. Craig, « De l’art du théâtre. Deuxième dialogue », in op. cit., p. 168. ↩︎
- A. Vitez, « Douze propositions pour une École » (1982), in LE THÉÂTRE DES IDÉES, anthologie proposée par Danièle Sallenave et Georges Banu, Gallimard, NRF, 1991 p. 115. ↩︎
- Cf. V. Meyerhold, Du Théâtre (1913), in ÉCRITS SUR LE THÉÂTRE, tome 1, Lausanne, L’Âge d’Homme, 2001 , édition revue et augmentée, p. 107. ↩︎
- Cf. A. Vitez, « Ne pas montrer ce qui est dit » (1974), in op. cit., p. 181. ↩︎
- Cf. A. Vitez, « L’usine de rêves » (1971), in op. cit., p. 69. ↩︎
- E. G. Craig, « De l’art du théâtre. Deuxième dialogue » (1910), in op. cit., pp. 197 – 201. ↩︎
- Cf. V. Meyerhold , ÉCRITS SUR LE THÉÂTRE, vol 1, Lausanne, L’Âge d’Homme, 2001, édition revue et augmentée, p. 234 et p. 240. Meyerhold, à l’occasion de ses cours sur « le mouvement scénique » dans son studio de Saint Petersbourg, renvoie souvent au traité de chorégraphie du Quattrocento, écrit par l’italien Guglielmo Ebreo di Pesaro. ↩︎
- E. Vakhtangov, « Carnets » (1918), in ÉCRITS SUR LE THÉÂTRE, traduction, préface et notes d’H. Henry, Lausanne, L’Âge d’Homme, 2000, p. 198. ↩︎
- E.G.Craig, « De certaines tendances fâcheuses du théâtre moderne », in op. cit., p. 117. ↩︎
- E. Vakhtangov, « Carnets », in op. cit., p. 198. ↩︎
- Idem ↩︎
- E. Vakhtangov, « Lettre au Studio étudiant » ( 1915), in op. cit., p. 138. C’est moi qui souligne. ↩︎