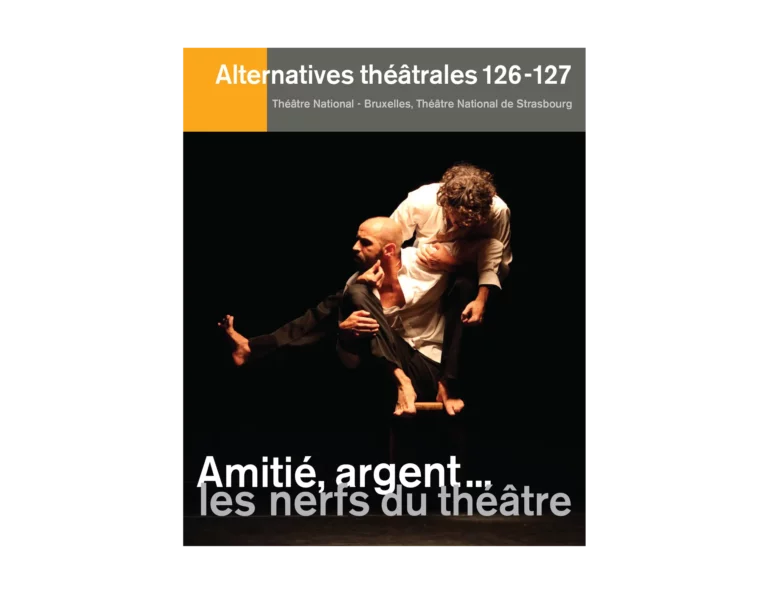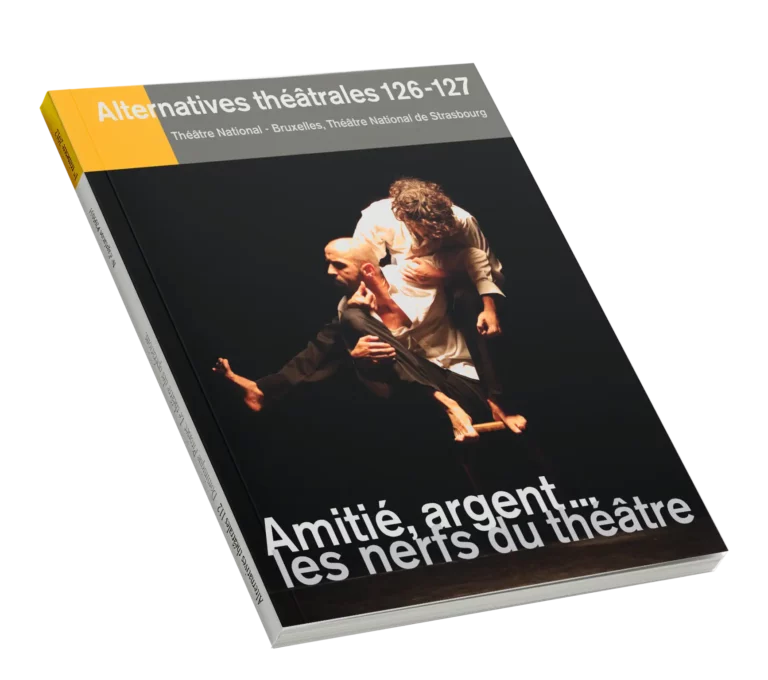C’EST DÈS L’ANTIQUITÉ que le théâtre a suscité une hostilité déclarée, mais c’est surtout entre le dernier quart du XVIe siècle et le premier tiers du XIXe que, dans toute l’Europe, les polémiques se sont déchaînées, produisant des pamphlets qui adoptaient un point de vue essentiellement théologico-moral ou métaphysique, au point de sembler négliger toute considération politique ou économique. De fait, quand Bossuet ou Nicole condamnent les comédiens, c’est pour les passions malsaines qu’ils excitent, non parce que, gagnant leur vie à s’exhiber sur scène, ils exercent une profession quasi prostitutionnelle. Seul le prince de Conti fait allusion à l’argent, en évoquant fugitivement l’appât du gain que le théâtre suscite ou les dépenses ruineuses qu’il entraîne.
Cette restriction du point de vue, dans la France du Grand Siècle, est moins la règle que l’exception. Dès que les polémistes s’emploient à compiler les arguments, les questions économiques surgissent. Ainsi, le secrétaire du prince de Conti, le Père Voisin, lie l’infamie des comédiens à la façon dont ils gagnent leur vie. Si l’argument de l’argent s’impose même aux théologiens essentiellement soucieux de morale, c’est que les questions pécuniaires sont essentielles pour une activité qui s’est récemment professionnalisée et a conquis une importance économique réelle. C’était du reste évident une génération plus tôt, dans la France des années 1630, où le théâtre devient une activité de loisir respectable, ouvertement encouragée par le pouvoir. Pour rétorquer aux attaques dont ils font l’objet, les dramaturges font en scène l’apologie de leur art, en se targuant de la protection du roi et en soulignant la respectabilité d’une profession éminemment rentable. La plus célèbre de ces pièces, L’ILLUSION COMIQUE de Corneille (1636), résume en un vers célèbre l’argument essentiel qui, avec l’approbation royale, établit la légitimité de ce nouveau métier : « Le théâtre est un fief dont les rentes sont bonnes ». Le point commun de ces pièces est de montrer, comme le fait LA COMÉDIE DES COMÉDIENS de Gougenot (1633), que des gens de tout sexe et de toute condition peuvent embrasser la profession de comédien, sûrs d’y assouvir leurs aspirations et d’y trouver leur intérêt.
À l’origine, les motifs religieux étaient essentiels dans les réactions théâtrophobes. Les Pères de l’église lançaient l’anathème contre les spectacles parce que ceux- ci étaient étroitement liés au culte païen. Le refus d’aller au spectacle était pour eux – Tertullien notamment – un moyen de marquer leur différence, en rejetant les distractions du monde pour se consacrer à leur salut. À leur exemple, les polémistes modernes font de la théâtrophobie une arme religieuse : ainsi, les protestants s’attaquent au théâtre pour condamner la propension théâtrale et idolâtre de la religion papiste. Mais si le théâtre pose problème, c’est aussi – et peut-être surtout – parce que sa transformation en activité rentable et régulière produit des perturbations économiques et politiques. Dans les querelles du théâtre, si l’argumen- taire est religieux, l’impulsion est économique. La chose est éclatante dans la première grande crise survenue en France : le procès intenté, en 1541, au Parlement de Paris, aux entrepreneurs de mystères. Ceux-ci sont poursuivis parce que les représentations coûtent de plus en plus cher et sont de plus en plus longues : elles durent une bonne partie de la journée et s’étalent sur plusieurs mois. Le catalogue des reproches est copieux : ces spectacles travestissent le verbe divin au lieu de le servir, perturbent totalement l’activité productive, ruinent les spectateurs en les incitant à l’oisiveté, l’ivrognerie et la fornication, mettent en danger les familles et précarisent la charité publique puisque, à cause d’eux, les aumônes ont considérablement baissé. Cette avalanche d’arguments reste sans effet, car le roi intervient, autorisant les représentations. Les entrepreneurs échappent donc à l’interdiction, mais ils doivent verser une forte contribution pour les pauvres. Le théâtre est tenu de compenser une baisse des aumônes dont rien n’indique qu’il soit vraiment responsable.
L’affaire est manifestement liée aux bouleversements économiques que le théâtre provoque, avant même de se professionnaliser. En 1541, il n’y a pas encore en France de troupes stables : pour les mystères, on recrute des amateurs. Mais les spectacles deviennent une entreprise d’envergure : ils demandent des investissements considérables, au point qu’il faille former une société d’entrepreneurs, et les profits sont à la mesure des engagements. Ces bouleversements suscitent des tensions idéologiques et politiques, car les clercs du parlement voient d’un mauvais œil des hommes d’argent, sans compétence théologique, prendre la direction d’une activité didactique et dévotionnelle qui était jusque là pilotée par des clercs. Ils se sentent menacés dans leur pouvoir et leur savoir en voyant ces « parvenus » transformer une mission traditionnelle de l’église en une entreprise commerciale rentable et prestigieuse.
Cette affaire sera souvent évoquée par les adversaires du théâtre (Voisin transcrit le document) et même en dehors de l’hexagone (Rymer). Mais la principale trace qu’elle laissera est le « droit des pauvres » qui, au XVIIe siècle et jusqu’en 1941, s’imposera en France aux représentations théâtrales, comme si seul le théâtre, et non le cabaret, détournait l’argent des aumônes. La France n’est pas le seul pays à faire financer la charité publique par le théâtre : en Espagne, dès la fin du XVIe siècle, l’activité théâtrale est complètement intégrée à l’économie de la charité. Les hôpitaux et certaines œuvres, sous l’autorité des municipalités, se financent grâce au théâtre : ils louent aux troupes les cours intérieures de leurs bâtiments (d’où le nom de corralespour désigner les théâtres) puis des édifices spécialement construits pour les représentations, et prélèvent une part du prix des places. Aussi quand les théâtrophobes entrent en lice, au moment des suspensions des spectacles pour cause de deuil royal, ils dénoncent le caractère impie de cette pratique : c’est mettre un défaut dans la Providence de Dieu, faire comme s’il avait besoin du diable pour aider les pauvres. De leur côté, les défenseurs, comme la ville de Madrid, ne manquent alors jamais de rappeler aux autorités l’argent qu’il faudra trouver si la suspension se transforme en interdiction pérenne.