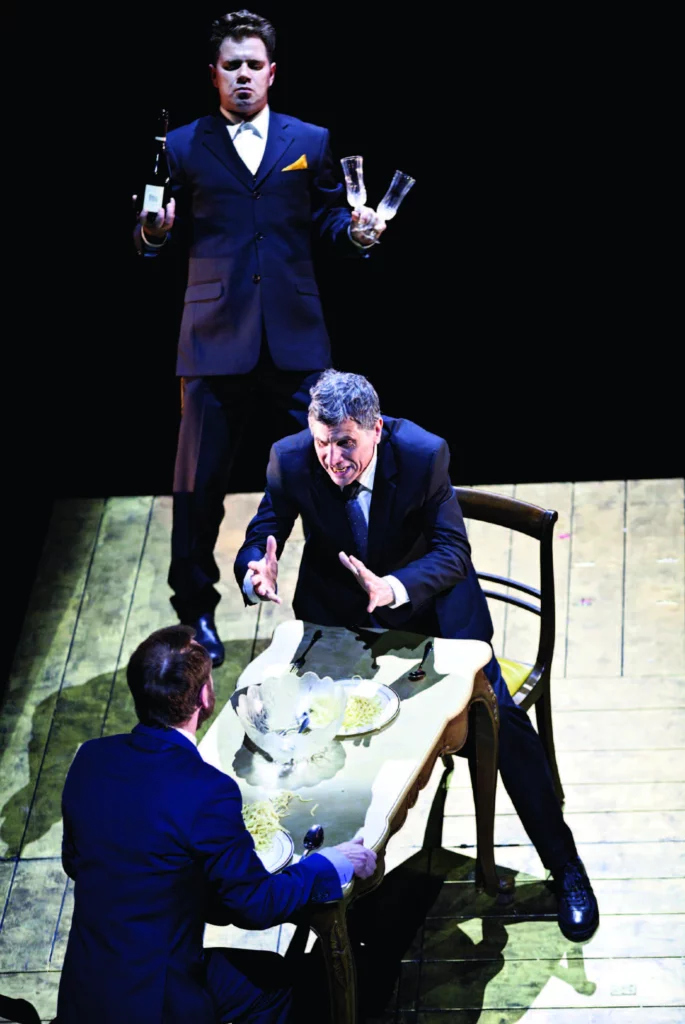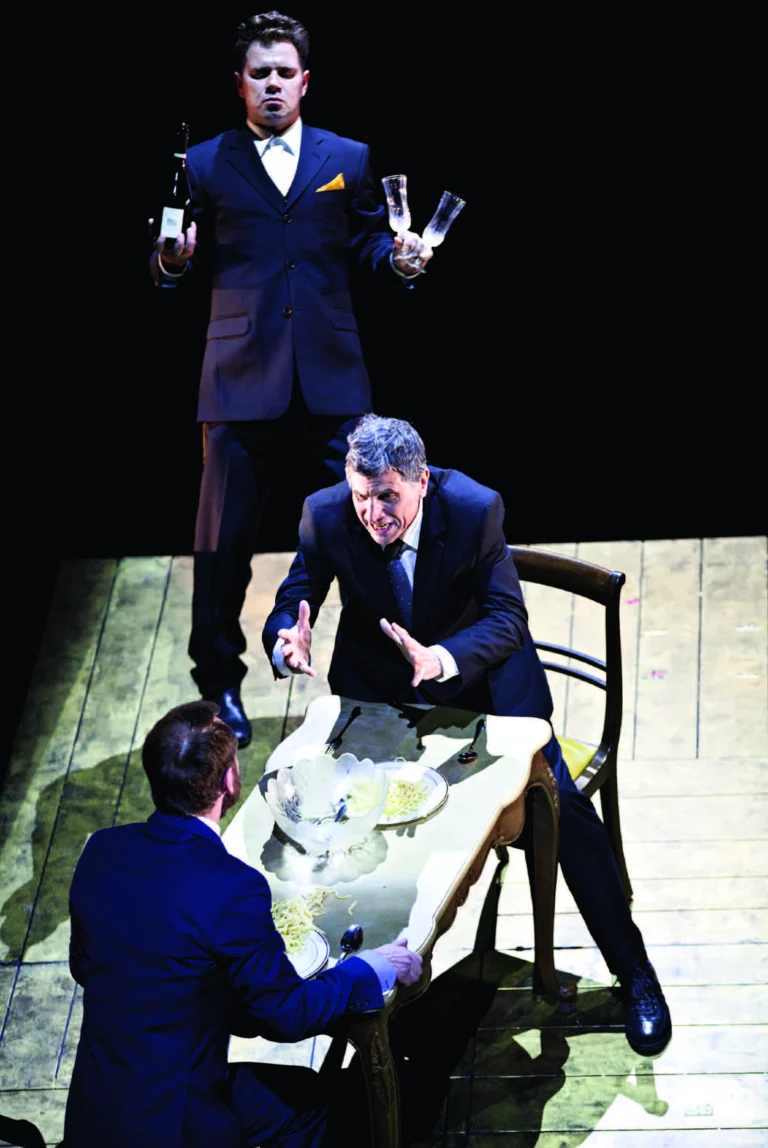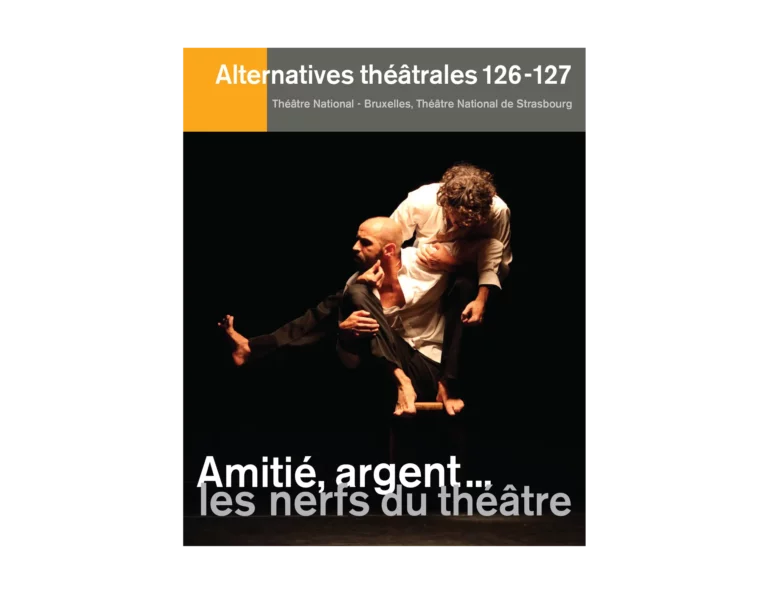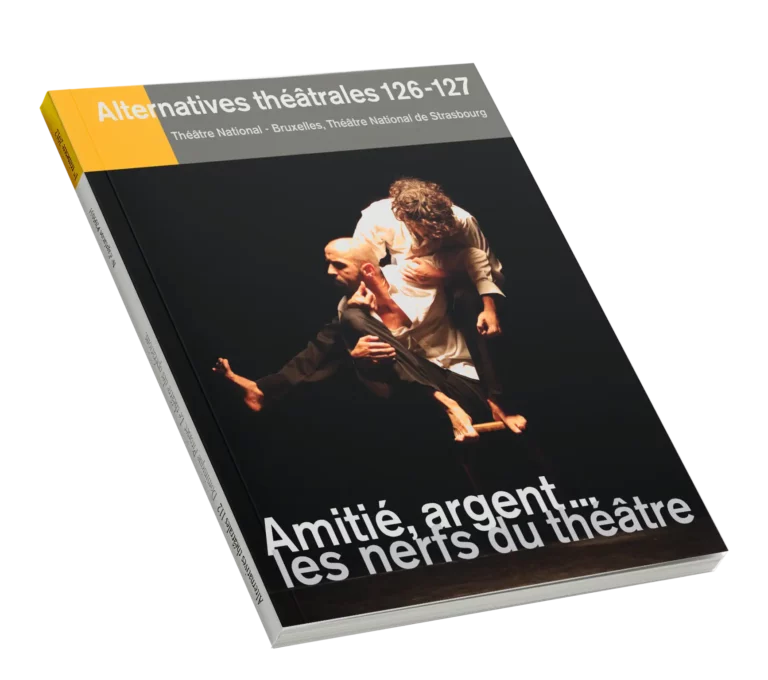LE DISPOSITIF « Cartocrise » permet de suivre le décompte morbide des annulations de festivals ou suppressions de structures artistiques et culturelles, afin de « mesurer l’impact des choix politiques actuels » et « mieux communiquer sur la lame de fond qui balaie le secteur culturel ». Le 22 juin 2015, il répertorie pas moins de deux cent quinze points d’impact, dont une majorité dans le spectacle vivant (arts de la rue, danse, musique, théâtre), contre quarante-huit en janvier 20151. À la prétendue « crise de surproduction » pointée du doigt une dizaine d’années auparavant semble bien se substituer aujourd’hui une gestion de la pénurie. Annoncée de longue date, la crise que traverse le spectacle vivant exerce une influence, non seulement sur l’évolution du secteur, mais surtout sur les discours de justification qui lui sont apportés aussi bien par les décideurs politiques que les artistes eux-mêmes. Basculant brutalement du déni de la dimension économique de la création – entretenu par une certaine mythologie d’artiste – au défi gestionnaire préconisé par les structures, les « cités du théâtre » sont confrontées à un brutal changement de paradigme.
Alors qu’un certain nombre de structures sont menacées – Théâtre de la Cité Internationale, Confluences, Forum de Blanc-Mesnil), d’autres comprimées (absorption du CDN Alpes par la Maison de la Culture de Grenoble en 2013) ou redéfinies (Théâtre de l’Aquarium supposé devenir simple lieu d’accueil en 2016), et que la subvention publique réduit partout la voilure (notamment à destination des compagnies subventionnées), émerge aujourd’hui un affrontement symbolique entre conceptions gestionnaire et humaniste : un nouveau type de discours, perdant de vue les justifications fondamentales du bien-fondé de la culture, s’engouffre dans une tentative hasardeuse de justification du poids économique de la culture, cependant que se multiplient les expérimentations visant à pallier la baisse des subventions et le désengagement du système d’intervention publique sur le marché artistique. Parfaitement réversible, cette nouvelle rhétorique managériale impose aux professions théâtrales une justification à double tranchant : elle peut aussi bien légitimer leur mise en concurrence au titre de la compétitivité que leur réglementation au motif de leurs retombées positives sur l’activité économique et l’emploi.
Les mots des maux
Jamais peut-être les mots de la crise n’ont été aussi étroitement associés au spectacle : tantôt, des hommes de théâtre se demandent : « y a‑t-il une crise du théâtre ? », affirmant comme olivier Py que « tout va ensemble : l’émergence, la décentralisation et le théâtre public, particulièrement en temps de crise »2 ; tantôt ils se félicitent, comme Jean-Michel Ribes, du fait que « la culture est notre pétrole », rappelant que « quand le festival d’Avignon s’arrête, c’est le Vaucluse entier qui est en faillite » et affirmant en manière de bravade : « Le budget de la culture, une goutte d’eau dans la mer de la dette »3 ; tantôt ils proposent des « trousses de secours en période de crise », comme au Théâtre du Rond-Point, cherchant à comprendre comment « nous sommes entrés dans un autre monde, nous y sommes de plain-pied […], pas encore parés à de nouvelles façons de travailler et gagner sa vie »4… La lettre ouverte à Fleur Pellerin sur « l’entreprendre dans la culture » du 12 mars 2015, à l’initiative de l’Union fédérale d’intervention des structures culturelles (UFISC), en réponse au rapport de Steve hearn5, n’échappe pas à la règle, arguant de la responsabilité de l’état sur la « dimension socio- économique » et la « biodiversité économique » du champ culturel6. L’ambiguïté était déjà présente dans le « Manifeste pour une autre économie de l’art et de la culture » du 20 décembre 2007, vantant les mérites d’une « économie plurielle », « artisanale et de main d’œuvre »7.
Ces velléités de mobilisation, comme autant de certificats de bonne conduite et de gages de coopération, sont relayées par des politiques tels que le président François hollande promettant, dans son discours du 15 juillet 2012 en Avignon, que « le spectacle vivant sera la priorité du Ministère de la culture », car la culture doit être un levier de croissance en temps de crise : « La culture, c’est aussi un investissement, c’est ce qui permet de créer de nombreuses activités, des emplois. Voilà pourquoi la culture fait partie de notre projet de développement ! »8. C’est ensuite au tour d’Aurélie Filippetti, convaincue qu’«il n’y aura pas de redressement productif sans redressement créatif »,de promettre qu’il faut « valoriser pleinement les externalités positives de la culture »9, puis finalement de Fleur Pellerin : « espace de création et vecteur de lien social, la culture est aussi un formidable terreau pour entreprendre »10. Une telle vision est censée être mise en œuvre par la loi sur la création artistique, annoncée dès 2012, étendue à l’architecture et au patrimoine en 2014 et finalement promulguée en 2015. Tout en postulant le caractère intangible de la liberté de création, le titre I de l’avant-projet fixe aux « artistes, avec l’ensemble des professions des structures publiques et privées de création », l’objectif suivant : « Ensemble, ils contribuent au développement économique et de l’emploi, ainsi qu’au rayonnement de la France à l’étranger »11. En quelques années, la rhétorique institutionnelle a donc fait sienne la justification des retombées économiques et symboliques de la culture, ainsi mise en demeure de pérenniser une politique de la grandeur multiséculaire, tout en dégageant des ressources marchandes indirectes, notamment à travers l’industrie du tourisme ou du luxe.
Préconisations paradoxales
En dépit des mises en garde d’experts tels que Jean-Pierre Saez, directeur de l’observatoire des politiques culturelles, remarquant que « le paradigme gestionnaire gagne du terrain, au détriment d’un grand dessein pour et par la culture »12, mais également de professionnels clairvoyants tels que Madeleine Louarn, directrice artistique du théâtre de l’Entresort à Morlaix et présidente du Syndeac, constatant que la culture est en train de « traverser une crise sans précédent », qu’«on est là devant vraiment une crise de structure », « un changement de paradigme »13, rares sont les voix discordantes : certains dénoncent pourtant, à l’instar de Jack Ralite, instigateur des états généraux de la culture, dans une lettre ouverte au président du 13 février 2014, le traitement managérial d’une « logique financière d’état », voire « l’allégeance dévorante à l’argent » visant à « donner au capital humain un traitement économique» ; il rappelle que « la politique culturelle ne peut marcher à la dérive des vents budgétaires » et propose un renversement de perspective : « La crise ne rend pas la culture moins nécessaire, elle la rend au contraire plus indispensable »14.
- http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/cartocrise-culturefrancaise-tu-te-meurs26647#6/51.000/2.000 ↩︎
- Olivier Py, Christian Schiaretti, Emmanuel Demarcy-Mota, LaTerrasse no 212, 26 août 2013. ↩︎
- Journal du Dimanche, 16 juillet 2012. ↩︎
- http://2013 – 2014.theatredurondpoint.fr/saison/cycle.cfm/6616-trousses-de-secours-en-periode-de-crise.html ↩︎
- Rapport sur le développement de l’entrepreneuriat dans le secteur culturel en France, juin 2014. ↩︎
- http://ufisc.org/component/content/article/45-page-daccueil/227-lettre-ouverte-a-madame-la-ministre-de-la-culture.html ↩︎
- http://www.ufisc.org/l‑ufisc/manifeste.html ↩︎
- http://www.franceculture.fr/2012 – 07-15-avignon-2012-francois-hollande-veut-preserver-la-culture-malgre-les-conditions-economique ↩︎
- Libération, 12 juin 2012. ↩︎
- « Entreprendre dans la Culture », 25 – 27 mars 2015. ↩︎
- Avant-projet de loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, présenté au conseil des ministres au premier trimestre 2015. ↩︎
- La Terrasse no 234, juillet 2015, p. 40 – 41. ↩︎
- « Le festival d’Avignon, le théâtre, la crise et le renouveau » : http://www.rfi.fr/france/20150706-festival-avignon-theatre-crise-renouveau-aquarium-cgt-helle-syndeac ↩︎
- http://www.rfi.fr/france/20150706-festival-avignon-theatre-crise-renouveau-aquarium-cgt-helle-syndeac ↩︎
- La Terrasse no 222, juillet 2014. ↩︎
- Isabelle Barbéris et Martial Poirson, ÉCONOMIE DU SPECTACLE VIVANT, Paris, Puf, « QSJ ? », rééd. 2015. ↩︎
- « Des vaches maigres, faire chou gras », Le Monde, 2 juin 2015. ↩︎
- http://www.lesbeauxprojets.com/2012/03/15/la-parabole-des-tuileries/comment-page‑1/ ↩︎
- « La culture, plus on en consomme, plus on a envie d’en consommer », Le Monde, 9 mars 2012. ↩︎
- Yann Moulier-Boutang, L’ABEILLE ET L’ÉCONOMISTE, Paris, Carnets Nord, 2010. ↩︎
- Martial Poirson et Emmanuel Wallon, « Théâtre en travail »,Théâtre/Public no 217, juin 2015. ↩︎
- Salmon Kurt, Comment diffuseurs et institutions culturelles doivent-ils se réformer à l’ère du numérique ? Forum d’Avignon, juillet 2014. ↩︎
- « Notre temps collectif », 4 – 7 juin 2015, Théâtre de la Bastille ; « Troupes, collectifs, compagnies, enjeux socio-esthétiques des modes d’organisation et de création dans le spectacle vivant », 1 – 3 avril 2015, Lyon-Valence. ↩︎
- Martial Poirson, « Capitalisme artiste et optimisation du capital attentionnel », L’ÉCONOMIE DE L’ATTENTION : NOUVEL HORIZON DU CAPITALISME ? Paris, La Découverte, 2014, p. 267 – 287. ↩︎
- « Collecte des données, arme d’intrusion massive », Libération, 24 septembre 2014. ↩︎
- Voir mon article « Quand on parle d’argent au théâtre » page 60 dans le présent volume. ↩︎