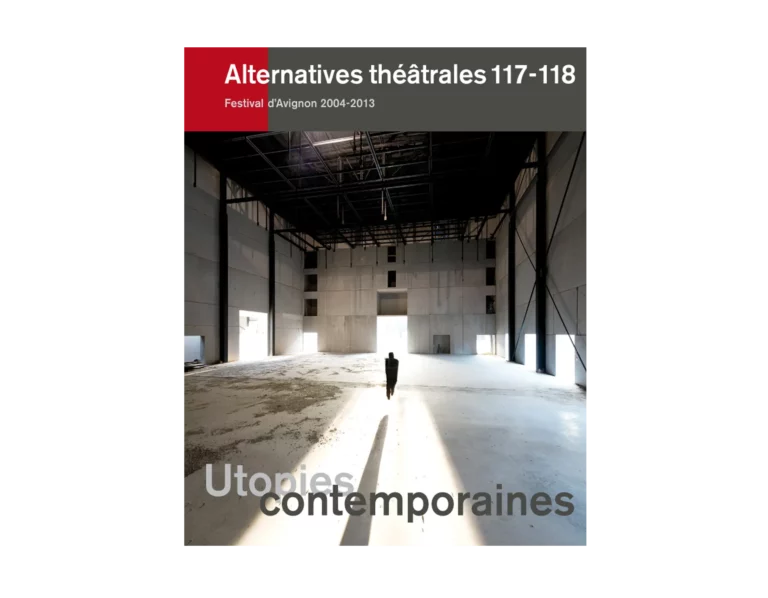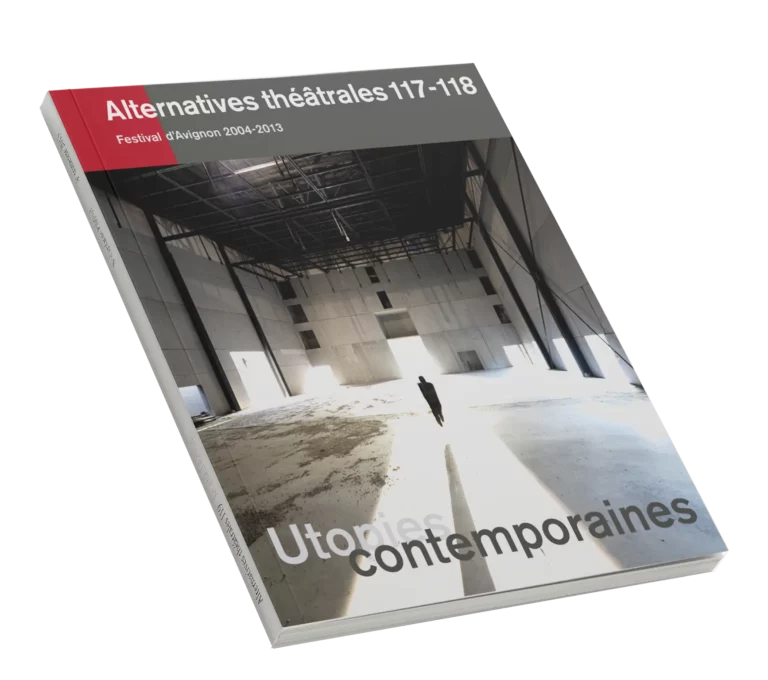GEORGES BANU : Vous arrivez à la direction du Festival d’Avignon après le grand « choc » de 2003, qui a révélé des conflits très violents à l’intérieur de la vie théâtrale française. Cette situation a‑t-elle eu des retombées sur l’édition 2004 ?
Vincent Baudriller : Nous avons été nommés au Festival en janvier 2003, pour en assumer la direction à partir de septembre 2003. Notre projet pour le Festival d’Avignon a donc été écrit avant cette crise. Les questions qui en sont le cœur, à savoir être au service des artistes, les accompagner dans leur geste de création pour le partager avec les spectateurs, tout cela est pensé avant les événements de juillet 2003. Au centre donc, la création et la production qui la rend possible. Et aussi le choix de s’installer à Avignon et de modifier ainsi le rapport du Festival à son territoire pour se doter d’une plus grande liberté et instituer une nouvelle temporalité dans notre lien au public comme aux artistes. Ici, on travaille dans un rapport au temps qui est différent de celui de Paris, tout comme l’est le lien à cet espace si particulier de l’architecture d’Avignon. Tous ces enjeux du projet ont donc été définis et discutés avec l’État et les collectivités territoriales bien avant juillet 2003. L’annulation du Festival, en créant comme une cassure, a peut-être rendu plus visible la nécessité des changements que nous proposions et, paradoxalement, accéléré leur mise en place. Car en 2004, il était devenu nécessaire de faire repartir le Festival.
Hortense Archambault : Le fait qu’Avignon n’est pas séparée du reste de l’année et concentre toutes les problématiques du théâtre français, voire européen, est devenu extrêmement visible en 2003. C’est donc un endroit absolument fondamental pour mener des débats esthétiques et réfléchir aux politiques culturelles. Cela nous a tout de suite conduit à questionner la place des rencontres professionnelles et à réaliser, par exemple, l’ouverture du Cloître Saint-Louis, où se situe les bureaux du Festival, aux débats publics. Finalement, l’une des choses qui s’était avérée très complexe en 2003, c’était le statut de la parole. Devait-elle avoir lieu sur les plateaux ou en dehors ? Est-ce qu’un silence artistique rendait possible une parole à l’extérieur du plateau ou, au contraire, est-ce que le silence devenait dominant ? Qu’est-ce qui est au cœur d’un projet comme le Festival d’Avignon ? Il y avait également une stratégie à l’œuvre qui a consisté à démontrer, à travers l’annulation des festivals, le pouvoir économique de la culture. Cette logique était cohérente dans la bataille que les salariés du spectacle menaient pour conserver leur statut d’indemnisation chômage. Les désaccords ne portaient pas sur cette question-là, mais sur la définition d’un théâtre engagé, je crois. Nous nous sommes saisis ensuite de ces questions.
V. B. : Notre projet s’ancrait sur la promotion ici, à Avignon, d’un théâtre contemporain de création, ouvert au plus grand nombre. Nous avions choisi les quatre premiers artistes associés, c’est-à-dire les quatre regards différents qu’on allait porter sur le théâtre au cours de notre premier mandat. Comme lorsqu’on navigue contre le vent à la voile, nous avions notre cap et nous allions tirer des bords différents chaque année avec Thomas Ostermeier, Josef Nadj, Jan Fabre et Frédéric Fisbach. Il se trouve qu’effectivement, le choix du premier artiste associé était une réponse assez juste aux événements de 2003, puisque le théâtre allemand posait à la fois la question de la permanence – ce système étant basé sur la notion de troupe – et celle de l’engagement politique de l’artiste sur le plateau, les questions politiques y étant en général abordées plus frontalement qu’en France. Le choix de Thomas Ostermeier de présenter WOYZECK dans la Cour d’honneur en allemand, avec un décor où il fait entrer la périphérie au centre du Palais, résonnait avec les discussions qui avaient eu lieu l’année précédente et annonçait quelque chose des festivals que nous voulions faire ensuite, à savoir mettre au centre ce qui ne l’était pas d’habitude dans le paysage théâtral français.
G. B. : Les artistes qui ont été associés étaient un peu de votre génération. Est-ce que, dix ans plus tard, il vous semble qu’une nouvelle génération est apparue ? Vous savez que du temps de Goethe, une génération durait vingt ans. Ensuite, au début du XXe siècle, une génération durait quinze ans. Et maintenant, on considère qu’elle dure dix ans.
V. B. : Je ne dirais pas que nous avons eu une approche « générationnelle ». Nous n’avons jamais réfléchi comme cela. Quand nous sommes nommés à la direction du Festival à trente-cinq et trente-trois ans, nous arrivons avec notre âge, notre expérience, notre regard sur le théâtre, et nos complicités avec des artistes de notre génération. Il y a eu de fait l’ouverture à une nouvelle génération, qui était la nôtre, invitée sur les grands plateaux d’Avignon, comme nous continuons d’inviter aujourd’hui des plus jeunes. Néanmoins, pour nous, ce qui est important, c’est de faire dialoguer les générations d’artistes dans les programmations et les générations de spectateurs dans les salles.
H. A. : Dans les artistes que nous avons invités, il y a Bernard Sobel, Jean-Pierre Vincent, Patrice Chéreau, Ariane Mnouchkine, Claude Régy, Alain Françon ou Peter Brook, tout comme des jeunes artistes qui ne faisaient que leur troisième spectacle à Avignon. Pour nous, ce qui était important, c’était d’être à la fois dans une reconnaissance des maîtres et une attention aux jeunes artistes qui commencent à faire leur chemin. Nous avons conscience d’être des passeurs entre générations et, d’une certaine manière, cela répond à la problématique de la transmission qui, aujourd’hui, fonctionne mal dans le théâtre français. Une manière, sans doute, d’être en phase avec cette accélération dans les changements générationnels, pas seulement dans le théâtre, mais aussi dans la société en général. On assiste en effet à de profonds bouleversements des codes de représentation, notamment avec l’arrivée des nouvelles technologies, qui entraîne de nouvelles façons de regarder, d’écouter, d’apprendre et de créer du lien social.
V. B. : Pour les artistes associés, nous avons toujours choisi des artistes qui étaient en chemin dans leur travail, mais la question de l’âge n’était pas déterminante. Quand il arrive en 1947, Jean Vilar a trente-cinq ans. Quand il révolutionne lui-même son Festival, en 1966 – 67, il invite des artistes de moins de quarante ans, avec des jeunes metteurs en scène comme Jorge Lavelli, Antoine Bourseiller ou Roger Planchon. Quand Bernard Faivre d’Arcier arrive en 1980, une nouvelle vague arrive aussi avec lui, comme Daniel Mesguich, Jean-Pierre Vincent, Georges Lavaudant. Il y a en cela quelque chose de naturel : le Festival est toujours en mouvement.
Ces dernières années, pointe sur les scènes françaises et internationales une nouvelle génération : des artistes qui ont une trentaine d’années, et donc qui ont grandi au théâtre à travers le Festival de ces dix dernières années. Vincent Macaigne, par exemple. Lorsque, jeune étudiant, il commence à venir au Festival, nous en sommes déjà les directeurs. Chez lui, comme chez d’autres, s’exprime un rapport différent au théâtre, les référents ne sont plus forcément issus de la génération précédente d’artistes français avec qui le jeune créateur devait dialoguer ou s’affronter, en trouvant son chemin. Ce qui est intéressant, pour cette génération qui arrive, c’est que leurs référents sont issus de l’ensemble du théâtre européen et international. Bien sûr, il y a toujours les professeurs de conservatoires, les grands maîtres ou metteurs en scène qui dirigent les théâtres nationaux, mais il y a aussi Romeo Castellucci, Jan Fabre, Rodrigo García, etc. Leur imaginaire est beaucoup plus vaste. La notion du possible sur un plateau aussi. C’est le résultat d’une ouverture qui s’est faite ici, à Avignon, et plus largement sur l’ensemble du territoire français, que ce soit au Festival d’Automne à Paris ou dans la plupart des grandes scènes françaises, qui, elles aussi, ont invité des artistes d’horizons très différents.
H. A. : Chaque direction du Festival est résolument de son temps, et nous comme les autres. Cela se reflète dans la manière dont nous travaillons : le fait de diriger à deux, de réfléchir avec un ou deux artistes associés, de revendiquer une programmation qui ne serait pas thématisée, mais qui n’en serait pas moins cohérente et très construite, avec de véritables articulations entre les différentes formes – de la conférence au spectacle. Nous essayons d’être plutôt dans une logique de commissariat d’expositions, pour que les œuvres puissent se faire écho, tout en laissant au spectateur la liberté d’élaborer son propre parcours. Nous sommes une génération qui a connu le mur de Berlin, puis sa chute, marquant une coupure dans notre formation politique, mais aussi l’arrivée des nouvelles technologies, induisant un nouveau rapport au savoir. Nous avons connu la fin d’un monde et l’apparition d’un autre, comme un certain nombre d’artistes qui ont marqué le théâtre européen, Krysztof Warlikowski, Romeo Castellucci, Thomas Ostermeier, Frank Castorf. Et c’est assez passionnant d’essayer de témoigner de cela, y compris dans notre rapport à la construction européenne, que nous avons toujours essayé de défendre, croyant encore dans ce projet tout en en percevant bien les limites.
Bernard Debroux : On est frappé, depuis le début de vos responsabilités au Festival d’Avignon, par l’importance que vous accordez à la pensée de la programmation. Peut-être est-ce un des festivals européens où cela apparaît le plus marquant. Ici, on sent une véritable volonté de trouver une pertinence de programmation. Le travail avec l’artiste associé, ce n’est pas simplement travailler avec quelqu’un qui a une sensibilité et des complicités avec un certain nombre d’artistes, mais avec lui s’élabore cette pensée de programmation. Cela s’est d’ailleurs vu très concrètement dans des initiatives comme le Théâtre des idées. Si l’on doit voir un fil rouge, de l’origine jusqu’à aujourd’hui, ce serait cela : le contraire de la diversité dans ce qu’elle peut parfois avoir d’insignifiant. Ici, même s’il y a une ouverture, un mélange, il y a des échos des artistes entre eux qui sont le fruit d’une pensée.
H. A. : Nous nous inscrivons dans l’héritage d’un théâtre public. La manière dont on conçoit le projet du Festival est très fortement ancrée dans son histoire, une histoire en mouvement, portée par Jean Vilar, Paul Puaux, puis par Alain Crombecque et Bernard Faivre d’Arcier avec lequel nous avons travaillé. Le soin apporté à articuler, à l’intérieur de chaque édition, les spectacles, les discussions et la pensée reflète notre conviction que l’art permet une émancipation. On a ainsi parlé de construction de la pensée, de curiosité du spectateur, de risque de la création, de dignité, de confiance dans l’humanité. Pour nous, l’enjeu du théâtre conçu comme service public, c’est cela. Maintenant, les moyens de mettre en place cet enjeu ne sont simplement plus les mêmes qu’en 1947.
V. B. : L’un de nos objectifs était d’inviter le spectateur à une expérience chaque année renouvelée. Lui donner la possibilité de traverser le Festival avec un regard critique qu’il puisse développer dans l’ensemble des propositions de spectacles et de débats, esthétiques
ou philosophiques. Cette tentative de comprendre et de s’interroger est au cœur du projet que nous avons posé, de manière peut être moins dogmatique que par le passé. Il n’y a pas une vérité à enseigner au public. Nous sommes plutôt dans le questionnement : le monde dans lequel nous vivons nous pousse à cela. Le Festival d’Avignon n’est pas une programmation d’une saison. Il y a une unité de temps, de lieu. Il y a aussi une particularité du spectateur qui, lorsqu’il se déplace à Avignon, est entièrement disponible, pendant le temps de son séjour, pour cette expérience-là. Le travail de la résonance des œuvres les unes avec les autres est donc très important. En quelques jours, il va voir plusieurs spectacles, expositions et débats. Et le soir, quand il se couche, tout cela se mélange. Pour nous, il était important de tenir compte de cela, au moment de construire la programmation. D’où l’idée de l’artiste associé, qui est le point de départ d’une exploration d’un territoire artistique, où il va y avoir des parallèles, des contra- dictions, des frictions, que cela soit sur les thématiques abordées par les artistes, comme dans les formes produites. Par exemple, la première année, lorsque Thomas Ostermeier était artiste associé, nous avons confronté le théâtre allemand, qui pratique avec ses ensembles le répertoire, et le système français. Mais il était aussi très important d’inviter Frank Castorf de
la Volksbühne. Ce dernier travaille à Berlin-Est, alors que Thomas Ostermeier dirige la Schaubühne à Berlin-Ouest : chacun porte, à sa manière, l’héritage du théâtre allemand. Avec leurs points communs et leurs divergences, nous pouvions produire du débat, de la dialectique.