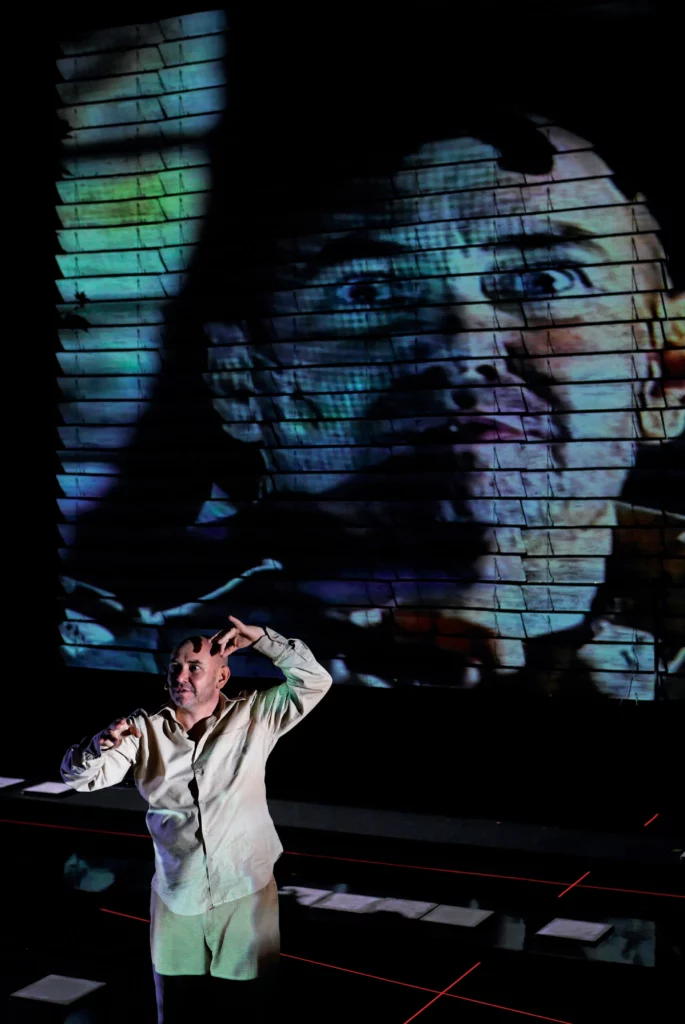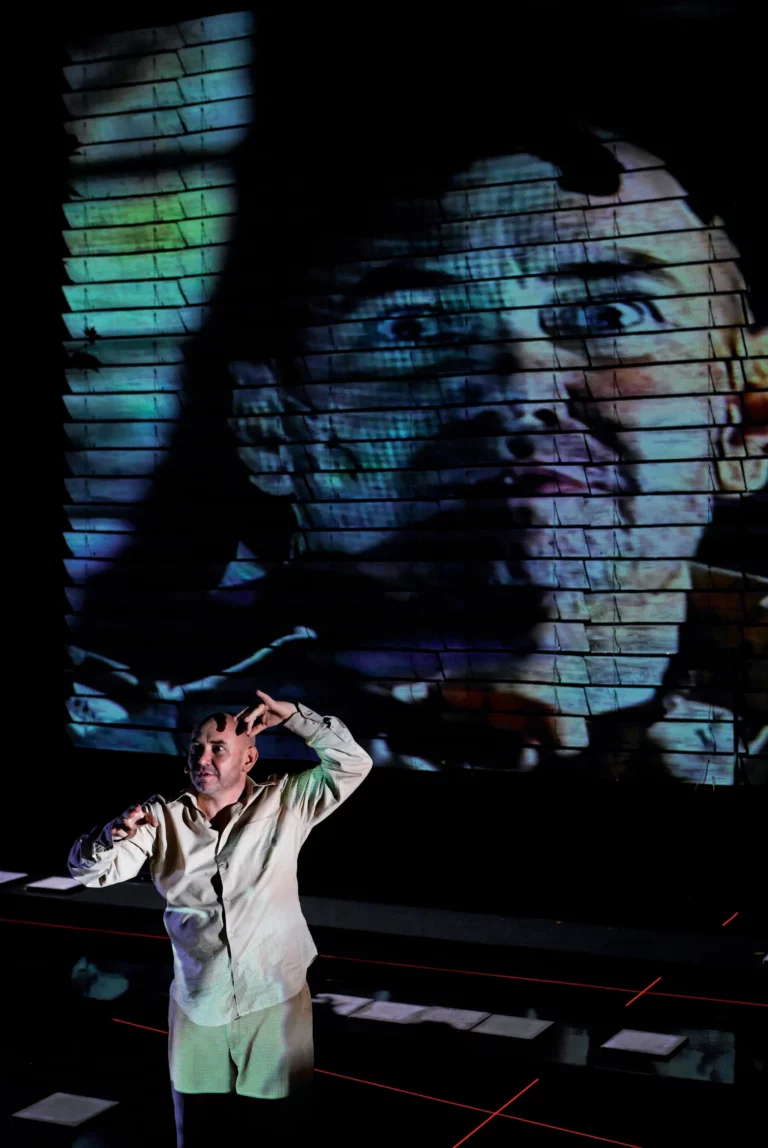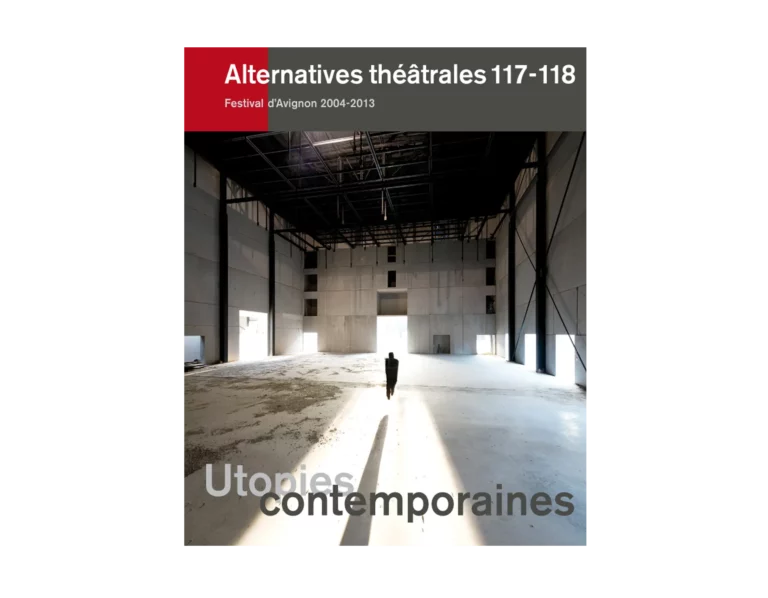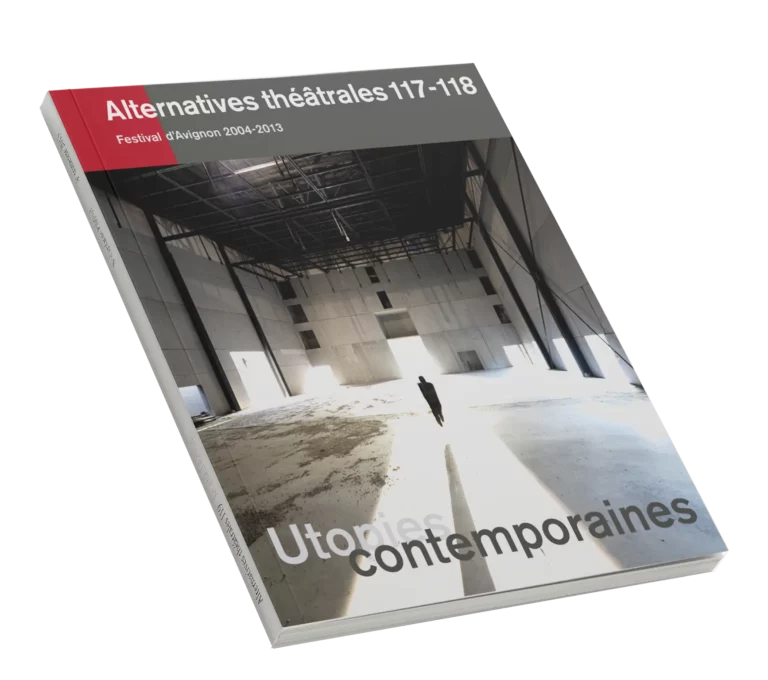EN 2004, il faut reconstruire Avignon. Car le non- festival de 2003, même s’il fut fondateur par bien des aspects, a défait une part des liens de confiance entre la ville et son Festival. De là, sûrement, naît le choix délibéré de situer la politique du Festival entre le local – où les enjeux municipaux, l’implantation de la direction et de l’équipe, l’implication d’un premier cercle de public, ont été primordiaux – et l’international – essentiellement l’horizon européen, comme cadre artistique, réflexif, et d’économie de la culture. Les directeurs du Festival, jusqu’alors, étaient clairement des hommes de culture de dimension nationale : leur échelle était celle du théâtre français, du forum d’opinions de portée nationale, de l’État culturel, qu’il soit bailleur de fonds ou initiateur de politiques culturelles. Certes, la municipalité avignonnaise a toujours été impliquée dans l’histoire du Festival ; bien sûr, Paul Puaux avait des attaches biographiques locales ; évidemment, d’Alain Crombecque à Bernard Faivre d’Arcier, une première ouverture sur le monde, à travers les civilisations et les artistes invités, a joué de ses effets au cours des années 1990. Il n’en reste pas moins que Baudriller et Archambault présentent un profil atypique : ce ne sont pas des personnalités nationales mais des acteurs culturels à l’engagement bifrons, local et international, comme si l’Europe de la scène et de la culture ne pouvait pour eux se concevoir qu’à travers un profond enracinement avignonnais.
Ils se sont ainsi toujours employés à restaurer les liens avec les pouvoirs locaux et avec le public sur place. Marie-José Roig, maire d’Avignon depuis 1995, réélue deux fois au cours des années 2000, est devenue incontournable pour les directeurs du Festival, qui ont su mettre en place un solide modus vivendi, évitant les crises de confiance et financières qui ont terni les relations entre la mairie et la manifestation estivale tout au long des années 1990, notamment en 1996 quand la municipalité s’est brutalement désengagée d’une part du financement du Festival. « Il y a trop de théâtre à Avignon »1, avait simplement lâché l’adjoint à la culture, Gérard Guerre, antiquaire de renom, lors d’un conseil d’administration entérinant l’arrêt de plusieurs projets d’importance, une exposition sur l’histoire du Festival et l’installation en Provence du Centre national du théâtre.
Peu à peu, la confiance mutuelle est revenue et la municipalité a pu constater, avec l’annulation de 2003, que le Festival était pour elle un enjeu vital, ne serait-ce que parce qu’il attire plusieurs centaines de milliers de personnes en juillet. L’installation avignonnaise de Vincent Baudriller (dans une petite maison sur l’île de la Barthelasse) et d’Hortense Archambault (un appartement du centre ville), dès 2003, implantation locale prévue dans leur projet initial, n’est pas qu’un symbole : c’est finalement l’ensemble de l’administration du Festival, une trentaine de personnes, qui a pris racines à Avignon, transfert définitivement réglé au début
du second mandat, en 2008. À l’exception du service de presse, sous la direction de Rémi Fort, parisien par définition, le Festival est désormais entièrement piloté, géré, programmé, administré, produit, depuis Avignon. En 2006 comme en 2010, quand la question du renouvellement des directeurs du Festival s’est posée, au niveau national du chef de l’État et du ministre de la Culture, il est certain que le soutien local a pesé de tout son poids, Marie-José Roig ayant l’oreille de Jacques Chirac (qui a lancé sa campagne présidentielle en 2001 depuis Avignon). Si Olivier Py a dû patienter près de cinq ans avant de pouvoir entrevoir une nomination à la tête du Festival, alors qu’il bénéficiait de l’actif soutien des ministres de la Culture successifs, c’est que l’influence de la maire d’Avignon était décisive et que le duo Baudriller / Archambault profitait, à juste titre, de son investissement local.
L’édition 2005, marquée par une querelle d’ampleur inattendue, place la direction du Festival devant une autre obligation d’urgence : son projet ne pourra perdurer et prendre sa consistance que s’il s’appuie sur la rencontre avec le public. Il s’agit de fidéliser différentes strates de publics en empathie avec le Festival. L’été 2005 a montré que l’enjeu était vital, car il est à peu près certain qu’une défection du public aurait entraîné la chute de la direction, donnant libre cours au catastrophisme d’un discours de rupture entre théâtre contemporain et public populaire. Or, c’est précisément à cette déliaison que ne se résout pas la direction d’Avignon, qui a mis en place des liens de mobilisation de différents cercles possibles de spectateurs. Nous sommes là au cœur du projet avignonnais : organiser la rencontre entre public populaire et innovation artistique.
Le premier noyau des spectateurs est avignonnais, du moins comtadin, soit environ deux mille personnes qui forment le socle du Festival, son ancrage local. L’enjeu va au-délà des ventes de places l’été durant. Il s’agit de la reconstitution de l’identité d’un public spécifique, le plus déterminant peut-être, laissé en jachère depuis les années 1970 et l’action de Paul Puaux – qui vivait lui-même à Avignon – à la tête d’un Festival qui se vivait également comme un centre culturel, avec sa dynamique locale propre.