BERNARD DEBROUX : Au théâtre, le metteur en scène est le premier interprète du texte auquel il tend, au travers d’un univers de signes, de donner sa vision. À l’opéra, c’est le compositeur qui est en première ligne. Lors de votre première expérience de compositeur pour l’opéra (LA PASSION DE GILLES sur un livret de Pierre Mertens) vous déclariez : « Gilles est un baryton, il est trop jeune pour être une basse et il est trop vilain pour être un ténor »1. Le compositeur, par le choix des voix, donne déjà du sens, une orientation…
Philippe Boesmans : Il participe très fort à la mise en scène surtout parce qu’il est maître du temps. Le metteur en scène à l’opéra n’est plus maître du temps comme au théâtre. Il est maître des gestes. Le compositeur est maître du temps et maître du ton. Dans la phrase que va dire l’interprète (le personnage), entend-on qu’il ment ? Entend-on qu’il est timide ? Tout ça, c’est le compositeur qui le met en scène, c’est fixé une fois pour toutes. Le metteur en scène peut ralentir l’expression d’une phrase ou rajouter une petite virgule de suspension, mais il ne peut plus changer fondamentalement le déroulement de l’opéra. Pour un metteur en scène, c’est à la fois difficile parce que ça lui est imposé et confortable parce qu’il ne doit pas s’en occuper.
B. D. : Certains auteurs de théâtre écrivent pour des acteurs en particulier. Vous arrive-t-il de composer à l’opéra pour des chanteurs ou des chanteuses en particulier ?
P. B. : Oui, quand j’écris un opéra, il arrive que certains chanteurs soient déjà choisis et que je les connaisse. Mais ce qui existe surtout à l’opéra et qui existe moins au théâtre, ce sont des archétypes vocaux. La voix des chanteurs porte un nom. On parle d’une soprano dramatique, d’une soprano lyrique, d’une basse noble, d’une basse chantante, d’un ténor héroïque. J’aime garder ces archétypes de technique vocale parce qu’ils font partie d’une histoire de l’opéra. J’écris toujours pour un certain type de voix, un certain caractère de voix.
Dans les années quatre-vingt, on a voulu « déstructurer » ces fondamentaux de l’opéra, mais cela n’a jamais bien fonctionné. J’aime qu’on aille voir mes opéras comme si on allait voir une pièce de théâtre, que la langue soit très compréhensible.
B. D. : Quand on s’intéresse à l’histoire des partitions musicales, on s’aperçoit, grâce aux travaux des musicologues, que des partitions ont été corrigées et changées après les exécutions publiques des œuvres. Est-ce possible à l’opéra ? Vous est-il arrivé de changer la partition après avoir vu la mise en scène ?
P. B. : Pendant les répétitions je fais souvent des petits changements. Un grand changement a eu lieu pour LA RONDE. Il y a une version longue qui dure deux heures vingt, difficile à présenter sans entracte. (Les règles syndicales ne permettent pas à l’orchestre de rester plus d’une heure cinquante dans la fosse). Nous trouvions plus beau et plus juste que LA RONDE soit présentée dans sa continuité. J’ai donc réalisé une version réduite qui peut être jouée sans entracte. Il y a eu douze productions différentes de LA RONDE jouées tantôt dans sa version courte, tantôt dans sa version longue. Dans la partition éditée, il est indiqué où on peut faire des coupures si on le souhaite…
B. D. : Vous avez établi un lien privilégié avec Luc Bondy : LA RONDE, LE CONTE D’HIVER, JULIE et enfin YVONNE, PRINCESSE DE BOURGOGNE. Au départ de grands auteurs, Schnitzler, Shakespeare, Strindberg, Gombrowicz, y a‑t-il eu un travail mené en commun metteur en scène-compositeur pour l’écriture des livrets ?
P. B. : Pour faire un opéra, il faut un livret. Si l’on part de pièces de théâtre du répertoire comme on l’a fait, il s’agit surtout d’une réduction du texte original. On réduit parce que la musique prend plus de temps… Si on prenait le texte du CONTE D’HIVER dans sa totalité, on aurait plus de six heures de musique ! Il faut garder les choses essentielles et enlever ce qui dans une langue est très fleuri, parce que ce qui est fleuri, c’est la musique qui le rend… On doit viser à la simplicité, raccourcir les phrases trop littéraires et trop longues.
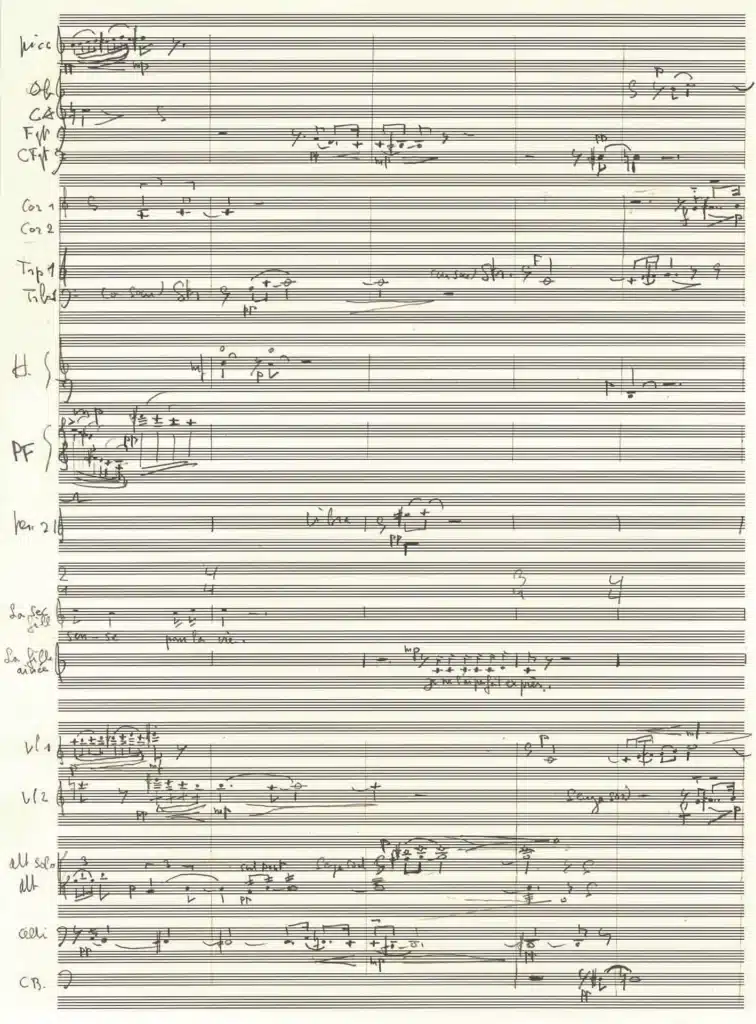
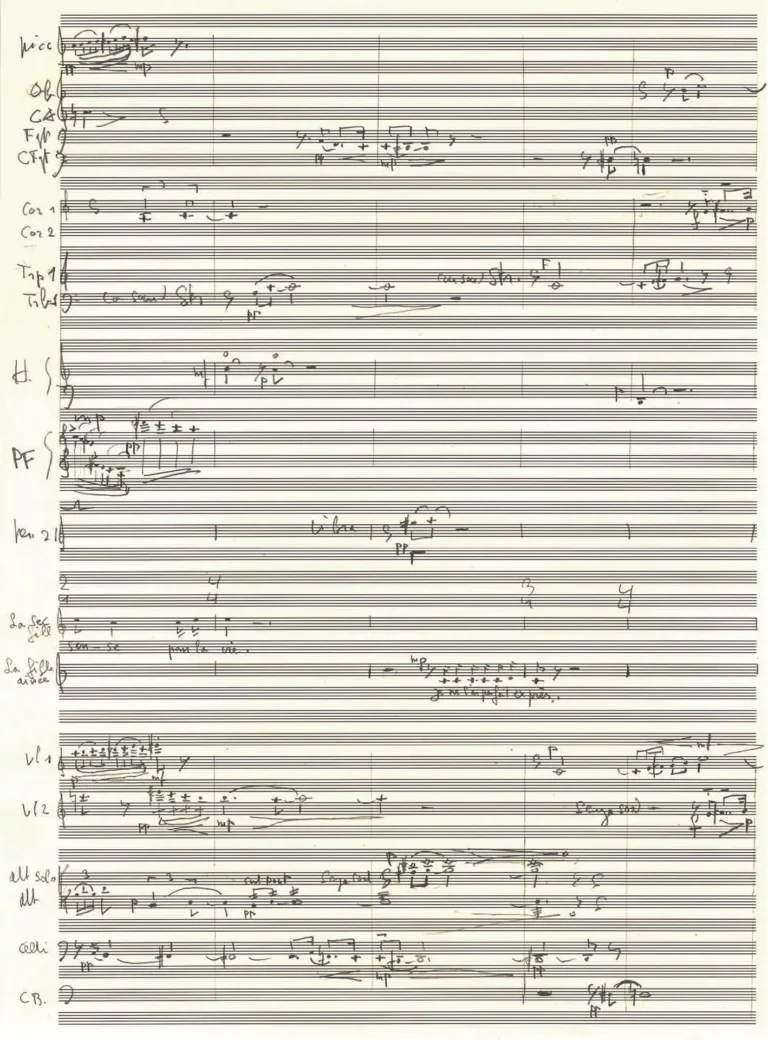




![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)

