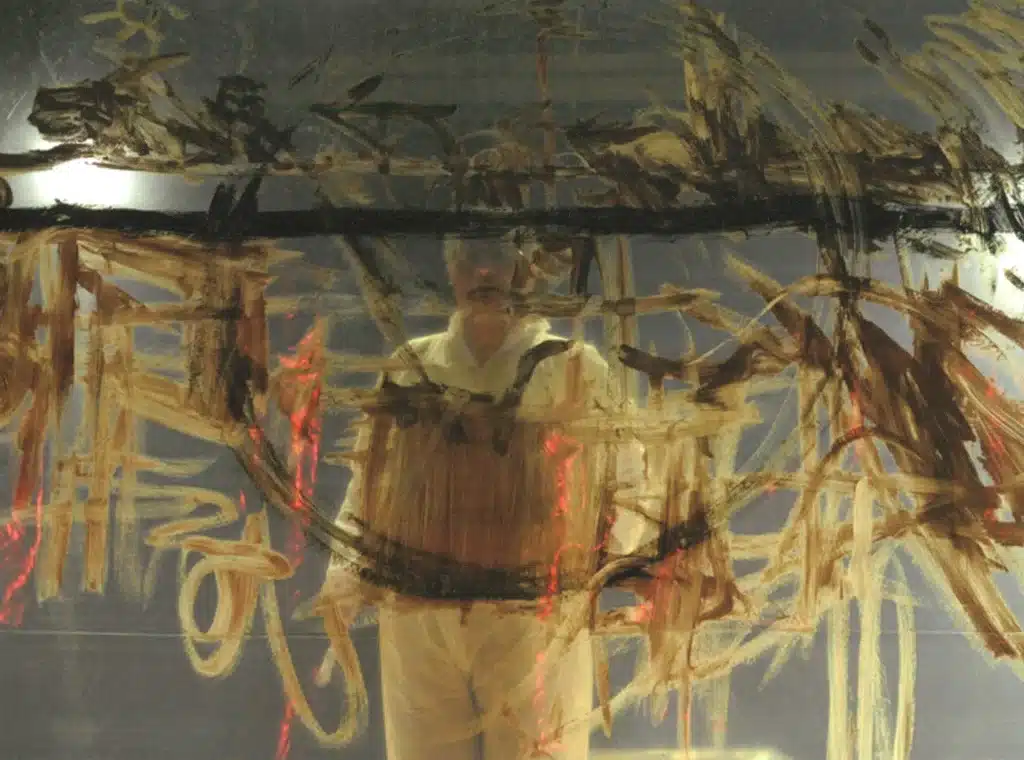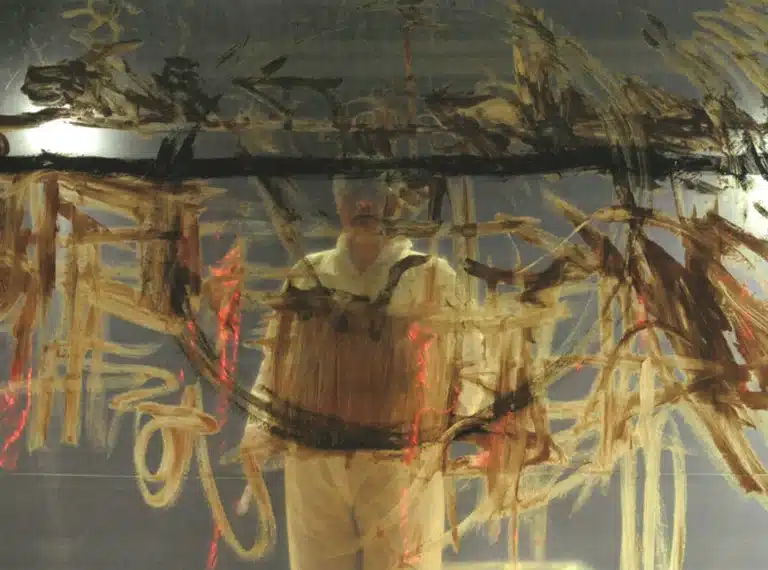DANS LES ANNÉES quatre-vingt, au creux de nos canapés, nous avons commencé à zapper. Au mieux, le téléspectateur est devenu son propre chef-monteur, assemblant et ré-assemblant des images au hasard, des bribes de propos ou de narrations, pénétrant brutalement dans des atmosphères contrastées, s’en extrayant tout aussi brutalement pour en investir d’autres. Au pire, l’œil distrait et paresseux est devenu incapable de regarder et s’est peu à peu habitué à voir défiler des rubans multicolores devant sa rétine. Dans les deux cas, la télévision s’était dé-ritualisée, était devenue l’anti-cinéma et non pas son prolongement démocratisé.
Dans les années deux mille, droits sur nos chaises de bureau, nous avons commencé à surfer. Au mieux, le lecteur est devenu son propre bibliothécaire, son propre investigateur, allant chercher l’information à la source, découvrant de nouveaux émetteurs insoupçonnés, alliant le sérieux au ludique. Au pire, l’attention s’est perdue en chemin, glissant mollement d’un lien fantaisiste à une destination dérisoire. Dans les deux cas, l’accès à l’information s’était potentiellement vu démultiplié, son hasardisation aussi.
Aujourd’hui, dans nos canapés, sur nos chaises de bureau, dans la rue ou dans le métro, les timelines de nos tablettes ou de nos téléphones nous offrent un flux permanent de textes, d’images et de sons.
Se pencher sur les modes d’accès aux contenus ne préjugent évidemment rien de la qualité de ceux-ci. On peut zapper d’une émission de télé-réalité à un film de Tarkovski, ou entre deux émissions de télé-réalité, ou entre deux films de Tarkovski. On peut surfer du site du Monde à celui de Voici, ou entre deux vidéos de « LOLCats » sur You Tube, ou entre le site des Archives et Musée de la Littérature et celui d’Alternatives théâtrales. Et, quoi qu’on l’oublie souvent en ces temps audimatisés où chaque clic pèse son poids de recettes publicitaires, le fait d’accéder à ces contenus ne suppose pas la caution ou l’approbation de celui qui y accède.
Du 15 au 17 mars derniers, le Théâtre National programmait en ses murs la deuxième édition du Festival XS. Consacré aux formes courtes, la manifestation présentait chaque soir et trois soirs de suite dix-huit spectacles, éparpillés dans tous les espaces de la Maison. Le soir du 17 mars, j’y ai vu successivement KUDDUL TUKKI d’Armel Roussel, FLASH FLOW 1 d’Anne Thuot, BRIGITTE de Jean-Benoît Ugeux et AU SANGLIER DES FLANDRES de Bernard Van Eeghem, quatre formes contrastées, chacune audacieuse et tonique, de vraies réussites, chacune dans leur style.
Pourtant, deux mois plus tard, ce qui me reste avant toute chose de cette soirée, ce n’est ni l’ironie ravageuse des acteurs de Roussel, ni la force ludique de la bande d’Anne Thuot, ni l’intrigue déduite des accents wallons d’Ugeux, ni même la terrible image finale peinte et traversée par Van Eeghem sur scène. Ce qui me reste, c’est une course contre la montre dans les couloirs du National. L’impossibilité d’échanger, l’impossibilité de sortir du moment, parce qu’il faut entrer dans un autre. Ce qui me reste, c’est cette étrange impression lorsque, assis dans la salle du spectacle 2 alors que la lumière s’éteint, on se sent encore totalement dans le spectacle 1, dans son énergie, dans son rythme, dans son rapport au monde, et qu’on se demande, finalement, ce qu’on fout là… Puis rebelote entre 2 et 3 et entre 3 et 4. Ce qui me reste, c’est la timeline de la soirée, le flux qui passe, dans lequel j’ai pioché et assemblé quelques instants théâtraux.
Proposer dix-huit spectacles par soir sous un seul toit, tout aussi bons soient-ils (et c’était le cas ici), c’est donner au spectateur l’illusion du choix. Le temps théâtral est un temps intimement humain. Il diffère de celui de la télécommande et de la souris. Au-delà des considérations économiques qui expliquent rationnellement l’organisation de ce type de soirée – voir beaucoup de propositions artistiques en un seul lieu et un seul moment constitue un gain évidentde temps, donc d’argent, pour celui qui programme comme pour le festivalier, qu’il soit professionnel, potentiellement acheteur, ou simple spectateur –, la question que pose ce type de programmation théâtrale (XS est loin d’être un cas isolé) est celle de la place du théâtre à l’heure de la révolution numérique.
Lorsque la Friche de la Belle de mai (Marseille) lance ces jours-ci son festival « 48h Chrono », proposant plus de quarante événements sur un même site en un week-end, c’est la même dynamique qui opère. Et, tant pour les équipes artistiques que pour les spectateurs, il faut admettre que la formule séduit : de la friction de ces oeuvres semble naître quelque chose de neuf, 1 + 1 = 3, comme lors d’un « bon zapping » ou d’un surf heureux.
D’une relation traditionnellement « verticale » aux contenus (oeuvres ou informations), le développement technologique nous a peu à peu habitué à développer une relation « horizontale » : nous ne sommes plus assujettis par la position écrasante du contenu ; il nous parvient en flux, nous sommes amenés à le choisir, à le partager, le commenter, voire à le modifier.
Une telle relation est-elle possible, souhaitable, au théâtre ? Cette remise en cause, radicale, de l’instant théâtral est-elle, à terme, viable ?
Il y a deux ans, dans le spectacle CAPITAL CONFIANCE, consacré à la crise économique par le collectif Transquinquennal et le groupe Toc, un dispositif initialement conçu pour pointer l’impact d’actes isolés sur la collectivité, permettait indirectement de questionner la possibilité même de l’interactivité contemporaine au théâtre. Un grand panneau lumineux pourvu d’un gros bouton rouge était installé sur scène à chaque représentation. Sur ce panneau il était écrit en toutes lettres « Pour arrêter le spectacle, appuyez ici », bien visible de tous. Lorsque, certains soirs, un spectateur se levait et, en toute innocence, appuyait sur le bouton, les acteurs cessaient instantanément de jouer et venaient saluer. De l’impossibilité du théâtre au temps du web 2.0…
Il y a belle lurette que le théâtre est anachronique, périphérique, que sa marche propre diffère de celle de la marchandisation du monde. Il faut se rappeler que c’est là sa force, la condition de sa puissance et de sa pertinence.
Déjà, en 1984, alors que nous commencions à peine à zapper, Jean-Marie Piemme écrivait : « Le théâtre aujourd’hui : moins de prestige, moins de pouvoir symbolique, mais une plus grande jouissance de l’inconnu. Il explore sa relation au réel plus qu’il ne cherche à la figurer, il hésite sur sa nature, sa fonction, ses possibilités, il fait de son infortune sociale une vertu esthétique et son excentricité lui assure une forte capacité critique »1.

- Du théâtre comme art minoritaire, LE SOUFFLEUR INQUIET, Alternatives théâtrales 20 – 21, décembre 1984, p. 44. ↩︎