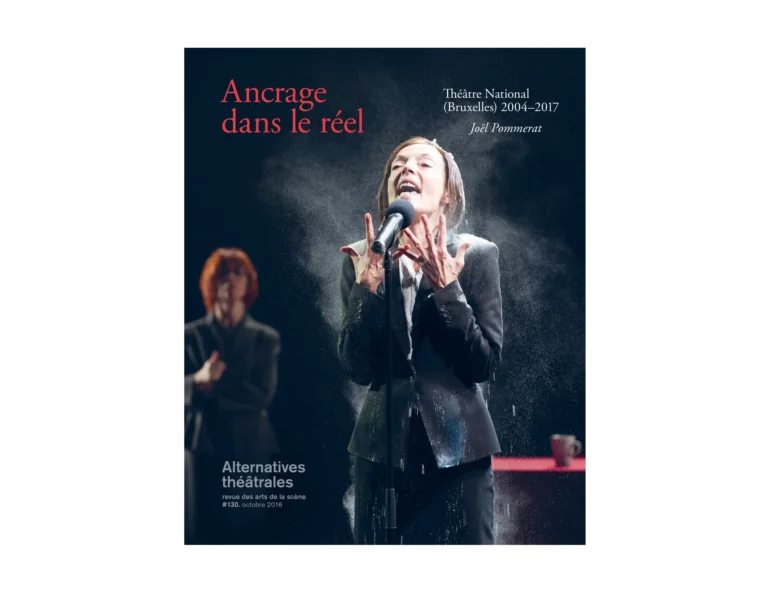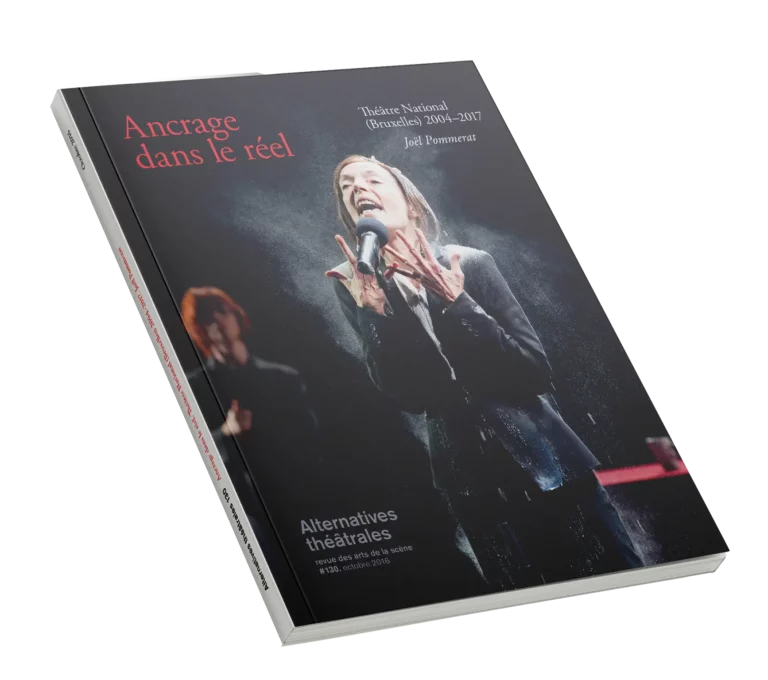Fiction politique inspirée d’une matière historique apparemment dénuée de l’inquiétante étrangeté qui caractérisait jusqu’ici les spectacles de la Compagnie Louis Brouillard, Ça ira (1) Fin de Louis pourrait laisser penser à une rupture dans le parcours de Joël Pommerat. Sans entrer ici dans les débats interprétatifs qu’elle suscite, j’aimerais souligner la singularité de certains choix dramaturgiques tout en montrant comment cette nouvelle création s’inscrit dans une continuité de questionnements esthétiques et thématiques. Par rapport aux grands cycles de l’œuvre (les premières pièces énigmatiques, riches en expérimentations spatio-temporelles, le tournant de la trilogie Au monde, D’une seule Main, Les Marchands(2004 – 2006) plus engagée dans la réalité sociale, et la « bascule » de Cercles/Fictions (2010) qui accentue une veine d’écriture réaliste et humoristique débutée en 2008 avec Je tremble (1 et 2) et Pinocchio, Ça ira (1) Fin de Louis continue en effet de donner forme aux préoccupations qui sont à l’origine même du geste théâtral de Pommerat pour qui « le théâtre est un lieu possible d’interrogation et d’expérience de l’humain […] un lieu de possibles, et de remises en question de ce qui nous semble acquis1 ». Ce spectacle approfondit sa réflexion sur les individus et leurs représentations (individuelles et collectives) et prolonge la recherche d’un théâtre à la fois spectaculaire et concret, proche du public dont il doit « rouvrir la perception2 ».
Ce qui frappe d’emblée le plus en terme d’innovation, c’est le choix d’un sujet historique et l’ampleur du spectacle : pendant presque 4h30 découpées en trois parties, sur un grand plateau et pour une jauge élevée, 14 comédiens incarnent les débuts du processus révolutionnaire depuis 1787 jusqu’à la montrée de la contre révolution en 1790 – 91. Sollicité par Olivier Py pour la cour d’honneur du Festival d’Avignon, Joël Pommerat, tombé malade, a du se désister mais l’envie d’écrire une « épopée » était née. L’ampleur du projet initial a influencé le choix d’une matière historique et mythique bien que d’autres pistes aient aussi été explorées, notamment autour de la crise économique. Cet intérêt pour l’Histoire n’est d’ailleurs pas une nouveauté : la Résistance était déjà présente en filigrane dans D’une seule Main (à travers le passé trouble du Père, probablement un ancien collaborateur) ; certaines séquences de Cercles/Fictions sont situées au Moyen-Âge, à la Belle époque et pendant la Première guerre mondiale. Le choix particulier de la Révolution vient répondre au désir de Pommerat de prolonger sa réflexion sur l’homme et ses idées, sur les valeurs collectives qui le constituent, l’aiguillonnent ou entrent en conflit avec ses actes et perceptions individuelles : « Je me suis demandé quel contexte historique permettait le mieux d’entrer dans l’idéologie contemporaine. Après être allé voir du côté de la Résistance et des révolutions du XIXe siècle, je me suis rendu compte qu’il fallait revenir à la racine, à la révolution de 1789 : c’est le mythe fondateur de notre culture, le cœur de notre roman national. Mais en même temps, on en a une vision superficielle, figée3 ».
Dans Ça ira (1), Pommerat approfondit donc son enquête sur les présupposés idéologiques (valeurs, croyances, idéaux) de nos comportements à travers la recherche de filiations entre passé et présent. Après avoir observé les microcosmes de la famille (Au monde), de l’entreprise (Ma Chambre froide) et du couple (La Réunification des deux Corées), il braque son microscope sur la sphère politique démocratique, ses pratiques, ses courants et ses imaginaires, en s’emparant de l’un de ses moments historiques fondateurs. Cherchant toujours à entrer dans la complexité des expériences4, il met en scène une confrontation entre plusieurs acteurs politiques aux positionnements variés, à la différence de ses précédents spectacles qui se focalisaient sur un groupe et ses contradictions internes (les dirigeants dans Au monde, les ouvriers et employés dans Les Marchands et Ma Chambre froide, les vendeurs à domicile dans La Grande et Fabuleuse Histoire du commerce, par exemple). Ça ira (1) représente des débats à l’intérieur et entre différents cercles de pouvoir et d’action politique (royauté, députés, comités de quartier). À travers des parcours individuels inscrits dans un contexte de lutte politique et sociale collective, il révèle les multiples facteurs de l’engagement, la rencontre entre des ressorts intimes, des idéaux, une volonté d’action et les circonstances – le plus souvent violentes. En contradiction avec ses convictions politiques mais excédé par l’intransigeance et le mépris de la noblesse, le député conservateur Gigart (David Sighicelli) se range soudain du côté des radicaux pour déclarer l’Assemblée nationale. Entraîné par l’euphorie générale, Ménonville (Maxime Tshibangu) participe à ce coup d’État sans en ressentir le courage tandis que d’autres découvrent qu’ils sont prêts à mourir pour des idées qu’ils ne soupçonnaient pas avoir quelques semaines avant. Ainsi, en redonnant vie à l’intempestivité et à la conflictualité révolutionnaires, le spectacle place ses spectateurs au cœur de la complexité individuelle et collective de l’expérience politique.