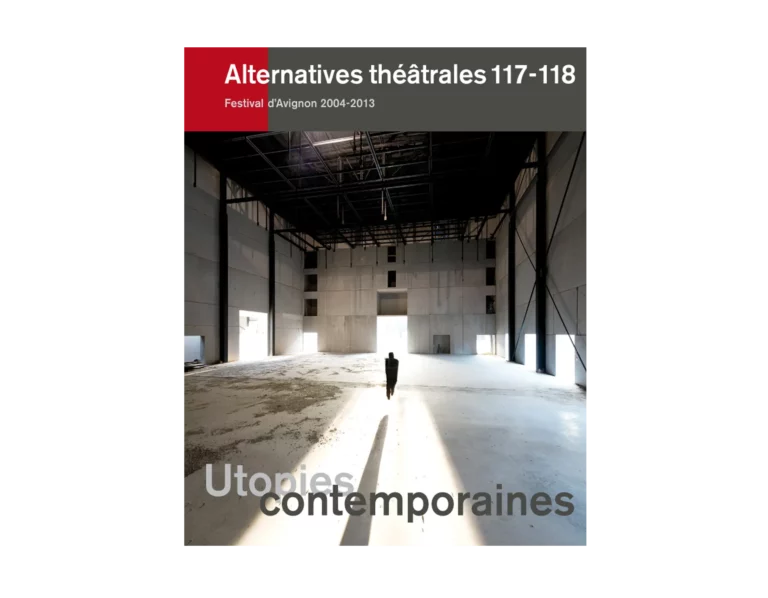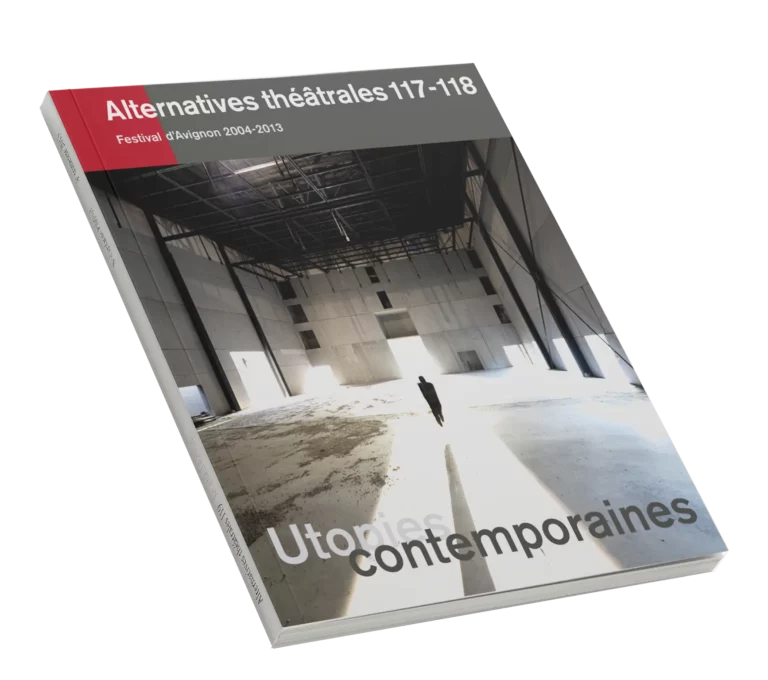AU TABLEAU des écorchés de Georges Banu, les acteurs sont scannés au fil des ans et des voyages1, des leurs et de ceux de leur auteur qui n’a eu de cesse de les observer et de les aimer, souvent, de les envier, parfois. Tchekhovien,il les ausculte à la manière d’un médecin du théâtre. Triture, dissèque l’âme et le corps de ceux dont il est si proche. Faut-il rappeler ici que Georges Banu est l’un des rares théoriciens des arts de la scène, qui sache manier la plume et les concepts en nourrissant sa pensée de littérature, d’une immense expérience de spectateur, et d’une connaissance intime des plus grands praticiens internationaux ? Son livre se présente comme une cartographie des comédiens de tous pays dont il a eu l’heur de croiser les chemins artistiques et personnels. Le monde est une scène et ce livre un miroir de ses mille plateaux. On y rencontre les plus grands interprètes de notre temps, entre autres André Wilms, Valérie Dréville, Yoshi Oida, Sotigui Kouyaté. On y croise des acteurs occidentaux et des acteurs orientaux, des comédiens travestis, d’autres âgés ou étrangers…
Observateur insatiable, Georges Banu décortique l’homme qui joue avec minutie en multipliant les points de vue. Tantôt zoome sur des détails, tantôt prend de la hauteur : tantôt se concentre sur des spécificités propres à chaque individu, tantôt analyse les influences culturelles à l’échelle d’un continent, d’un pays, d’une région… Il scrute par le menu ce qui contribue à fabriquer les joueurs d’est en ouest : décèle le modèle oriental reposant sur la dimension sacrée, la constitution d’un vocabulaire de signes, l’élaboration d’un système qui vise la beauté par la pleine possession des moyens techniques2 … reconnaît l’existence d’une idée européenne du théâtre, en analysant notamment l’impact des programmes d’enseignement et du système stanislavskien sur l’acteur européen3. Si « l’acteur oriental adopte une éthique
de la perfection »4, explique George Banu, l’acteur occidental propose quant à lui une partition avec des défauts, « avec son implication biographique, avec ce qu’il peut avoir de brouillon et en même temps d’immédiatement personnel »5.
Quelle est la substantifique moelle des acteurs dont il fait l’esquisse ? De combien de livres de chair sont-ils faits ? Quelle est la part d’esprit que les grands maîtres leur ont appris, ou encore, comment la langue, le variant linguistique, participe de leur identité ?
Dans cet ouvrage, Georges Banu ne propose pas une théorie globale et systématique sur les actants. Il a fait le choix de s’intéresser de plus près à ceux qu’il qualifie d’acteurs « insoumis ».
L’acteur qui se réclame de l’insoumission – individuelle ou duelle – découvre sur le plateau sa « part maudite » ou, pour citer Eugenio Barba, sa « part d’exil », et la salle éblouie en éprouve l’impact.6