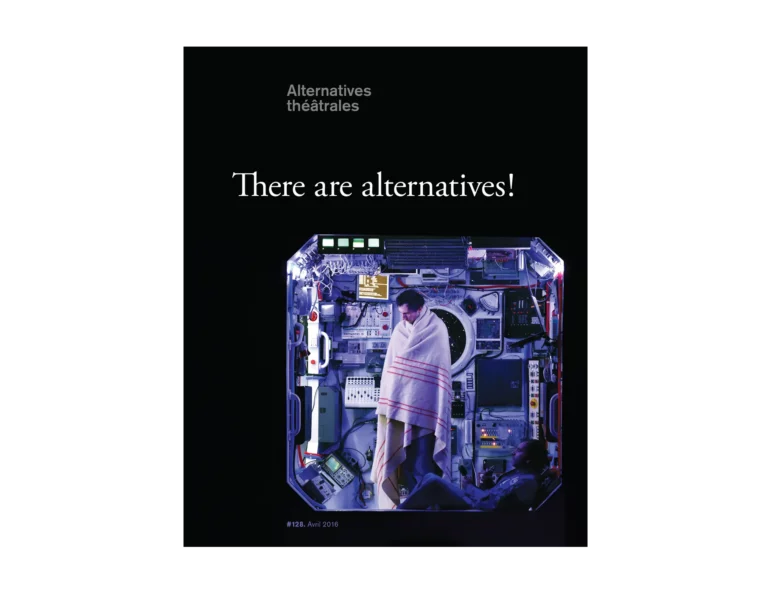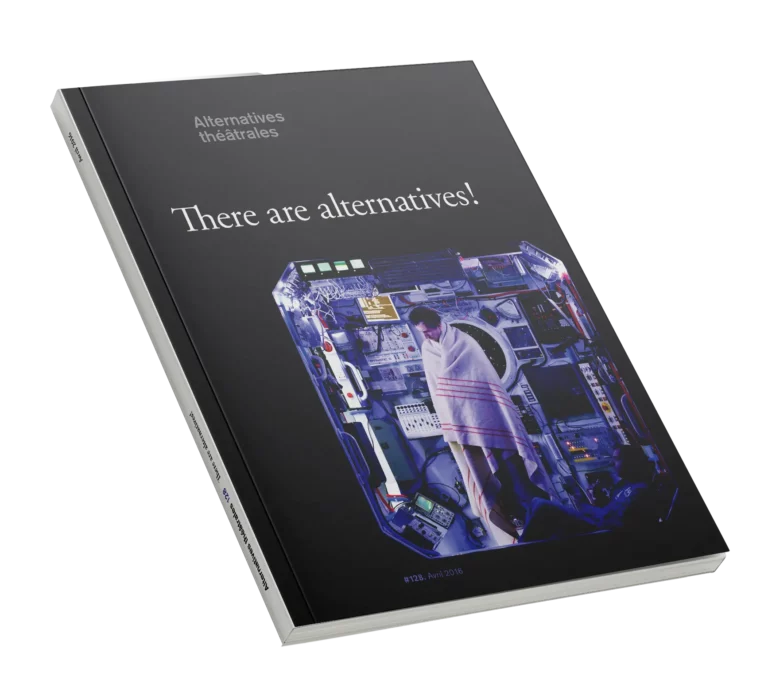Dans le précédent numéro d’Alternatives théâtrales (126 – 127) où nous enquêtions sur les amitiés créatrices et fécondes dans les arts de la scène, le Raoul collectif déconstruisait justement le mythe en vogue du « collectif »1. Mais les cinq garçons « ni potes ni collègues » ne peuvent s’affranchir si facilement de ce substantif dont ils ont affublé le prénom « Raoul », prénom terroir-belge par excellence (indépendamment de la référence à l’écrivain Raoul Vaneigem) et qui leur colle à la peau. Car c’est collectivement qu’ils élaborent, et de longue date, leurs spectacles. Ensemble, ils voyagent, marchent, visitent, échangent, débattent, expérimentent et ensemble, ils se marrent et se désolent, se consternent, s’affligent, désespèrent pour finir par créer, sur scène, un (deux) spectacle(s) qui déboussole(nt) et fascine(nt) le spectateur.
Ici nous évoquerons leur dernière production, Rumeur et petits jours, dont le titre, à l’image du spectacle, est déjà empli de tumulte, de joyeuse effervescence, de poésie et de questionnements.
Après avoir sondé des destins individuels révolutionnaires dans Le Signal du promeneur 2, les cinq comédiens-auteurs-metteurs en scène s’attèlent à l’étude et la représentation d’un groupe marginal : cinq animateurs ringards (soixante-huitards « attardés »), aux manettes d’une émission radiophonique à l’agonie. Dans cette émission intitulée « épigraphe », qui aurait pu tout aussi bien s’appeler « épitaphe », nos protagonistes confrontent leur pensée dans un idéal démocratique : ils s’écoutent, débattent, se disputent, et déroulent devant nous les récifs d’un système utopique contre lequel ils échoueront – à moitié – entraînant avec eux dans la débâcle un public pas si innocent que cela. Les nombreux conflits qui agitent le groupe mèneront à la formation rapide d’un groupuscule pseudo-révolutionnaire – qui se désagrègera tout aussi vite à l’arrivée d’une contre-utopie (TINA). Mais ce qui compte le plus avec ce collectif « vaneigemien », ce sont les narrations internes, récits qui emportent l’imaginaire du spectateur et rendent leur art si « vivant ».
Nos cinq protagonistes, tout en évoluant dans la société actuelle (de nombreuses références nous y renvoient) incarnent une époque révolue, le début des années quatre-vingt. Cette époque est figurée non seulement par leur look, leur vocabulaire, les objets et le décor scénique mais elle est surtout inscrite dans les thématiques abordées en filigrane : le thatchérisme et le reaganisme de ces années-là, avec leurs abus du mondialisme et les conséquences désastreuses que l’on connaît aujourd’hui sur la vie sociale et les pays du tiers monde.
Dès l’ouverture, très soignée, qui regorge de minutieux détails, les acteurs, assis derrière une longue table, font face au public, comme dans un procès dont les coupables seraient jugés par contumace. Côté jardin, une platine tourne-disque, côté cour, un générateur d’électricité qui fait aussi office de receveur de télex, au-dessus, de grands néons, bancals. Dans cette atmosphère « mi-figue mi-raisin », le spectateur est d’emblée déstabilisé : la vétusté des lieux, les lumières déglinguées, les objets d’époque prêtent à sourire ; mais les comédiens sont désarçonnants de sérieux, et ils nous révèlent assez vite qu’il s’agit de leur ultime émission. Faut-il rire ou pleurer face au déclin de cette production d’un autre âge ?
Une voix off annonce « antenne dans vingt secondes » et une musique de big-band style Count Basie fait office de générique d’ouverture.
Durant toute la représentation, une ampoule rouge qui pend du plafond à l’avant-scène nous indique quand les animateurs sont à l’antenne : subtile et passionnante mise en abyme pour le public, qui a la double contrainte de suivre à la fois l’émission radiophonique et le spectacle. Dédoublement entre auditeur et spectateur qui confère à ce dernier un rôle actif dans la création.
Sur la table, trois éléments de décor, métaphores géniales de la quintessence du spectacle : un cactus (le voyage), un métronome (la musique / l’harmonie) et cinq micros sur pieds (la parole / le récit).
Du Mexique au sillon Sambre et Meuse
Le cactus est d’emblée présenté au public /auditeurs, cadeau de l’un des animateurs, qui, souffrant, nous dit-on, ne peut être présent mais envoie cette plante grasse en provenance du désert de Wirikuta (Mexique). Serait-ce le fameux peyotl, cactus hallucinogène largement consommé là-bas ? Ce pauvre hère que l’on ne connaîtra jamais en subirait-il les effets pervers ou aurait-il pris le parti de fuir avant l’apocalypse, sentant le vent de leur destinée tourner inéluctablement ?