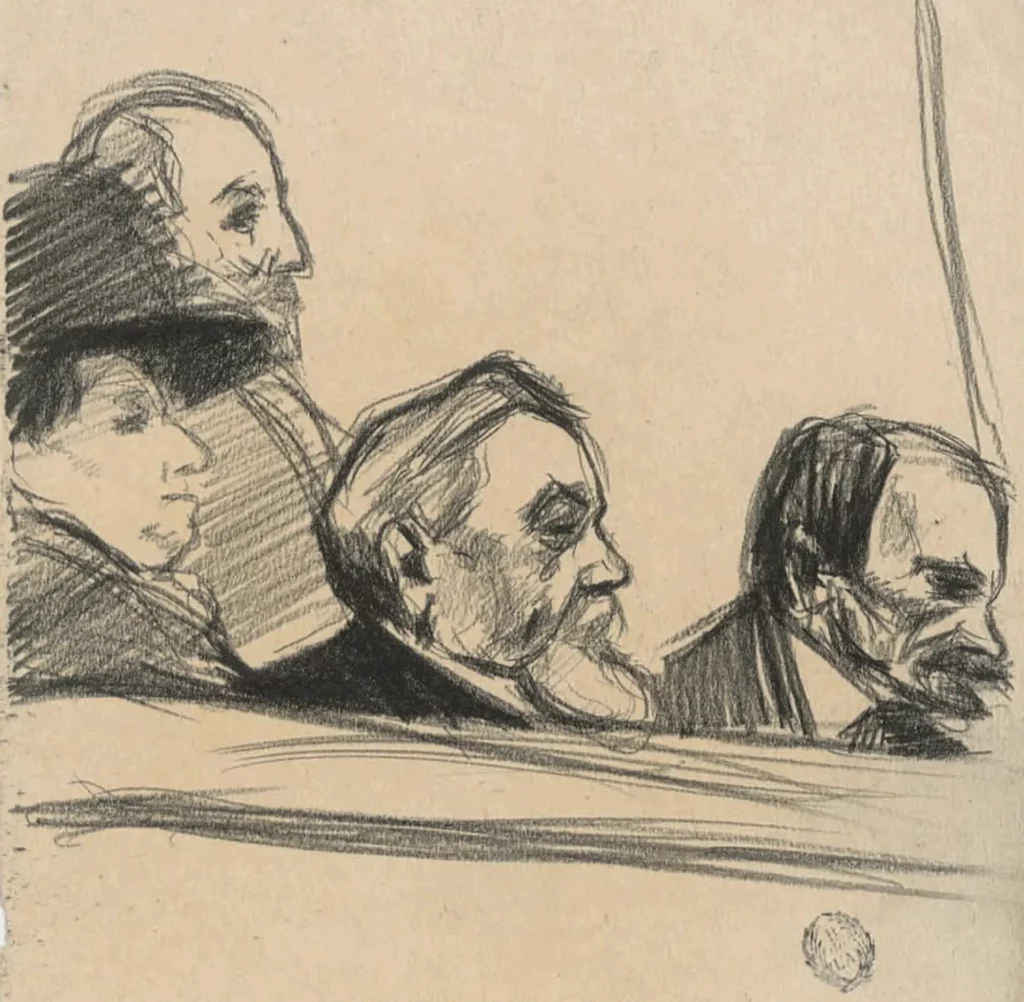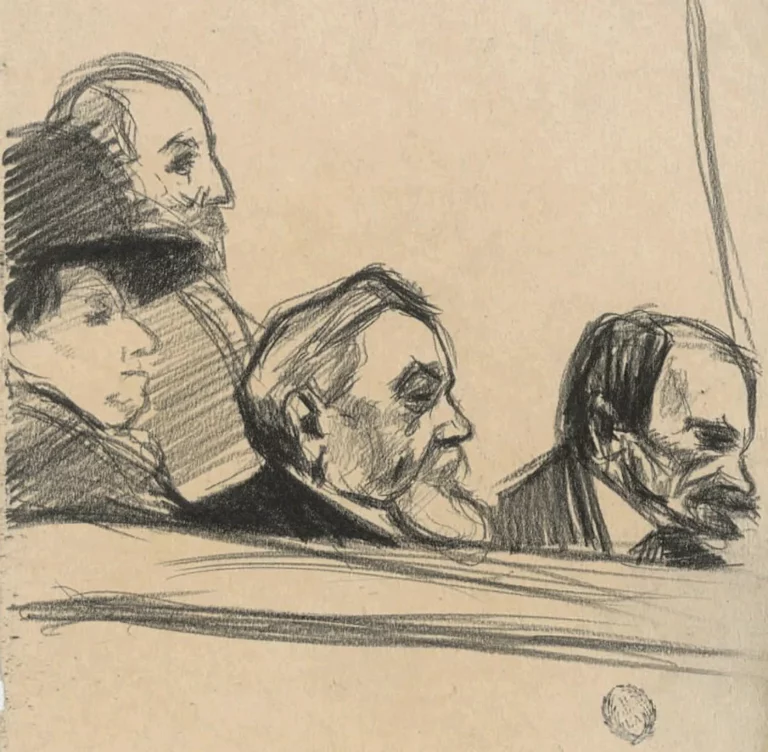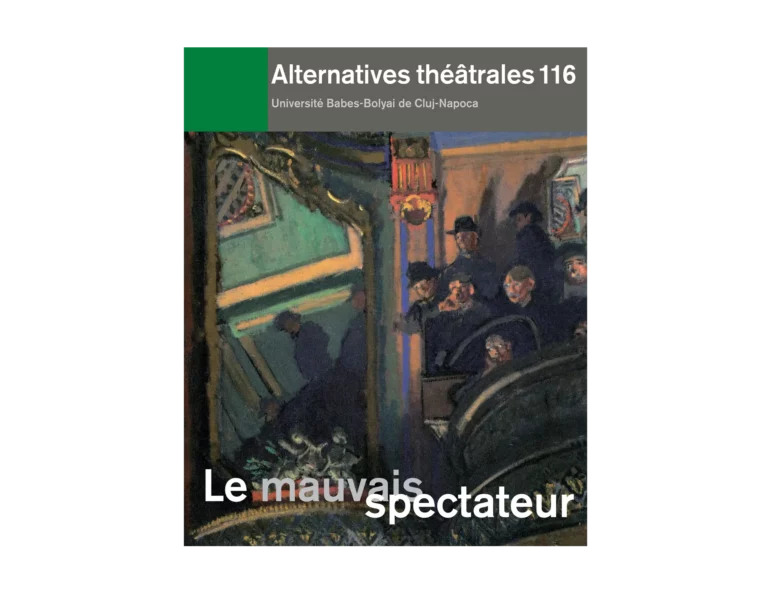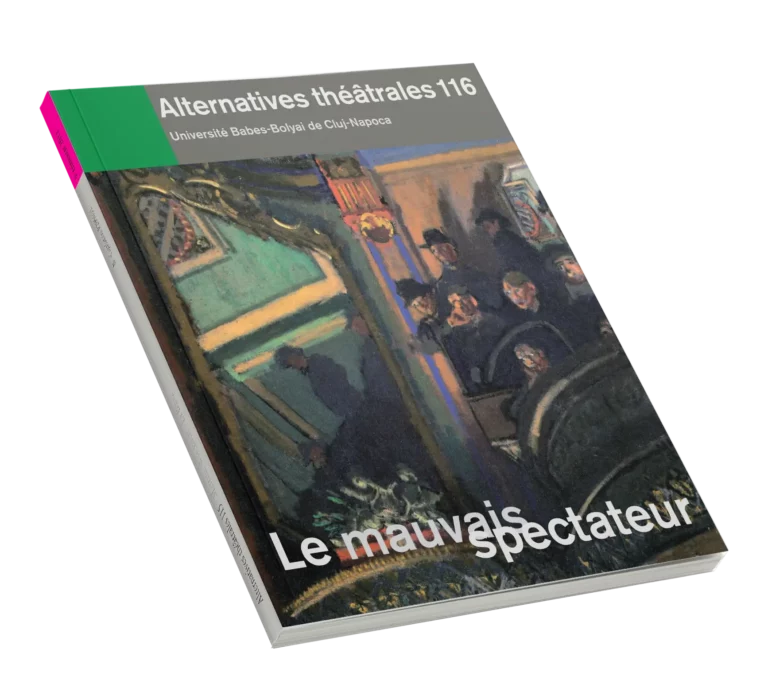Prologue
IL FAUT que je m’explique sur ce titre et son jeu de mots : le premier « public », c’est évidemment celui du théâtre, qui est « mort ». Le deuxième, avec la majuscule hélas !, est bien vivant : il est ce qu’on appelle le pouvoir Public mais, il ne faut pas exagérer, car – en réalité – c’est plutôt l’administration publique et sa politique de protection et/ou d’indifférence envers le théâtre. En Italie – mais non seulement en Italie – il s’agit d’une politique culturelle en même temps hypocrite et débordante qui est aujourd’hui la plus puissante et totalisante médiation entre le Théâtre et son public.
Premier acte. Le public est mort.
1.
Or, le public est mort – je l’affirme. Rien de nouveau. Ce n’est pas la première fois mais la dernière. Peut-être l’ultime, la définitive (on ne sait pas).
Ce n’est pas un désastre ni un scandale. Le public et « son » théâtre est mort plusieurs fois : il faudrait dire que, comme il est vivant, il doit aussi mourir de temps en temps. C’est enfin sa mort qui certifie sa vie. En effet, si l’on récapitule les nombreuses « origines » du théâtre occidental, tout le long de notre Histoire on s’aperçoit qu’entre l’une et l’autre il y a eu une pause, un vide pour ainsi dire « sans théâtre » ou mieux « sans public ». On se rappelle d’une origine grecque ou mythique, d’une origine médiévale ou légendaire, d’une origine baroque et finalement « historique », qui nous a enfin donné l’édifice et l’espace scénique encore conventionnellement reconnus et encore mal et malheureusement utilisés. Mais il faudrait ajouter – parmi les origines – aussi la « réforme » ou la « recherche » du XXe siècle, une véritable coupure et une nouveauté extraordinaire qui a changé aussi bien le Théâtre que son Histoire : elle a en effet révolutionné surtout le rapport entre l’art scénique et le public, pour ainsi dire en renversant la logique sociale en faveur de la poétique artistique, « pour la première fois » !
Dès ce moment-là, jusqu’à présent, Crise et Critique sont les mots-clefs d’un changement de relation entre les artistes et le public : une relation qui ne respecte plus l’ancienne correspondance entre le jeu et l’amusement ou, si l’on veut, la « naturelle » soumission de la scène à l’approbation de la salle. Une Crise perpétuelle et une Critique rigoureuse animent de l’intérieur la recherche théâtrale tandis que – à l’extérieur – elles deviennent les termes épouvantables qui marquent son détachement du public (d’un très grand, d’un trop grand public qu’on appelle « audience »!). Pendant le siècle passé et jusqu’à présent, le rapport entre le théâtre et le public est caractérisé par la juxtaposition d’une incessante vie artistique et une fatigante survie sociale : bref, renaissance artistique et agonie sociale forment un oxymore qui détermine une situation où le théâtre peut encore chercher son public mais le public n’a plus aucun intérêt à avoir son théâtre.
Jusqu’ici, le public a eu un rôle et une responsabilité énormes dans l’histoire vitale et mortelle du théâtre. Si l’on regarde de plus près les origines dont on a parlé, le public a été presque toujours la source primaire de l’institution théâtrale : c’était la Polis grecque et puis l’Église médiévale et encore la Cour et enfin la Ville de la bourgeoisie qui ont proposé leur théâtre, toujours comme « le lieu du regard » qui entoure et capture une scène chaque fois adaptée aux exigences que le public lui a proposées dans les différents théâtres des différentes époques. Et la vraie différence de celle que j’ai nommé comme la plus récente origine (celle du XXe siècle ou de la réforme qu’on peut appeler « la tradition des avant-gardes » à partir de Stanislavski) a été que, pour la première fois, le théâtre vient d’être organisé et justement reformé à partir de la scène et non plus de la salle. Tout ça, à partir d’un « statut d’art » que le théâtre n’avait jamais eu : un statut par contre obtenu – il faut le répéter – dans l’époque qui a vu sa décadence sociale ou bien sa progressive marginalisation, parce que les autres moyens et langages spectaculaires bien plus puissants et dominants lui ont volé l’ancienne centralité ou hégémonie de « représentation ». Pour la première fois, c’est la scène qui domine et détermine les conditions et les conventions de la réception. Une révolution qui a provoqué d’emblée la énième mort du Public (celui du XIXe) et la naissance d’un nouveau Spectateur : l’invention ou l’individualisation d’un spectateur qui a été célébrée comme une libération – et non pas comme une fragmentation – du public même.
2.
Joseph Roth, avec acrimonie plutôt qu’avec nostalgie, récapitule – dans ses notes de voyage – les transformations les plus importantes du nouveau spectateur du XXe siècle : le théâtre a abandonné la « solennité », « le public a l’odeur de la masse », « c’est un pur hasard si nous sommes venus au théâtre »1. Ces trois affirmations suffisent pour cerner le changement de la culture et de la société contemporaines : c’est-à-dire de la culture de masse et de la société de consommation. La perte de la « solennité » (on pourrait dire de la festivité qui caractérisait l’événement mais aussi l’amusement spectaculaire) ; l’irruption en salle d’un vaste public d’intrus (un public nouveau et virtuellement illimité) ; et finalement l’indifférence pour le genre de spectacle choisi, car en 1927 et même dans la Russie socialiste on était déjà à l’aube d’un marché culturel et spectaculaire plus ample, régi par la vertu de l’abondance et enfin par la norme de l’interchangeabilité.
À propos de la Naissance du nouveau spectateur, on pourrait répéter les approches négatives comme des approches positives. Les trois caractéristiques mentionnées peuvent en effet devenir les emblèmes orgueilleux d’une nouvelle génération de spectateurs-consommateurs qui se sont libérés des conventions poussiéreuses et qui s’approchent individuellement du théâtre, en instaurant des relations pour ainsi dire personnelles et, à la limite, « intimes ».
Il faut reconnaître que dans l’actuel et illimité hypermarché des spectacles, la relation individuelle est en effet l’autre face de la consommation massive. L’art scénique et ses nouvelles propositions s’engagent de plus en plus vers cette direction et parfois réalisent une véritable « réforme » du public : il ne s’agit plus de refaire ou de rêver une fausse communauté mais de s’étendre et de capturer un vrai réseau où chaque spectateur se trouve dans la pluralité du public seulement par effet de sa relation singulière avec le spectacle. C’est-à-dire, les liaisons qui se forment entre la scène et chaque spectateur pourront enfin nous donner la sensation de former un public, et cependant – c’est très important de le souligner – on n’est plus « la société qui va au théâtre » mais « le social du théâtre », à savoir le résultat d’une sociabilité occasionnelle et momentanée qui appartient au théâtre : à ce théâtre-là, à ce spectacle qu’on est allé voir, et aussi aux artistes qu’on a décidé de rencontrer. De « consommer » enfin. Pourquoi pas ?
3.
Il serait trop long et compliqué (dans le cadre d’un bref essai) d’analyser l’histoire récente de « la relation entre l’acteur et le spectateur » : il suffit pourtant de reconnaître qu’un de ses fruits – peut être le plus important – a été justement le Bon Spectateur. Et, avant de parler du « mauvais spectateur », il faut se rappeler de son contraire : le spectateur qui naît et qui se forme dans la relation avec les artistes bien avant la relation avec leur spectacle, qui espionne le processus créatif pendant qu’il jouit du produit spectaculaire, qui se reconnaît participant de l’événement, mais encore plus d’une « culture théâtrale » qui a réussi à se substituer à l’ancienne « société théâtrale », en développant une autonomie de l’art scénique presque substantielle et quasi structurelle.
Le bon spectateur est celui qui sait attendre le miracle et respecter le travail d’un art difficile et souvent impuissant… Il est celui qui offre le cadeau de son attention et connaît la méthode pour rendre active une sorte de créativité stimulée par la création scénique, s’il y a et quand il y a une création vraie et efficace… Etc., etc.