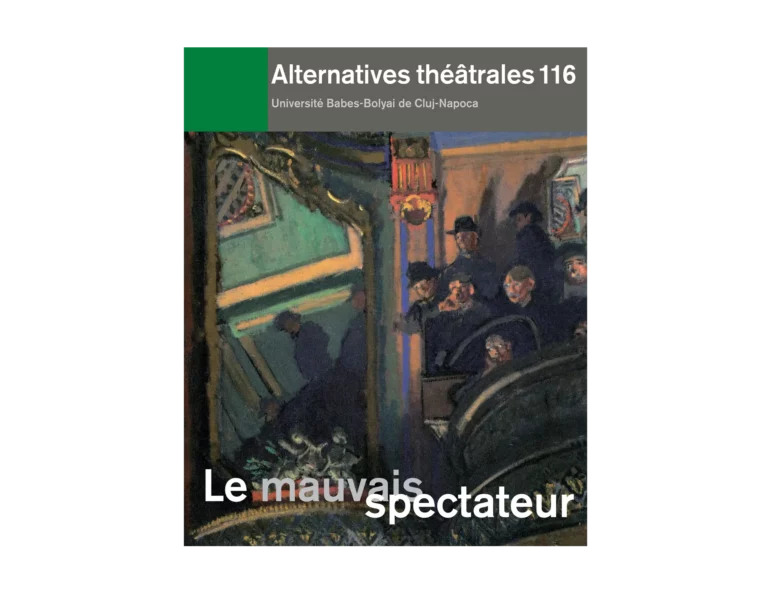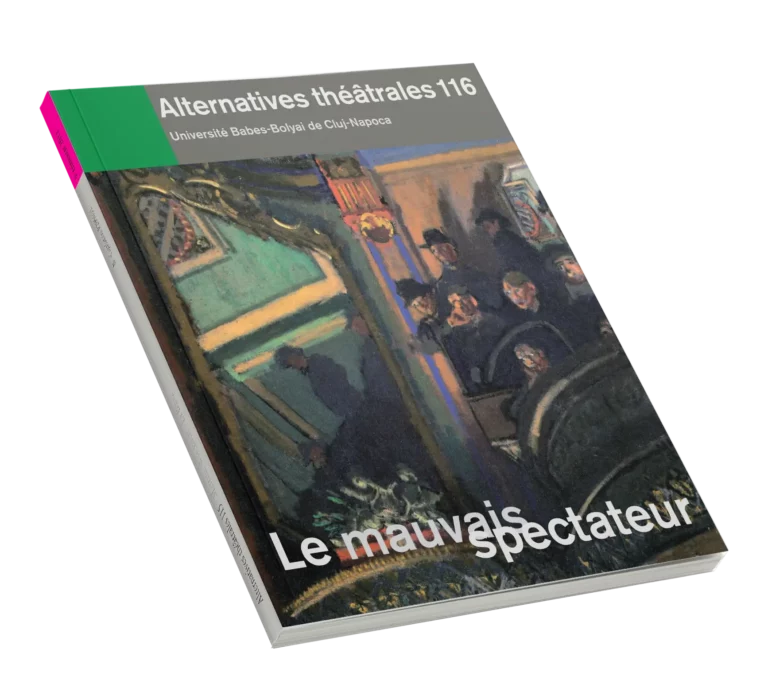PARLER de « bons » ou de « mauvais » spectateurs implique un jugement de valeur et un set de normes qui posent les limites et le cadre du débat, fluctuant en fonction du contexte historique, sociologique, religieux, culturel du phénomène théâtral analysé. En ce sens, le mauvais spectateur de l’Antiquité ne sera pas le même que celui du Moyen Âge et un bon spectateur d’un point de vue sociologique ne le sera pas forcément d’un point de vue religieux. Quel est le cas des spectateurs de théâtre des premiers siècles chrétiens ? Et pourquoi parler de L’Église et du Théâtre sous le signe du mauvais œil ? Parce que nous avons ici une relation semblable à ce que les ethnologues ont pu saisir et décrire au niveau de certaines communautés, où la personne fixée par un regard étranger, la personne qui fascine ou qui est trop enviée, se trouve en danger. Car le regard chargé de négativité est souvent un regard séduit avant d’être un regard qui vole, nie, détruit, tout en voulant s’approprier les qualités vues chez l’autre. Le mauvais œil est aussi une question de puissance, de rapport de forces, d’une guerre muette, souvent peu loyale.
Ainsi, dans notre cas, le développement de la relation Église-théâtre au cours des premiers siècles après Jésus-Christ nous permet de distinguer trois phases qui s’entrecoupent en permanence : la fascination, la destruction et la transfiguration.
1. La fascination
Le public de l’Antiquité, on le sait, se caractérise principalement par son hétérogénéité et son engouement pour les spectacles (fig. 1) qui étaient d’une grande variété : théâtre de texte (tragédies, comédies), pantomimes, mimes, spectacles pendant les banquets (avec acrobaties, danse, musique, fig. 2), spectacles de cirque, courses et combats. Les portraits des acteurs et des cochers préférés étaient reproduits sur les objets personnels, dans les maisons, en fresque ou mosaïque.
Pourtant, avec l’officialisation du christianisme, certaines choses approuvées par une société polythéiste deviennent inadmissibles, éthiquement incorrectes, humainement mauvaises : les exécutions mises en scène, les travestis, les masques, et la condition même d’acteur pour un être humain « image » de son Dieu. Par rapport au regard négatif de Jean Chrysostome porté sur l’art et les effets de la scène, les regards positifs sont peu nombreux à partir du IVe siècle, quand Libanios, parle dans son PRO SALTAT de la pantomime, de son accessibilité et de la charge éducative du contenu de ces spectacles grand-public, puis Chorikios de Gaza qui, dans son APOLOGIA MIMORUM au début du IVe siècle, fait un véritable plaidoyer en faveur des acteurs, la plupart honorables, qu’il ne fallait pas réduire, dit-il, aux seuls fous et bouffons qui se rasaient la tête1. (fig. 3) Quand vous allez au théâtre, quand vous y prenez place pour assouvir vos regards de la nudité des femmes, vous goûtez un moment de plaisir et vous revenez dévoré par la fièvre. […] Que devient désormais votre chasteté ?2 L’immoralité associée aux visages des dieux païens et à des épisodes tels que les amours adultères de Vénus et de Mars ou l’histoire bien connue de Léda et du cygne n’évitait pas les scènes de pantomime, comme nous le font savoir les plaintes répétées de St. Cyprien, au IIIe siècle, dans sa première Épître ad Donatum, et de St. Augustin qui accusait les folies vicieuses des scènes de son temps dans AD CATECHUMENOS et DE SYMBOLO : « In theatris labes morum, discere turpia, audire inhonesta, videre perniciosa. »
L’ensemble des jugements portés sur les spectacles du temps laissent transparaître aussi la fascination du public pour ce qui lui est montré sur scène, comme nous l’avons montré dans une ample étude consacrée au THÉÂTRE À BYZANCE3. Fascination qui a fait de l’actrice de mime Théodora une impératrice d’un côté et qui laissait les églises vides pour remplir les théâtres d’un autre. D’ailleurs, grand fut l’engouement de certains futurs saints Pères de l’Église pour la scène comme pour les jeux de l’hippodrome. Fascination qui, une fois confrontée aux valeurs chrétiennes, s’est transformée en aversion, vitupération et malédiction. Tertullien, Augustin, Jean Chrysostome ne sont que les exemples les plus parlants de ces spectateurs passionnés devenus de mauvais spectateurs et se retournant contre l’objet esthétique tant désiré et adulé.
2. La destruction
Un des résultats fut le suivant : un très grand nombre d’édits impériaux, puis des conciles œcuméniques, interdirent la présence des gens d’Église aux spectacles des banquets, interdirent aux chrétiens d’aller au théâtre, en promettant punitions et excommunications. Déjà, dans son DISCOURS AUX GRECS, Tatien (120 – 173) s’en prenait au mensonge et à l’immoralité qui lui paraissaient indissociables du théâtre, devenant le spectateur négatif de ce qu’il adulait naguère :
Qui ne rirait de vos assemblées solennelles, qui sont placées sous le patronage de méchants démons ? J’ai vu souvent […] un homme qui était autre intérieurement qu’il ne feignait extérieurement d’être, […] en ce seul homme je voyais un accusateur de tous les dieux, un abrégé de la superstition, un bouffon qui parodiait les actions héroïques, un acteur de meurtres, un interprète d’adultères, un trésor de folie, un professeur de débauche, un prétexte à condamnations capitales. Et je le voyais applaudi par tous ; mais moi je le répudiais, lui qui n’est que mensonge, en son impiété, en son art, comme en sa personne.4