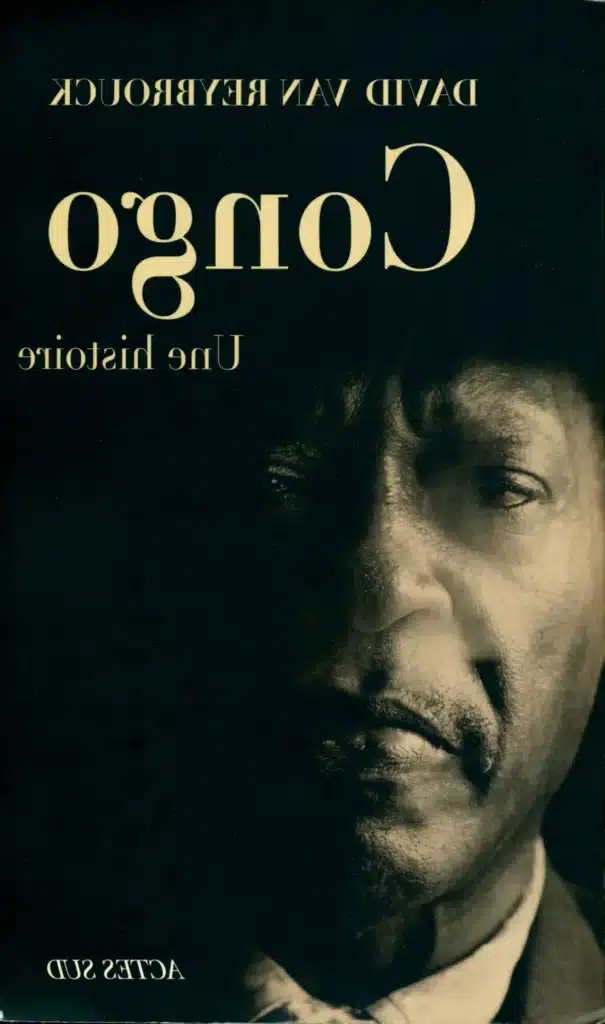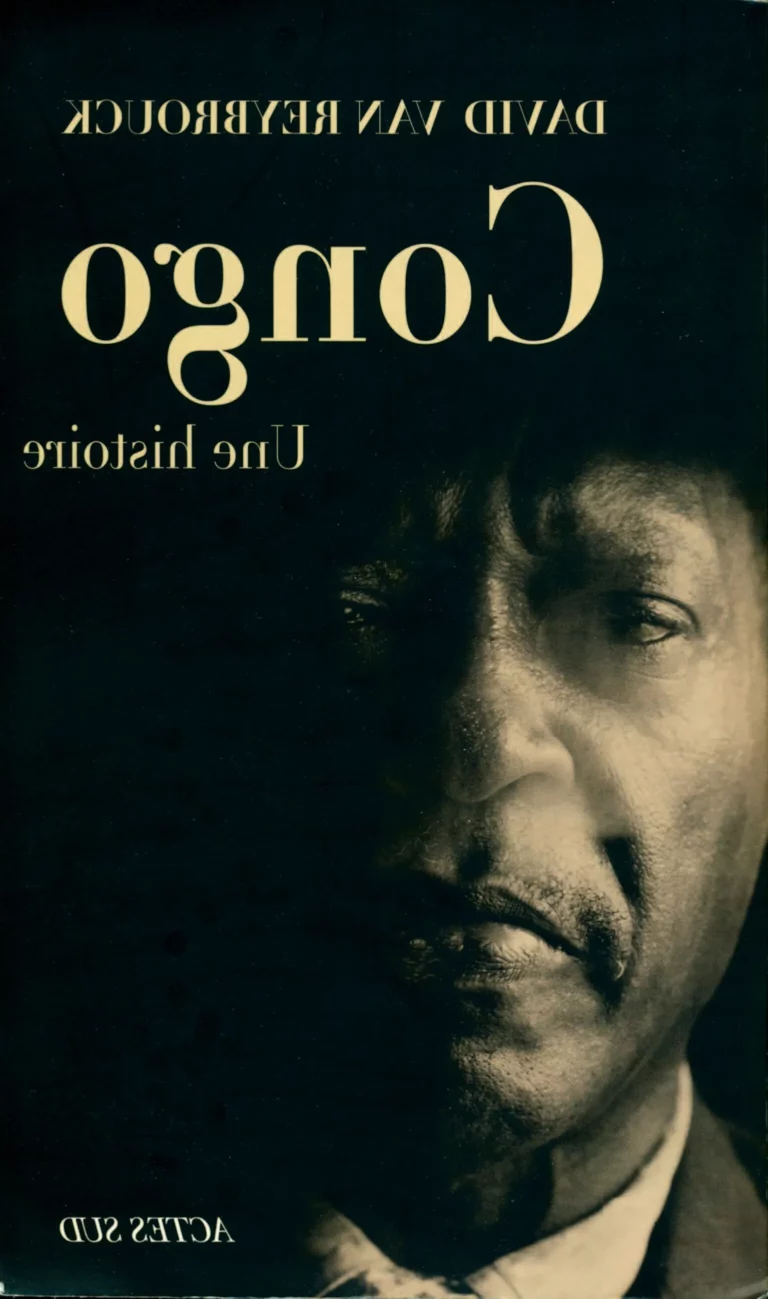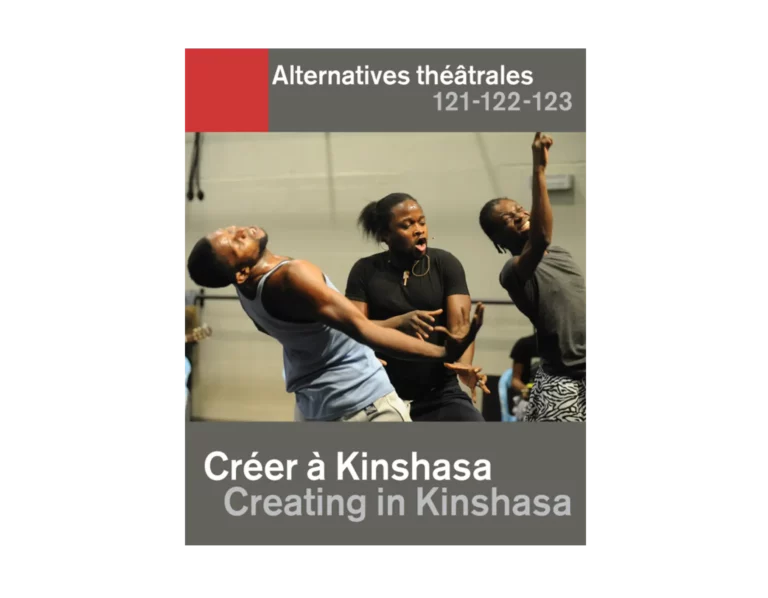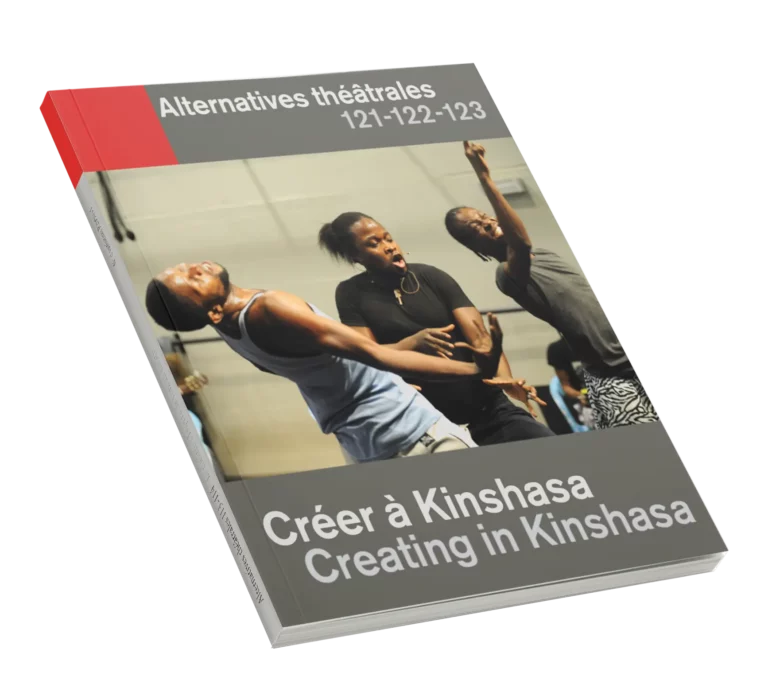Bernard Debroux : C’est avec Jan Goossens que tu as fait un de tes premiers voyages au Congo. Quelles en ont été les circonstances ?
David Van Reybroeck : J’avais été au Congo en décembre 2003 pour rendre visite à un ami à Kinshasa. La ville m’avait fait forte impression. On retrouve ces impressions dans ma pièce L’Âme des termites qui devait au départ se passer en Afrique du Sud, mais suite à ce voyage, elle est devenue congolaise.
Après, j’ai fait la connaissance de Jan qui m’a proposé de repartir avec lui au Congo. Nous avons fait ce premier voyage ensemble en 2005 (juste après la fin de la guerre et avant les élections de 2006), emportant avec nous une liste de quelques contacts, de numéros de téléphone. Ce fut un voyage de découvertes. Nous ne savions pas encore en nous engageant ainsi que le « congo werking » (l’opération Congo) allait devenir aussi important. Les artistes que nous avons rencontrés nous ont immédiatement fait forte impression. Ce furent les premiers contacts avec Faustin Linyekula. Le théâtre des Intrigants nous a présenté un extrait de spectacle et nous avons découvert l’écurie Maloba. Les artistes travaillaient des conditions de travail extrêmement précaires. C’est ce que j’ai relaté à mon retour dans un article pour le journal De Morgen intitulé Drame au Congo.
La compagnie des Intrigants, par exemple, survivaient grâce à la location de chaises : leur fonds de commerce était constitué de deux cents chaises qu’ils mettaient à disposition des familles pour les deuils qui durent deux, trois jours. C’était leur ressource principale !
On pouvait se poser la question de l’intérêt de faire du théâtre dans des conditions aussi difficiles ! Je me rappelle du témoignage d’un comédien nous disant : « il n’y a pas de travail à Kin, alors autant faire quelque chose qu’on aime ! » Plus globalement, j’ai été très frappé par ce besoin, cette nécessité impérieuse de créer. Ça bouleverse la vision qu’on peut avoir des pays fortement endettés, des pays très pauvres où on pense que la culture est un besoin secon- daire (voire tertiaire ou quaternaire!). Un artiste est un artiste partout : même dans un contexte de pénurie totale.
B. D. : Chez tous les artistes que j’ai rencontrés à Kinshasa, j’ai ressenti cette énergie capable de « déplacer les monta- gnes ». La situation n’a pas changé depuis ton premier voyage. Dix ans plus tard il n’y a toujours pas d’argent des pouvoirs publics pour la création. Les artistes doivent compter sur leurs propres forces et se battent comme des lions pour trouver des moyens pour exercer leur art.
D.V.R. : Oui,ilyacommeunfeuquilesanime.Àlafinde mon livre, en remerciements de certaines personnes que j’ai rencontrées là-bas, je rappelle que « non seulement elles m’ont aidé à comprendre leur pays, mais aussi à l’aimer, car un pays qui produit des artistes aussi intelligents et courageux est loin d’être perdu ».1
B. D. : Le « congo werking » du KVS a tenté d’installer d’autres types de relations entre Belges et Congolais…
D. V. R. : C’était très important de dépasser la logique coloniale ancienne qui était plus binaire. En 2005, lors de la présentation à Kinshasa de Martino de Arne Sierens, spectacle mis en scène par Raven Ruëll avec des comédiens afro-bruxellois (rwandais, ivoiriens, camerounais congolais), les Congolais nous ont fait deux remarques à l’issue de la conférence de presse où Jan Goossens rappelait, en s’excusant, que ce théâtre (le KVS) avait joué au Congo dans les années cinquante pour le plaisir des coloniaux blancs et que c’était la première fois qu’il était de retour. La première remarque était sans appel!: « il ne faut pas vous excuser pour ce que vous avez fait dans les années 50, il faut vous excuser de ne pas avoir été là dans les 50 années qui ont suivi » !
Cela montre à quel point la gueule de bois postcoloniale a toujours quelque chose d’égocentrique, comme si le pays s’était arrêté en 1960. « Le chagrin du Congo belge » si je peux m’exprimer ainsi reste plutôt belge que congolais ! La deuxième remarque c’était : pourquoi venez-vous avec des artistes noirs ? Cette conférence de presse a été un moment crucial dans le développement du Congo-werking.
B. D. : Cette même année 2005, tu as eu l’occasion d’animer des ateliers d’écriture…
D. V. R. : Il y avait un désir d’apprendre, une motivation extraordinaire. Les étudiants là-bas se levaient à 4 heures du matin pour traverser toute la ville et être présents à l’atelier à 8 heures ! Ils écrivaient à la main et profitaient de la pause pour saisir leur texte sur les deux vieux ordinateurs portables mis à leur disposition.
- David Van Reybrouck, Congo, une histoire, Actes Sud, 2012, p. 601. ↩︎
- www.brusselspoetry collective.net/fr.html ↩︎
- Le terme « ubuntu » est présent dans toutes les langues bantoues. La philosophie africaine « ubuntu » est une condamnation radicale de l’égoïsme, du carriérisme, du narcissisme et de toute forme d’individualisme plus ou moins prononcé. « Ubuntu » proclame ce que nous sommes grâce à ce que les autres sont. ↩︎
- Plate forme démocratique : www.g1000.org/fr/ ↩︎