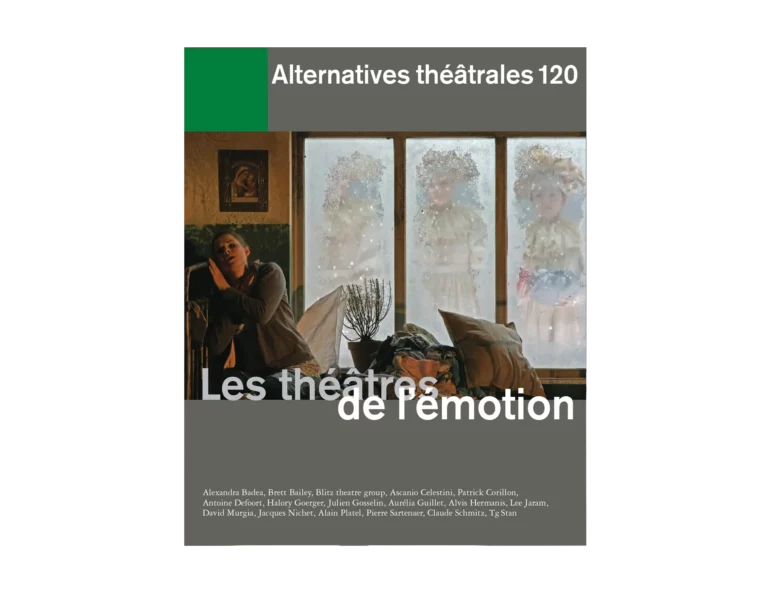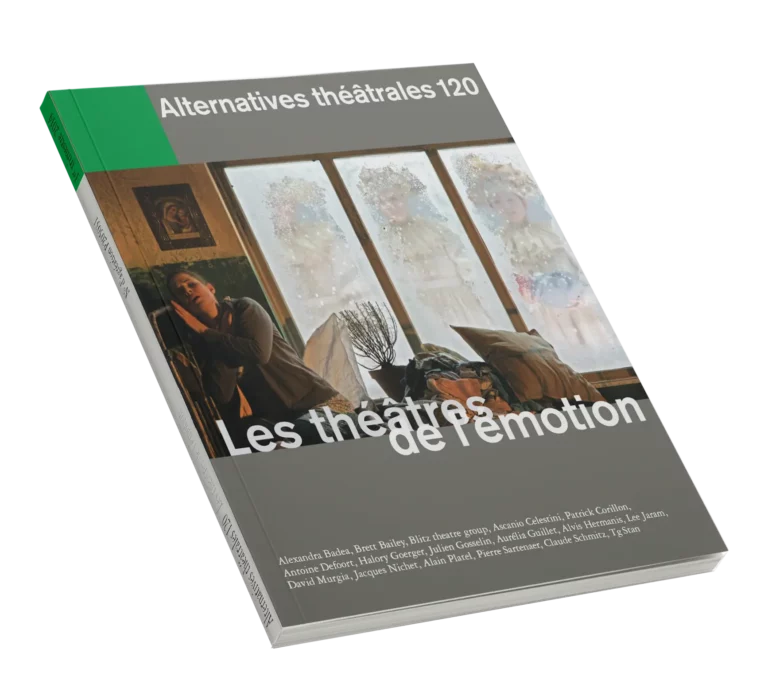Jusqu’en 1975, l’adaptation d’un roman au théâtre était exclusivement réduite au dialogue. Il fallait faire passer à la moulinette de l’échange de répliques tout ce qui dans le roman – description et narration – constituait la spécificité du récit. Et ce qu’on ne pouvait réduire, on le reléguait dans les didascalies, que Bernard Dort qualifia d’ailleurs un jour de « tissu romanesque de la pièce de théâtre », mais ces didascalies demeuraient muettes et ne servaient qu’à nourrir la partie interprétative et visuelle de ce qui, dans la mise en scène, est directement proféré.
Marivaux le premier avait montré la voie. Peut-être un peu à court d’inspiration, vers la fin de sa vie et de son œuvre, il avait en effet isolé quelques chapitres de son roman d’initiation, Le Paysan parvenu, pour en faire une comédie qu’il intitula La Commère, en effaçant et soustrayant tout ce qui dans le texte d’origine aurait pu rappeler son identité romanesque. Le modèle était trouvé : c’est celui que perpétueraient Zola et ses épigones pour alimenter les scènes parisiennes et principalement le Théâtre Libre d’André Antoine, dans les années 1880, d’innombrables drames naturalistes. C’est aussi celui auquel auraient recours Jacques Copeau et Albert Camus, de 1911 à 1959, pour leurs magistrales adaptations de Dostoïevski. Récemment encore, à rebours de ce que le théâtre dit « post-dramatique » semblait avoir imposé, Piotr Fomenko et Kristian Lupa optèrent pour ce mode de transposition qui tente de faire oublier le plus possible que l’œuvre n’a pas été spontanément écrite pour le théâtre.
Théâtre-Récit
1975 est à ce titre une date qui fait rupture. Rupture épistémologique aurait-on dit dans les années Foucault. 1975, c’est la date à laquelle Antoine Vitez prit l’initiative un peu folle et totalement inédite de rendre hommage à Louis Aragon à travers l’une de ses œuvres, Les Cloches de Bâle, en en exhibant de façon quasi brechtienne et sur un mode ludique, toutes les caractéristiques romanesques – description et narration comprises.
« Tentative de théâtre-récit, confie Vitez dans le programme du spectacle… Allusion à Théâtre/Roman, évidemment… (le titre de l’ultime roman, quasi testamentaire, d’Aragon, ndlr). Partant de l’idée que le théâtre n’est pas nécessairement ce qui s’écrit à la première ou à la deuxième personne. On peut prendre aussi la troisième, et la prose romanesque elle-même. Prendre. Le théâtre prend son bien où il le trouve, c’est ce qui le caractérise, il prend, il détourne (…).
Notre récit théâtral tentera de faire vivre les personnes en scène sans considérer leur sexe comme une donnée allant de soi, et dans leur relation avec des objets en nombre rare, symboliques, que notre imagination chargera de tout le paysage romanesque. Un repas de famille, ou bien une chambre, un lit défait, les miettes de pain sur la table, cela suffit pour dire le vaste monde.
Ce théâtre-ci est un théâtre indirect. Un théâtre du microcosme (…). Et nous tenterons une fois encore de répondre à la question-vertige que se pose l’acteur. Comment jouer tout ? Le tout ? Et pas seulement des personnages, mais aussi des rues, des maisons, la campagne, et les automobiles, la cathédrale de Bâle, la vie ? »
« L’acteur peut tout » proclame Vitez dans un autre texte daté de la même année, profession de foi héritée tout autant de l’art poétique affirmé par Shakespeare dans le prologue d’Henry V que des enseignements de Jacques Copeau ou de Tania Balachova, confiance réaffirmée dans les pouvoirs poétiques de la choralité et dans la fantaisie créatrice des exercices de gymnastique mentale. L’acteur peut alors tour à tour se faire récitant, narrateur ou conteur, puis personnage en monologue ou en dialogue, subjectif, incarné, passer insensiblement, par rupture ou par glissement, de la troisième à la première personne, dans un sens puis dans un autre, allers et retours incessants qui déstabilisent le spectateur dans son confort psychologique, mais excitent en compensation son imaginaire et le maintiennent en état jubilatoire d’intelligence critique.
Cet audacieux héritage, Julien Gosselin l’a reçu par transmission indirecte de plusieurs manières différentes. Né à Oye Plage sur le littoral du Pas-de-Calais en 1986, il intègre une option théâtre au Lycée Sophie Berthelot de Calais où interviennent Les Fous à réaction (associés), une compagnie d’Armentières animée par Vincent Dhelin et Olivier Menu avec laquelle en 1998 Stuart Seide avait inauguré sa première saison du Théâtre du Nord à Lille : une adaptation en liberté, très vitézienne et très ludique, du roman Amerika de Kafka. En classe terminale, il est au Bateau Feu, Scène Nationale de Dunkerque, le coryphée d’une mise en scène chorale de Class Ennemy de Nigel Williams dirigée par Pierre Foviau. Il intègre l’année du bac l’École Professionnelle Supérieure d’Art Dramatique de Lille, associée au Théâtre du Nord. Là survit la mémoire diffuse de l’adaptation par Gildas Bourdet de Martin Eden de Jack London, réponse populaire, joyeuse et amicale, l’année suivante, du Théâtre de la Salamandre à la Catherine d’Antoine Vitez. Dominique Sarrazin, qui participa comme acteur à l’aventure, y perpétue l’héritage avec ses adaptations chorales de Thomas Hardy et de Charles Dickens. Mais il y eut surtout la rencontre de Stuart Seide, un des nombreux disciples d’Antoine Vitez, programmé par lui à Ivry et à Chaillot, et par lui encouragé à s’attaquer à Moby Dick de Melville, dans une esthétique dont on retrouverait l’esprit à deux reprises avec une magistrale adaptation du Quatuor d’Alexandrie de Lawrence Durrell, dans la petite salle du TNS en 1988 avec la promotion de Jean-François Sivadier d’abord, puis en juillet 2002 à la Carrière Boulbon, dans une version professionnelle où l’on retrouvait, légèrement vieillis et quasi à l’âge de leurs rôles, Laurent Manzoni et Pierre-Henri Puente. La programmation plus récente de Tempête sous un crâne de Jean Bellorini d’après Les Misérables de Victor Hugo, puis de L’Assommoir d’après Zola par le jeune collectif bordelais OS’O parachève l’intérêt manifesté par le Théâtre du Nord version Stuart Seide pour ces exercices décomplexés de théâtre-récit.
C’est donc bien par l’imprégnation indirecte et diffuse, voire pour une part inconsciente, de cette culture vitézienne du théâtre-récit que Julien Gosselin se sent à son aise dans ce que la critique appelle aujourd’hui « théâtre de texte », comme s’il s’agissait d’une sorte de survivance ou de résistance face au prétendu triomphe du théâtre visuel, celui du corps et de l’image, après la polémique aiguë de l’édition 2005 du Festival d’Avignon.
Et pour le mieux revendiquer, il (se) lance un défi doublement provocateur : il choisit une œuvre récente (1998) dont le projet monumental, bien que concentré sur un seul tome, rivalise secrètement avec les grands modèles du passé que peuvent être La Comédie humaine ou Les Rougon Macquart – une épopée familiale à vocation psychosociologique, une saga intergénérationnelle dont l’ambition serait de peindre une époque ; il opte en outre pour un auteur scandaleux, sulfureux, dont les prises de position, les déclarations médiatiques et le style hétéroclite font se pincer le nez aux esprits les mieux pensants et autres chiens de garde de la tempérance politiquement correcte.
Cela donne quatre heures de spectacle, deux fois deux heures avec entracte, où alternent tous les styles d’écriture, dramatiques ou non : dialogues du quotidien, monologues littéraires, polyphonies chorales, discours historique, philosophique, épistémologique et scientifique, narration, description, talk-show télévisé bilingue, archive d’émission de jeu, note encyclopédique anonyme façon Wikipédia, poèmes, paroles de chanson pop anglophone, etc.
Espaces
L’essentiel de l’action se déroulera sur un vaste rectangle plan et nu au centre du plateau, sorte d’orchestra où évolueront en groupe ou au singulier les choreutes et les coryphées successifs de cette tragédie moderne, projection métaphorique d’une agora à laquelle nous, spectateurs assis en face, appartenons tous également, puisqu’à bien des égards c’est l’histoire de notre génération ou celle de nos parents qui sera racontée dans cette anti-épopée.
Pour la première partie, cette aire de jeu sera recouverte d’un vrai gazon naturaliste qui sent la terre, l’herbe et l’humidité, évoquant cette fausse nature qu’on achète en plaques ou en rouleaux dans les jardineries et dont les citadins raffolent pour agrémenter leurs halls d’expositions, leurs événements festifs et leurs salons commerciaux. Image artificielle et dérisoire du jardin d’Eden, du vert paradis des amours enfantines, puis du retour à la terre, au Larzac ou dans les Cévennes, de ces centaines de jeunes gens déçus par l’échec de mai 68, en rupture temporaire avec la capitale, l’université et la perspective d’une récupération bourgeoise.