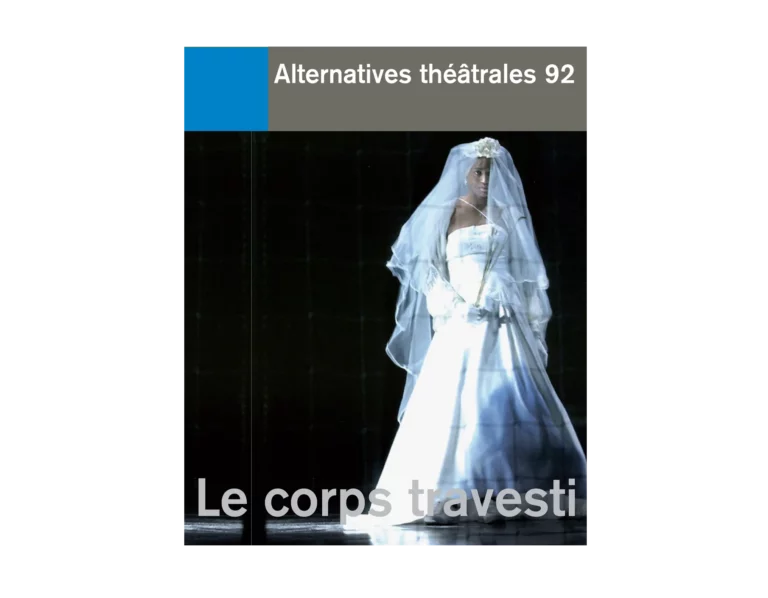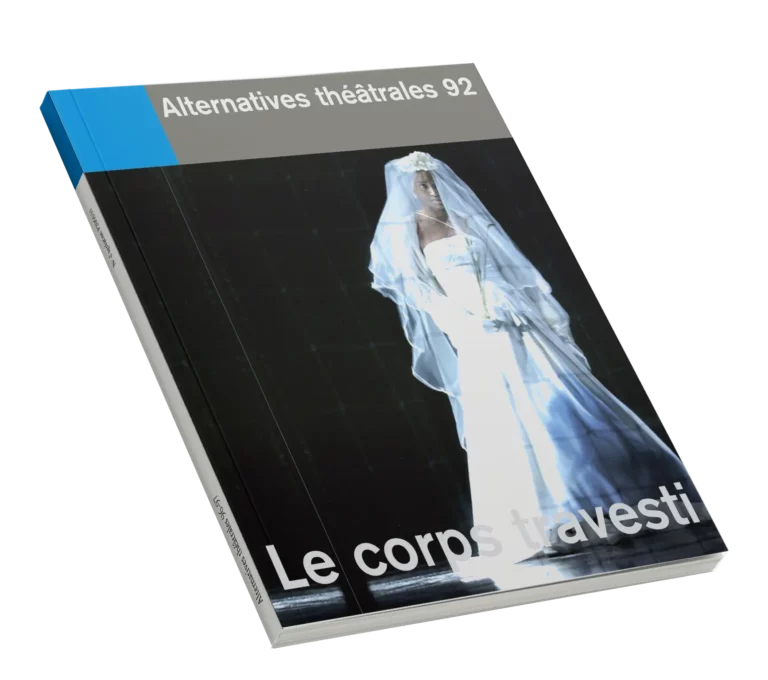Le début de la révolution gay : Stonewall, 1969
LA PRATIQUE du travestissement dans le théâtre aux États-Unis a suivi une évolution qui peut être découpée en quatre étapes. Une première période se dessine dans les années 50 – 60 autour des spectacles de travestis que l’on trouve dans les bars gays à Greenwich Village à New York, ou dans le quartier Castro à San Francisco. Ces spectacles, d’un style populaire, low brow selon l’expression américaine, ont peu de valeur sur le plan artistique, mais ils accompagnent la vie homosexuelle d’avant Stonewall.
Stonewall marque le début de la révolution gay aux États-Unis : en juin 1969, pour en finir avec les sévices qu’ils subissaient, les consommateurs du bar The Stonewall à Greenwich Village se sont opposés aux forces de l’ordre lors d’une interpellation. Les émeutes ont été idéalisées depuis, on imagine des hordes de gays se révoltant à coups de pavés et de talons aiguilles contre la police américaine. Mais il y a eu une réaction spontanée à laquelle ont participé de nombreux travestis et transsexuels. On dit à ce propos que la première à avoir jeté une pierre fut une flamboyante travestie !
Cette vie nocturne dans les bars et les cabarets reste présente dans la mémoire collective des gays et dans celle des artistes qui ont joué un rôle par la suite. Même s’il s’agit d’un divertissement un peu bas de gamme, il a marqué les esprits. Les bars qui offrent ce type de spectacles connaissent une véritable expansion au début des années 70, comme à Paris à partir de 1968 dans le quartier gay de la rue Sainte-Anne.
L’après-Stonewall : militantisme et marginalisation du travesti
La deuxième étape naît après 1969, c’est l’après Stonewall, avec la création de troupes gays autour d’un théâtre politique : s’il intègre encore fréquemment des travestis, il est porteur d’un message engagé. Sophistiqué, high culture, il accompagne la libération gay des années 1970, la terminologie « théâtre gay » apparaît d’ailleurs à cette époque. On n’est plus dans les cabarets mais dans des théâtres, généralement d’Off-Off-Broadway. Les gays veulent rompre avec l’image de la folle, ils s’éloignent de la féminité pour sur-valoriser la masculinité, à travers le culte du G.I., du militaire, du pompier. Radical, d’extrême-gauche, dénonçant l’homophobie, ce théâtre militant se poursuit jusque vers 1982, date à laquelle le sida commence à décimer cette communauté. Mis à part de rares ouvrages spécialisés, on connaît assez mal ce théâtre politique gay américain des années 1969 à 1982, qui a pourtant été particulièrement productif. Cela tient au fait qu’il a été très décentralisé et que la plupart de ses acteurs sont morts précocement du sida.
Le sida a entraîné un nouveau changement : les pièces contre l’homophobie et de lutte pour la défense des droits des gays se transforment en pièces de mobilisation qui luttent essentiellement contre le sida. Elles sont très critiques à l’égard des responsables politiques, que ce soit contre le président Reagan, le maire de New York et les autres acteurs qui refusent de faire de la prévention ou qui ne la financent pas. La pièce clef de cette période est THE NORMAL HEART de Larry Kramer – Larry Kramer étant le fondateur de l’association Gay Men’s Health Crisis en 1982, puis d’Act Up en 1987. Cette pièce décrit l’arrivée du sida dans la communauté gay et la nécessité de se battre. Elle est paradoxalement assez datée, je pense qu’elle est tellement imbriquée dans le contexte de l’époque qu’elle apparaît finalement aujourd’hui quelque peu anachronique.
THE NORMAL HEART reste néanmoins représentative d’une mutation sensible du théâtre gay. Que ce soit dans la première phase des spectacles de travestis dans les bars ou dans celle, plus politique, des années 70, on a un courant optimiste et plutôt festif. En revanche, à partir de 1982, ce théâtre devient sérieux : on ne s’amuse plus, on ne se travestit plus, ou alors très marginalement, parce qu’il y a urgence.