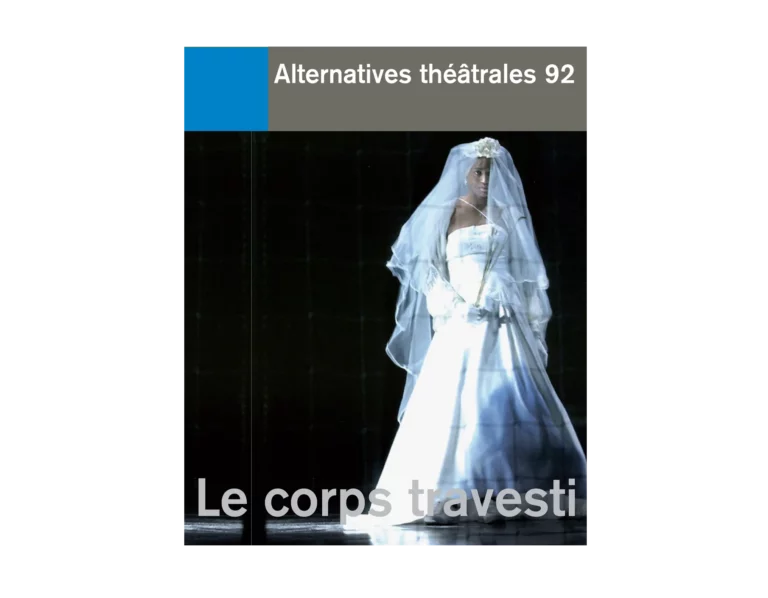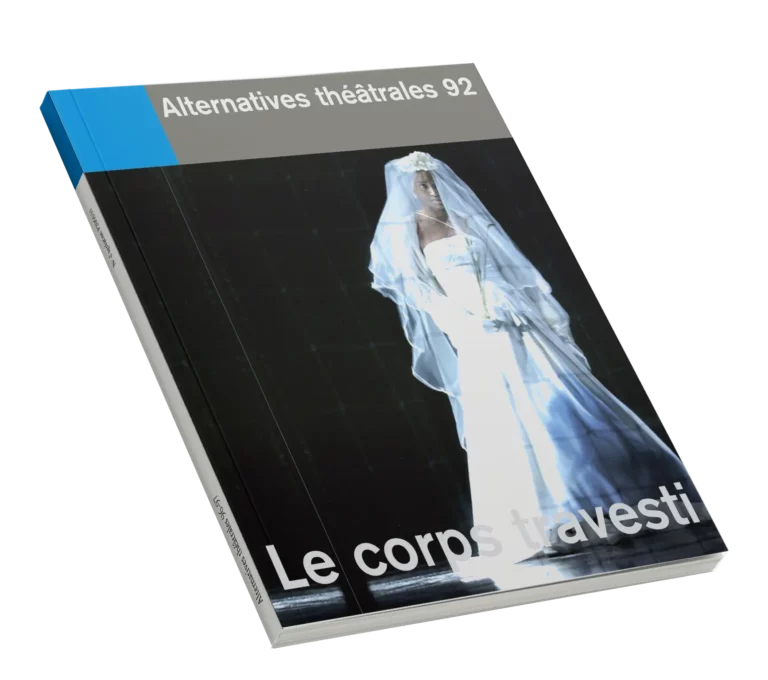CHRISTIAN JADE : Déjà explicite dans le thème de la pièce et dans l’univers théâtral de Shakespeare, le travestissement se trouve au cœur de votre mise en scène de LA NUIT DES ROIS (1999), qui, de votre propre aveu, est aussi inspirée par le théâtre japonais et la tradition du kabuki.
Nathalie Mauger : À l’époque de Shakespeare, les femmes n’avaient pas le droit de monter sur scène et leurs rôles étaient toujours joués par des hommes. Cet interdit vis-à-vis du corps féminin est en soi historiquement intéressant, puisqu’il nous rappelle que le corps de la femme était considéré comme impur, indécent ou dangereux, donc ressenti comme une menace. Le travestissement nous rappelle le trouble et le plaisir que peut engendrer cet interdit.
L’autre source de mon travail est effectivement le théâtre oriental kabuki que j’ai découvert à travers MADAME DE SADE de Mishima, mis en scène par Sophie Loucachewsky, assistante d’Antoine Vitez. Au Japon, les acteurs masculins, les onnagatas, sont spécialisés dans la représentation du corps de la femme de manière très codée. On n’est absolument pas dans le naturalisme ou le réalisme : tout est suggéré, évoqué, codifié et suppose donc une connivence entre l’acteur et le spectateur. Cela permet d’aborder l’interdit sexuel de manière très « cadrée », protégée par un code, qui établit des frontières, des limites. Cette tradition onnagata fait surgir du désir, du trouble en « construisant » un corps plus encore qu’en le travestissant. Cela rejoint ma conception de la mise en scène : une « construction » avec la complicité des acteurs, dont le corps, le costume, le rythme, la voix — des éléments à la fois organiques et inorganiques — font émerger du trouble, du désir et du sens dans la représentation.
C. J.: L’emprunt à ces deux traditions anciennes dont l’une, l’orientale, a survécu, vous permet de casser un modèle occidental traditionnel, « naturaliste » ?
N. M.: « Casser » le modèle, je ne crois pas. Si en Occident le code est plus réaliste, il y a, depuis Brecht, tout un travail d’acteur qui prend appui sur la narration ou l’incarnation. C’est ce qui m’intéresse : jusqu’où un acteur est-il capable d’«incarner » quelqu’un, un monstre par exemple, comme dans THYESTE, de Sénèque. Le corps du comédien doit être capable d’ouvrir des espaces imaginaires qui dépassent de beaucoup ce qu’il est « naturellement », avec ou sans « travestissement ». Sans maîtriser les codes très complexes de la tradition des onnagatas japonais, j’ai une sensibilité et un intérêt pour cette manière d’interroger la sexualité d’un corps féminin via un corps masculin. On m’a souvent fait remarquer que dans les pièces que je montais, il y avait très peu de rôles féminins. Dans MANQUE, de Sarah Kane, tous les personnages, masculins et féminins, sont dissous dans l’abstraction de quelques lettres de l’alphabet (a, b, c, m): les personnages deviennent des « entités » féminines et masculines. Dans ANDREA DEL SARTO de Musset, que je travaille en ce moment, il n’y a qu’un personnage féminin — central il est vrai – dans un monde d’hommes. Dans THYESTE aussi, tout se passe entre hommes.
C. J.: La question centrale dans LA NUIT DES ROIS n’est-elle pas une interrogation sur la féminité de ces hommes ? Vous imposez à tous vos acteurs un « uniforme », une jupe. Comment ont-ils vécu cette obligation de principe ? Leur demandiez-vous de travailler leur part féminine ?
N. M.: La question ne se pose jamais de face, au début en tout cas, parce qu’elle pourrait provoquer des résistances ou des blocages. Et d’ailleurs il y a eu un problème, à la fin des répétitions, avec un des acteurs, Lyes Salem, qui incarnait à la fois Cesario et Viola, le rôle central, le plus ambigu. Il avait un physique qui se prêtait à cette double incarnation, ce qui avait soulevé des questions assez angoissantes chez lui. Il a eu un moment de refus et ne voulait plus porter sa jupe. Les autres acteurs se sont emparés de cette nouvelle logique et ont trouvé très vite leur personnage, extérieur à eux, sans ressentir un danger personnel par apport à ces ambiguïtés scéniques. Je ne leur demandais pas explicitement de trouver leur part féminine, préférant rester dans le flou pour qu’ils la trouvent spontanément, sans la théoriser.
C. J.: Avec le déguisement féminin, il y a un danger de passer dans la catégorie CAGE AUX FOLLES. Comment canaliser, dans une troupe assez nombreuse, les envies d’en faire trop ?
N. M.: Il y a eu des demandes très précises de la part de certains acteurs comme Philippe Crubesy, qui jouait le personnage de Lydia. D’abord, avec un physique aussi masculin, comment arriver à le féminiser ? Est-ce qu’on joue l’illusion totale en lui ajoutant des seins ou une coiffure blonde décolorée ? Quand il se regardait dans un miroir, il se faisait penser… à sa mère. Malaise ! Mais ce genre de situation enrichit aussi la qualité d’interprétation de l’acteur qui retrouve des couches enfouies de son enfance, de sa relation à la mère ou au père, sans que le metteur en scène doive théoriser sa recherche sur le féminin dans le masculin. Shakespeare lui-même nous y aide, dans cette pièce très construite, à plusieurs niveaux de lecture. Il joue sur ces ambiguïtés mais sans jamais déborder vers la caricature de type CAGE AUX FOLLES. Les niveaux d’interprétation sont riches et variés, on passe de la comédie à la tragédie, sans oublier l’aspect métaphysique de cette quête d’identité.
C. J.: Votre système de vêtement féminin généralisé fonctionne très bien pour les personnages principaux, mais qu’apporte-t-il aux personnages secondaires ?
N. M.: Le système de féminisation par le vêtement appliqué, par exemple, au clown Fest relève plutôt d’une démarche esthétique. Mais pour Malvolio, personnage puritain, austère, coincé, l’apport d’une jupe, qu’il ouvre et referme rapidement, lui permet d’exprimer facilement des pulsions exhibitionnistes refoulées. Le public riait beaucoup, la scène était comique mais, sous le rire, on retrouvait la problématique générale de la difficile identité sexuelle. La jupe retrouvait une double efficacité, ambiguë, celle de dissimuler le corps ou de l’exhiber soudainement selon la pulsion.
C. J.: Pour faire surgir la féminité de vos acteurs masculins, essayez-vous, à la manière de Stanislavski, de faire surgir la vérité intérieure du personnage en utilisant une partie du vécu de l’acteur, sa mémoire affective ?
N. M.: Ça dépend tellement des acteurs ! Tous ne s’approchent pas de la même manière, ne fût-ce que parce que je travaille avec un cercle d’acteurs que je connais bien et d’autres, nouveaux, que je dois « apprivoiser ». Dans LA NUIT DES ROIS : X et X sont frère et sœur, ce n’est pas un « couple » habituel. Il y a bien sûr le thème de l’inceste mais il s’agit surtout pour les acteurs de retrouver dans l’autre quelque chose qui est vraiment de soi, et cela ne se limite pas au thème de la gémellité. On projette vers l’extérieur une part de soi avec laquelle on dialogue. Dans un couple classique, chacun part à la rencontre de « l’autre » alors que dans le rapport frère sœur, on cherche une part manquante, qui est liée à sa propre identité, et en même temps on flirte avec la notion d’homosexualité. Dans LA NUIT DES ROIS, il y a beaucoup de personnages sans père : ce ne sont pas des adultes déjà construits. Le travestissement est alors conçu comme un outil de construction d’une identité, pas seulement sexuelle mais affective.
Dans THYESTE, de Sénèque, c’est la construction de l’identité d’un monstre qui m’intéressait : tout est lié, dans ces phénomènes qui posent la question de la marginalité et de la norme. Qu’est-ce qui est normal/anormal, « montrable/pas montrable » ? Quel espace ouvre-t-on dans le corps des acteurs et l’imaginaire du public ?
C. J.: Vous avez travaillé ce texte dans la traduction d’Ariane Mouchkine. Vous a‑t-elle aussi influencée, comme dramaturge et metteuse en scène ?